Anglicismes : n’empruntons que le strict nécessaire! Théorie Exercices Co
Anglicismes : n’empruntons que le strict nécessaire! Théorie Exercices Corrigés Bibliographie Depuis au moins deux siècles (Bouchard, 2002, p. 91), chroniqueurs, professeurs, journalistes, membres de l’élite intellectuelle, etc., évoquent les anglicismes qui émaillent le français d’ici. Beaucoup de choses ont été écrites sur le sujet, de très nombreux recueils de formes fautives ont été publiés, des campagnes du « bon parler » ont été organisées. Tout cela a porté des fruits, certes, mais certaines fautes sont tenaces ou refont surface après quelques années passées dans l’oubli, et de nouveaux emprunts à l’anglais sont faits. C’est pourquoi il est essentiel de se pencher sur les anglicismes quand on parle de qualité de la langue. Des emprunts parfois inutiles L’anglicisme est un mot, une expression, un sens, une construction propre à la langue anglaise qui est emprunté par une autre langue, dont le français (Multi, p. 81). Le phénomène des emprunts linguistiques n’est pas nouveau et il s’est produit à de nombreuses reprises dans l’histoire. Ces emprunts, qui peuvent être motivés ou non, se produisent dès que deux langues sont en présence l’une de l’autre, une langue, la langue prêteuse, ayant souvent un plus grand rayonnement que l’autre, la langue emprunteuse. La langue prêteuse doit fréquemment son pouvoir linguistique au fait qu’elle est la langue d’un État ou d’une communauté linguistique exerçant une suprématie économique sur d’autres États ou communautés linguistiques. La langue prêteuse prêtera plus de mots à la langue emprunteuse que l’inverse. Bien souvent, c’est le vocabulaire technique des domaines d’excellence de la culture prêteuse qui s’impose. Par exemple, le français a beaucoup emprunté à l’italien en matière de vocabulaire de la musique, le vocabulaire français de la gastronomie s’est répandu dans le monde, et la langue des nouvelles technologies de l’information est actuellement l’anglais américain. Les locuteurs empruntent non seulement des mots à d’autres langues, mais, le plus souvent, les réalités que ces mots désignent. Rien de plus normal, donc, que les francophones empruntent des mots (et les réalités qu’ils désignent) à la culture anglaise qui les entoure? Oui. Cependant, si certains emprunts sont utiles parce que le français ne dispose pas d’équivalents pour eux (par exemple : baseball, blazer, rail, short, steak, etc.), d’autres viennent interférer avec les expressions et les mots français qui existent déjà. Ces emprunts sont inutiles et nuisent même à la clarté de l’expression. Nous traiterons de ces emprunts dans les exercices de cette section. Des distinctions s’imposent Il est bien sûr permis de faire des emprunts, utiles et inutiles, lors de conversations entre amis, en famille, dans toute situation de communication de niveau familier, souvent orale. Les recommandations qui suivent valent surtout pour les situations de communication officielles, que ce soit un exposé oral fait en classe, un travail trimestriel, un article destiné au journal étudiant, une entrevue accordée à un média, etc. C’est dans de tels cas qu’il faut soigner sa façon de s’exprimer. Dans son « Énoncé d’une politique relative à l’emprunt de formes linguistiques étrangères », l’Office québécois de la langue française (OQLF) rappelle qu’il faut distinguer « entre l’usage officiel et l’usage personnel de la langue. L’usage officiel doit nécessairement se soumettre à des contraintes normatives; ces contraintes deviennent facultatives dans les communications privées » (OQLF, 1980, p. 234). L’OQLF, dans son « Énoncé », établit une autre distinction qui touche tout particulièrement les étudiants de l’enseignement supérieur. Il attire l’attention sur la différence entre la langue commune, ou générale, et la langue de spécialité, cette dernière étant très répandue dans nos murs. La langue de spécialité est « l’ensemble des mots ou expressions propres à une science, une technique, un art, une activité » (OQLF, 1980, p. 234). Sans admettre d’emblée tout emprunt à l’anglais dans les langues de spécialité dont on se sert très souvent dans les domaines de pointe propres à la recherche universitaire, l’OQLF dit que les « modalités d’application d’une politique de l’emprunt linguistique peuvent différer selon qu’il s’agit de la langue commune ou de la langue de spécialité » (OQLF, 1980, p. 235). La France et le Québec Les anglicismes critiqués du Québec ont peu de choses à voir avec les anglicismes que l’on peut trouver en France. Les spécialistes vous diraient peut-être que les anglicismes du Québec avaient peu de choses à voir avec ceux qui ont cours en France, car la situation française change, mais nous nous en tiendrons ici à la première affirmation. En France, le sentiment de sécurité linguistique des gens qui parlent français est différent du nôtre, et on semble y pratiquer beaucoup plus l’emprunt direct à l’anglais qu’au Québec. En France, on utilise couramment les termes shopping, parking, week-end, e-mail, etc., et ce, tant dans les conversations familières que dans les communications officielles. Au Québec, en revanche, tout emprunt direct à l’anglais est suspect. Dans les communications soignées, on tente d’éliminer tout mot à consonance anglaise, quitte à faire parfois des... fautes de français ou à se priver d’un mot dont on a besoin pour parler clairement. Ainsi, pour désigner l’ensemble des marchandises d’un magasin et éviter l’emploi d’un mot anglais, on parlera fautivement d’*inventaire alors qu’il faudrait utiliser le nom stocks, l’inventaire ne désignant que « le dénombrement (d’articles, de marchandises, etc.) et le document qui en résulte » (Multi, p. 808). Au Québec, on emprunte peu directement à l’anglais, mais davantage de façon inconsciente. On commet plutôt des anglicismes sémantiques et des anglicismes syntaxiques (voir le paragraphe sur les « Types d’anglicismes »), car la réalité linguistique québécoise est différente de la réalité linguistique française. Ainsi, tel dirigeant sera content de *nous introduire son épouse (au lieu de nous la présenter), telle chanteuse *sera sous l’impression qu’elle avait la faveur du public (alors qu’elle devrait en avoir l’impression), tel journaliste nous dira que les médecins sont *sur appel (alors qu’ils sont de garde). Ces personnes croient, en toute bonne foi, parler un français correct, mais leur usage de cette langue subit, bien contre leur gré, la pression des structures anglaises sur les structures françaises. Vigilance ou laisser-aller? Faut-il se préoccuper de cette situation? Selon Maurice Pergnier (1989), il faut réagir, car, à moins d’un « bouleversement violent de l’équilibre mondial » (p. 11), la suprématie de l’anglais sur les autres langues est un phénomène qui va s’amplifier et qui aura pour conséquence une « forte imprégnation des lexiques et de l’ensemble des structures de ces langues par des apports anglais » (p. 11). Cette imprégnation des structures constitue « le stade ultime de déstabilisation au-delà duquel c’est l’existence même de cette langue qui est en péril » (p. 93). Sans tomber dans un alarmisme paralysant et sans aller contre une certaine évolution de la langue, il faut chercher, chaque fois qu’on s’exprime, à penser directement en français, et non à traduire de l’anglais. Pergnier déplore avec raison qu’« on ne rédige plus le message en fonction de son contenu, mais en fonction de l’étalon linguistique anglais » (p. 102). Anglicismes en transition Que ce soit en France ou au Québec, la langue évolue. Les anglicismes traités dans les exercices de cette section constituent des impropriétés. Cependant, quelques-unes de ces impropriétés se situent actuellement dans des zones dites de transition, en ce sens qu’elles sont maintenant consignées dans Le petit Larousse illustré, et à l’occasion dans Le Petit Robert, accompagnées de la remarque « emploi critiqué ». Comme d’autres mots ou d’autres sens de certains mots, certains de ces anglicismes pourraient un jour être pleinement acceptés dans le bon usage, et les lexicographes, c’est-à-dire les auteurs de dictionnaire, laisseraient alors tomber le commentaire « emploi critiqué ». C’est le cas, par exemple, du verbe réaliser, passé maintenant dans l’usage au sens de « se rendre compte, comprendre », sens qu’il n’avait pas avant. L’adjectif drastique, au sens de « draconien, radical », a aussi été récemment accepté par Larousse et par Robert. Il est décrit sans aucune mention, après avoir longtemps été précédé de l’expression « emploi critiqué ». L’usage a donc retenu ce nouveau sens. Vous pouvez ainsi vous amuser à suivre le sort de certains mots au fil des rééditions des dictionnaires. À surveiller : alternative (au sens de solution de rechange), initier (au sens de lancer, instaurer, entreprendre), etc. Types d’anglicismes Les emprunts à l’anglais sont multiples et peuvent se classer selon la typologie suivante inspirée de l’« Énoncé d’une politique relative à l’emprunt de formes linguistiques étrangères » (OQLF, 1980), de Gilles Colpron (1982) et de Marie-Éva de Villers (2003). L’anglicisme lexical est l’« emploi d’une unité lexicale originaire de l’anglais avec ou sans adaptation phonétique, graphique ou morphologique » (de Villers, 2003). Cet emprunt à l’anglais peut être nécessaire, comme nous l’avons vu précédemment (design, marketing, coroner, bermuda, t-shirt, bobsleigh, etc.), parce que le français n’a pas d’autre mot pour désigner la réalité en question. L’emprunt peut aussi être inutile (*waitress au lieu de serveuse, *brake au lieu de frein, *break au lieu de pause, *tip au lieu de pourboire, *switcher au lieu de remplacer ou d’échanger, uploads/s3/ anglicismes.pdf
Documents similaires


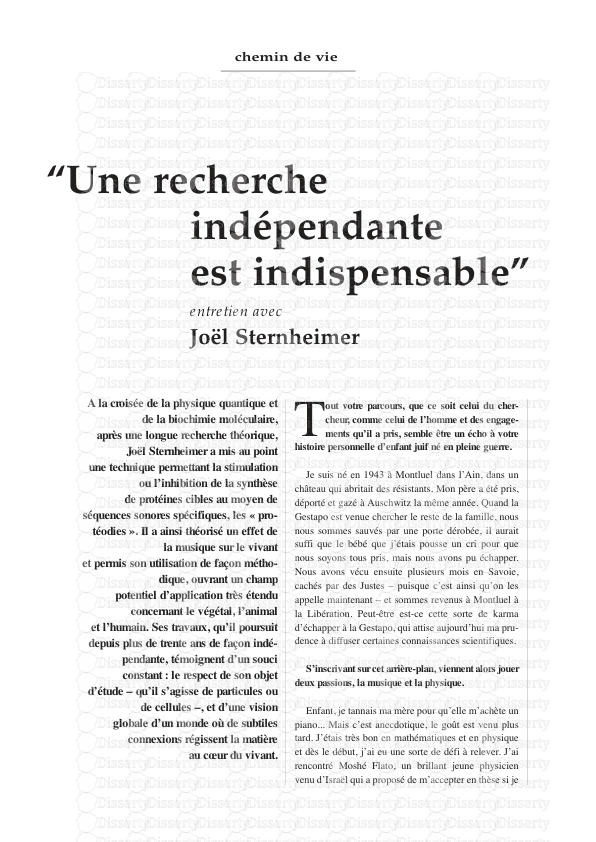







-
110
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 04, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.6398MB


