Bohèmes 1 Chantée, filmée, versifiée, exaltée, cent fois déclarée morte et touj
Bohèmes 1 Chantée, filmée, versifiée, exaltée, cent fois déclarée morte et toujours renaissante, la « bohème » fait partie des mythes modernes. Née au milieu du XIXe siècle, entre Romantisme et Réalisme, elle accompagne une profonde transformation du statut de l’artiste. Désormais, le jeune talent ne se place plus sous la protection de quelque prince : il est ce génie solitaire, misérable et incompris qui anticipe les convulsions de la société. Des poètes (Baudelaire, Rimbaud, Verlaine…), aux artistes (Courbet, Van Gogh, Satie, Picasso…) nombreux sont les grands hérauts de la modernité qui ont donné un visage à ce phénomène. Rebelles à toute convention, batteurs de pavé, mangeurs de vache enragée, amateurs de femmes et de boissons ils ont, pour des générations d’apprentis artistes, allumé le rêve d’une gloire rédemptrice, qui ne se gagne qu’au risque de l’oubli et de la mort. A travers la littérature et la presse, le théâtre et l’opéra, la bohème a très vite acquis une popularité immense ;; elle a pénétré l’imaginaire collectif, et lié à jamais l’image de Paris au Quartier latin et à Montmartre. Depuis une vingtaine d’années, des travaux portant sur l’histoire des marginalités, des migrations et des nomades ont renouvelé l’analyse de ce phénomène. Le mythe de la bohème s’inscrit désormais dans l’histoire, infiniment plus riche et plus complexe, du rapport des peuples européens à la nation rom. Appelé Égyptien à l’époque classique, puis désigné des noms les plus divers, gitans, manouches, cagots, le bohémien devient, peu après son apparition en Occident au XVe siècle, un héros de roman (Cervantes le premier) et un sujet de prédilection pour les artistes (Callot, Vouet, Georges de la Tour). Le mystère de ses origines, son langage longtemps incompréhensible, son rapport intime à la nature, sa capacité de dire l’avenir, en font un personnage de légende. Ses apparitions et disparitions soudaines alimentent le fantasme d’une vie sans attaches, sans règles, intense et sensuelle. L’artiste, fasciné, a trouvé en lui son maître en liberté. Bohémiens et bohèmes ont dès lors partie liée. Figures de la liberté, de l’errance, ils partagent marginalité et misère. Insaisissables, habiles, initiés à d’inaccessibles secrets, définitivement irréductibles à la norme, ils troublent, provoquent et enchantent notre société sédentaire. C’est au même vocable de bohémien que l’on a recours pour désigner la vie de bohème naissante. C’est un même emblème de liberté irrépressible que le régime nazi veut Bohèmes 26 septembre 2012 - 14 janvier 2013 Grand Palais entrée Clemenceau Cette exposition est organisée par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, Paris et Fundación Mapfre, Madrid. Elle sera présentée à Fundación Mapfre, Madrid du 6 février au 5 mai 2013 communiqué Vincent van Gogh, Chaussures (détail), septembre 1886, Amsterdam, van Gogh Museum © van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation) Bohèmes 2 abattre en visant les tsiganes et les artistes modernes. Par des mises en relation nouvelles autant que sur les croisements entre les disciplines (peinture, littérature, photographie, musique), en s’appuyant sur plus de deux cents œuvres alliant découvertes inédites et prêts exceptionnels (La Diseuse de bonne aventure, Georges de la Tour, Metropolitan Museum New York, L'Absinthe, Edgar Degas, musée d’Orsay, Paris, Coin à Montmartre, Vincent van Gogh, Van Gogh Museum, Amsterdam, La Gitane, Van Dongen, MNAM, Paris…), cette exposition ambitionne d’apporter un éclairage nouveau sur cette histoire commune. Servie par une scénographie de Robert Carsen qui, après le succès de Marie-Antoinette, revient au Grand Palais, Bohèmes est une exposition à vivre comme une expérience. Sur le long ruban de la route que l’on emprunte dès l’entrée, le visiteur traverse les siècles et croise les représentations les plus pittoresques du peuple errant. Puis il est admis dans l’univers du peintre, sa mansarde, son atelier, ses refuges, pour achever sa course dans les cafés de Montmartre. Lorsqu’au sortir du cabaret il reprend son chemin, le visiteur se trouve comme dégrisé devant l’inauguration de la salle tsigane à l’exposition Art dégénéré de Munich, en 1937. À travers un voyage de cinq siècles et une quinzaine de thèmes, Bohèmes éclaire un phénomène qui, de Léonard à Picasso, traverse toute l’histoire des arts et des sociétés, et résonne encore dans notre monde contemporain. Comme l’opéra de Puccini, cette exposition se veut un grand rendez-vous populaire, mêlant la fantaisie et la gravité, le spectacle et la mélancolie, la misère et la gloire. ............................ commissaire : Sylvain Amic, directeur des musées de Rouen scénographie : Robert Carsen ............................ contacts presse : Réunion des musées nationaux -Grand Palais 254 – 256 rue de Bercy 75577 Paris cedex 12 Florence Le Moing florence.lemoing@rmngp.fr 01 40 13 47 62 Julie Debout julie.debout@rmngp.fr 01 40 13 41 36 ouverture : tous les jours sauf le mardi de 10h à 20h, et nocturne jusqu’à 22h le mercredi. fermeture anticipée à 18h les 24 et 31 décembre. tarifs : 12 €, TR 8 € (13-25 ans) gratuit pour les demandeurs d’emploi grâce au soutien de la Macif, pour les bénéficiaires du RSA, du minimum vieillesse et les moins de 13 ans audioguides : français, anglais et version adaptée pour le jeune public en français location à l’entrée de l’exposition : 5 € téléchargement MP3 sur rmngp.fr : 3 € accès : métro ligne 1 et 13 « Champs- Elysées-Clemenceau » ou 9 « Franklin D. Roosevelt » renseignements et réservations sur www.rmngp.fr publications : catalogue de l’exposition, ouvrage collectif, sous la direction scientifique de Sylvain Amic, 384 pages, 45 € album de l’exposition par Florence Hudowicz, broché, 48 pages, 9 € le petit journal de l’exposition, écrit par Sabrina Dufourmont Éditions de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, Paris 2012 L'exposition est réalisée grâce au soutien de la Macif Bohèmes 3 communiqué p.1 press release p.5 pressemitteilung p.7 interview de Sylvain Amic, commissaire de l’exposition p.9 trois questions à Robert Carsen, scénographe de l’exposition p.14 textes des salles p.17 proverbes roms p.26 sélection de poèmes p.27 liste des œuvres exposées p.28 index des artistes exposés p.40 quelques notices d’œuvres p.42 extraits du catalogue de l’exposition p.46 le catalogue de l’exposition p.54 Bohèmes, la bande-son : visite sonore de l’exposition p.55 la visite guidée 360 ° p.56 le film de l’exposition p.57 la programmation culturelle autour de l’exposition p.58 informations pratiques p.62 liste des visuels disponibles pour la presse p.63 mécène de l’exposition p.71 partenaires médias p.72 sommaire Bohèmes 4 Bohème: Nom donné, par comparaison avec la vie errante et vagabonde des Bohémiens, à une classe de jeunes littérateurs ou artistes parisiens, qui vivent au jour le jour du produit précaire de leur intelligence […]. Mœurs, habitudes, genre de vie des mêmes individus […]. Un genre fantaisiste, désordonné et désargenté […]. Homme gai et insouciant, qui supporte en riant tous les maux de la vie. Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Pierre Larousse, 1867 Bohèmes 9 D’où vous est venue l’idée de l’exposition ? C’est un sujet sur lequel j’ai commencé à travailler quand je collaborais à l’exposition Gustave Courbet au Grand Palais en 2007. J’étais alors chargé de la jeunesse de Courbet, le Courbet romantique qui débute à Paris, le provincial qui lutte pour s’imposer dans la capitale, et qui établit son QG dans des cafés parisiens comme la brasserie des Martyrs. Tout à coup, je me suis trouvé plongé dans les Scènes de la vie de bohème d’Henry Murger, car les personnages qui ont servi de modèle pour le roman et ensuite l’opéra sont pour beaucoup issus de l’entourage de Courbet, que ce soit le philosophe Colline, inspiré par Marc Trapadoux, ou le musicien Schaunard, tiré d’Alexandre Schanne. C’est une période charnière, à la sortie du romantisme et au début du réalisme, où se met en place un nouveau statut pour l’artiste, qui va devenir la référence dominante. J’ai réalisé combien ce phénomène que l’on appelle la « vie de bohème » allait de pair avec cette transformation fondamentale. Ce n’est pas simplement une séquence pittoresque, quelque chose de l’ordre d’une bluette sentimentale, c’est en fait un processus d’émancipation si important qu’il va petit à petit acquérir un statut de mythe artistique. Quand il a fallu mettre un nom sur ce phénomène, regrouper ces artistes sous une bannière, c’est le mot de bohème qui est venu. On arrive donc très vite à la question du bohémien, qui en est indissociable, et on prend conscience alors de la profondeur du thème. Cette question de la quête de la liberté est aussi ancienne que l’art. Mais la porte d’entrée, c’est Courbet, qui est le premier artiste à se revendiquer bohémien, par bravade, mais aussi par conviction. Pourquoi Bohèmes, avec un « s » ? C’est un mot qui, dans un premier temps, a été utilisé pour désigner, disons très largement, une population errante menant une vie sans règle. Par extension, il est employé vers 1830 pour qualifier ces jeunes artistes qui tentent d’entrer dans la carrière par les marges, sans passer sous les fourches caudines de l’École des beaux-arts, du prix de Rome et de la villa Médicis. À partir du moment où ils choisissent une voie en dehors des sentiers battus, uploads/s3/ dp-bohemes 1 .pdf
Documents similaires









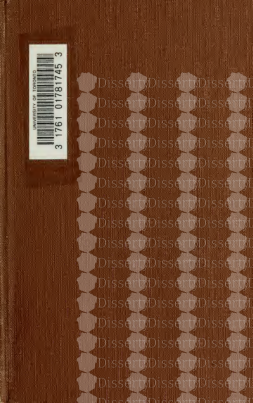
-
88
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 03, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.3094MB


