Entraînement à la dissertation Application de la méthode Parcours « Pensée et i
Entraînement à la dissertation Application de la méthode Parcours « Pensée et imagination » Œuvre : La Fontaine, Fables, livres VII à XI Le sujet La Fontaine s'interroge au début de sa fable "Le Pouvoir des fables" (VIII,4) : "La qualité d'ambassadeur/Peut-elle s'abaisser à des contes vulgaires ?". On peut prolonger cette interrogation en se demandant dans quelle mesure les fables et "autres contes vulgaires", pleins d'imagination, sont efficaces pour offrir au lecteur une pensée sur l'homme. Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur votre lecture des livres VII à XI des Fables de la Fontaine, mais aussi sur les autres textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours « Pensée et imagination», et sur votre culture personnelle. Comment aborder un sujet de dissertation ? Méthode : Il s’agit d’abord de bien comprendre le sujet et donc de l’analyser : On commence par repérer les mots-clés du sujet. On en cherche des synonymes, des antonymes, des définitions. S’appuyer sur l’étymologie peut être fructueux. La Fontaine s'interroge au début de sa fable "Le Pouvoir des fables" (VIII,4) : "La qualité d'ambassadeur/Peut-elle s'abaisser à des contes vulgaires ?". On peut prolonger cette interrogation en se demandant dans quelle mesure les fables et "autres contes vulgaires", pleins d'imagination, sont efficaces pour offrir au lecteur une pensée sur l'homme. Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur votre lecture des livres VII à XI des Fables de la Fontaine, mais aussi sur les autres textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours « Pensée et imagination", et sur votre culture personnelle. Intéressons-nous d’abord aux mots : contes et fables Les contes et les fables sont des apologues : des récits imaginés et inventés (donc fictifs) : ils s’appuient sur l’imagination Ils contiennent une leçon : ils ont donc une vocation didactique. Par conséquent, ils incitent à réfléchir et construire une pensée. Ils ont deux intentions liées : plaire (par le récit/l’imagination) pour instruire Il s’agit de « PLACERE et DOCERE », pour reprendre les principes du Classicisme. Que signifie l’expression « contes vulgaires » ? A priori, l’expression semble péjorative. Et les vers de La Fontaine nous conduisent dans cette direction : "La qualité d'ambassadeur/Peut-elle s'abaisser à des contes vulgaires ?". Ces contes, ces fables, sont-ils dignes d’un ambassadeur, d’un homme important ? Ne sont-ils pas seulement destinés aux enfants car chose peu sérieuse ? Ou au peuple ? L’étymologie du mot « vulgaire » est à considérer : Vulgus (latin) : peuple/ Vulgaire ; qui concerne le peuple Vulgariser : mettre à portée du peuple. En réalité, nous retrouvons ici une belle fonction des contes et fables : ils permettent de vulgariser une pensée, de la mettre à disposition de tous. Il s’agit donc de répandre des connaissances en les mettant à la portée du grand public. Cela nous rappelle le verbe « populariser » : mettre à disposition du peuple. Méfions-nous donc des vers de La Fontaine : il feint de considérer que ses fables ne sont pas dignes d’un ambassadeur. En réalité, c’est une fausse modestie de sa part… Intéressons-nous au mot « imagination » C’est la faculté que possède l'esprit de se représenter ou de former des images. Et la capacité de se représenter ce qui est immatériel ou abstrait. L’imagination permet donc de traduire : Une pensée (Nous sommes dans l’ordre de l’abstrait) en image (Nous sommes dans le concret). L’imagination permet de se représenter une idée. C’est un fonctionnement allégorique (représentation concrète de l’abstrait) et symbolique (puisqu’un symbole est notamment une image qui représente par association autre chose, par exemple une idée, une pensée). L’imagination fonctionne par analogie. Voilà par exemple une façon de mettre en image, de se représenter la justice. « La Cour du lion » Intéressons-nous au mot « pensée » Penser, c’est réfléchir, argumenter, douter, remettre en cause, raisonner, méditer, juger, combiner les idées.. « Pensée sur l’homme » : Il peut s’agir d’une réflexion politique, morale ou philosophique sur l’être humain. Étymologie. « Penser » vient du bas latin « pensare » (en latin classique : peser, juger) , fréquentatif du verbe « pendere » : peser. Cette idée de peser/soupeser/estimer/évaluer/apprécier est intéressante. Associons-la au verbe « réfléchir » : Etymologie. Réfléchir : reflectere « courber en arrière, recourber; ramener », en lat. médiév. « réverbérer (d'un miroir) » ca 1240 ds LATHAM, dér. de flectere « fléchir, ployer », préf. re- marquant le mouvement en arrière. Réfléchir, c’est bien faire un retour sur soi-même (introspectif et rétrospectif), c’est aussi porter un regard sur soi-même grâce au miroir réfléchissant/comparatif que propose l’apologue. La pensée est donc une forme de retour sur soi, de remise en cause que l’apologue permet en permettant des points de comparaison avec ses propres représentations, ses propres images. Voici tous les mots auxquels nous avons pensé pendant cette analyse des termes du sujet : Méthode : continuons notre analyse du sujet, et cela en observant les relations entre les mots : nous constatons qu’il contient une tension, une opposition. C’est souvent le cas. les fables et "autres contes vulgaires", pleins d'imagination offrir au lecteur une pensée sur l'homme. Le sujet nous rappelle évidemment le parcours étudié « Pensée et imagination » et nous incite à nous interroger sur cette apparente contradiction : L’imagination est-elle efficace pour produire une pensée ? Nous sommes confrontés à un paradoxe car apparemment ces deux termes/facultés ne sont pas compatibles. C’est pourquoi le sujet nous interroge sur l’efficacité de cette démarche : faire naître de l’imagination une pensée. Et donc au fond, le sujet nous interroge sur le fonctionnement des apologues : plaire pour instruire. Une astuce pour faire dialoguer les mots et donc les notions repérées et définies, c’est de les associer à des mots de liaison. Imagination et pensée Imagination sans pensée Imagination pour pensée Imagination donc pensée Imagination mais pensée … Ce petit jeu nous fait bien prendre conscience qu’il va falloir faire dialoguer ces termes et nous interroger sur leur compatibilité (ou pas)… Quelle est la forme/la construction du sujet qui nous est proposé? Essayons de reformuler La Fontaine s'interroge au début de sa fable "Le Pouvoir des fables" (VIII,4) : "La qualité d'ambassadeur/Peut-elle s'abaisser à des contes vulgaires ?". On peut prolonger cette interrogation en se demandant dans quelle mesure les fables et "autres contes vulgaires", pleins d'imagination, sont efficaces pour offrir au lecteur une pensée sur l'homme. Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur votre lecture des livres VII à XI des Fables de la Fontaine, mais aussi sur les autres textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours « Pensée et imagination", et sur votre culture personnelle. On part d’une citation de La Fontaine, extraite de sa fable « Le Pouvoir des fables » qui contient une tension : le fabuliste adresse une fable à un ambassadeur (quelqu’un d’important), OR la fable est un genre mineur. Une interrogative est indirecte est posée. Elle suggère un prolongement de la tension (du paradoxe, de la contradiction) soulevée par la Fontaine/Les fables liées à l’imagination sont-elles efficaces pour produire une pensée sur l’homme ? Les consignes qui suivent incitent à répondre à l’interrogation en cernant le corpus d’exemples utilisables (Les Fables de La Fontaine, et les textes étudiés dans le cadre du parcours. Donc des exemples issus du XVIIe siècle). Méthode Pour avancer dans notre examen du sujet, posons-nous à présent toutes les questions auxquelles nous pensons : Cela nous permettra de cerner la problématique. Cette phase importante au cours de laquelle on se pose une multitude de questions nous permettra sans doute de trouver des sous-parties lorsque nous en serons à la phase d'élaboration du plan. Toutes ces questions ne nous seront pas utiles mais elles nous permettent de faire naître des idées… En quoi la fable est-elle un genre mineur ? Indigne de certains ? Est-elle seulement destinée aux enfants ? Au peuple ? Au « vulgaire » ? Comment les auteurs de contes et fables ont-ils réagi face à ces condamnations ? Quelles sont sont les limites de la fable, et plus largement d’un apologue et donc d’une argumentation indirecte ? En quoi les termes « pensée » et « imagination » ne sont-ils pas compatibles ? Quelles sont les limites de l’imagination ? Que reproche-t-on à l’imagination ? Comment le mensonge, les faux semblants et les apparences sont-ils traités dans les fables ? Quels thèmes abordent les fables ? Pourquoi des animaux ? Pourquoi pourtant peut-on considérer que l’imagination est un précieux auxiliaire au service de la pensée ? Quels sont les avantages de l’imagination ? En quoi l’imagination est-elle un moyen de penser ? Comment La Fontaine incite-t-il son lecteur à penser ? Comment une fable permet-elle de penser ? Sur quels sujets fait-elle penser ? En quoi plaire permet d’instruire ? Comment la Fontaine cherche-t-il uploads/s3/ entrainement-a-la-dissertation-la-fontaine-pdf.pdf
Documents similaires

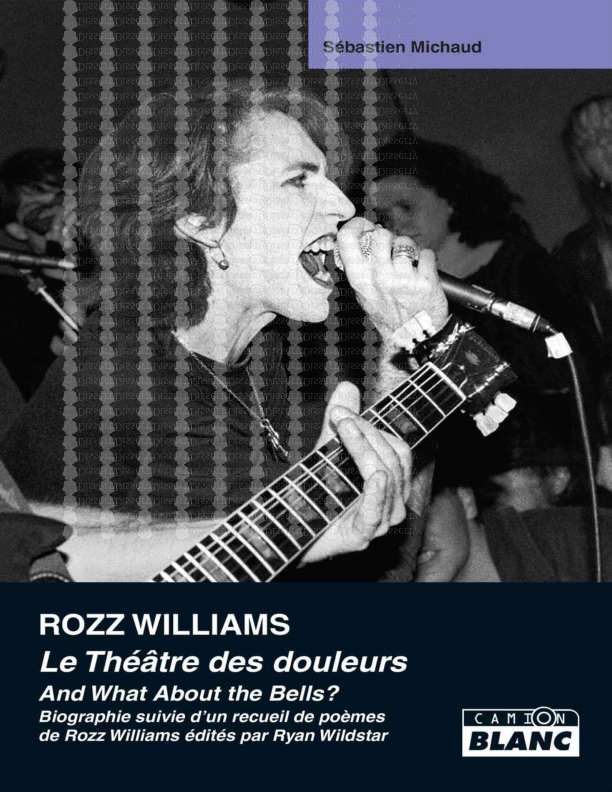




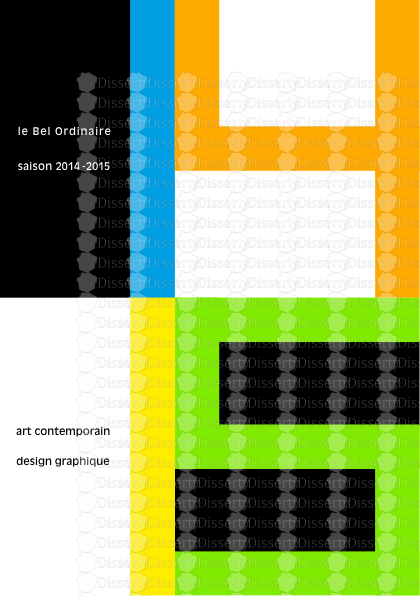



-
66
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 16, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.4101MB


