Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. — © Editions T .I. C 3 343 − 1 L ’espace visuel et son contrôle L ’environnement visuel par Jean-Jacques DAMELINCOURT Ingénieur ENSEEIHT Professeur émérite à l’université Paul-Sabatier (Toulouse) et Sabrina SOOBHANY Ingénieur en physique de l’habitat Chargée d’affaires au bureau d’études BEHI (Toulouse) Doctorante, université Paul-Sabatier (Toulouse) l est nécessaire de limiter la portée des notions que nous allons présenter même si, pour l’essentiel, elles restent valables dans la majorité des cas et, de toute façon, peuvent toujours servir de base à une réflexion. En effet, si les études et résultats d’expériences, si la pratique, ont conduit à édicter des règles, celles-ci ne sont valables que lorsque l’on veut protéger et/ou satisfaire la majorité des individus d’un groupe. Elles sont donc particulièrement adaptées aux cas des locaux industriels, commerciaux et, plus généralement, des locaux destinés à des groupes plus ou moins nombreux d’individus. Dans le cas de l’habitat individuel, si les conditions de la performance visuelle et les recommandations liées à l’hygiène visuelle restent en moyenne valables, la sensation d’agrément ou de situation optimale peut complètement différer d’un individu à l’autre. Ainsi, un individu particulier peut définir une stratégie visuelle qui serait considérée comme inacceptable pour un groupe parce que contradictoire, par exemple, avec les règles de l’hygiène visuelle. Ce premier dossier [C 3 343] concernant l’espace visuel intérieur et son contrôle sera suivi de : [C 3 344] L ’espace visuel et son contrôle – La tâche visuelle [C 3 345] L ’espace visuel et son contrôle – Panorama, liaisons [Doc. C 3 346] L ’espace visuel et son contrôle – Pour en savoir plus (bibliogra- phie générale sur le sujet et réglementation) Le lecteur s’y reportera pour de plus amples renseignements. 1. Modes d’appropriation de l’espace visuel intérieur....................... C 3 343 — 2 2. Luminances relatives, références, notion de blanc ....................... — 2 3. Lumières ..................................................................................................... — 3 4. Espace continu ou discontinu.............................................................. — 4 5. Ouvertures et vues vers l’extérieur ou prospect visuel ................ — 4 6. Couleurs, ombres et lumière ................................................................ — 4 6.1 Considérations générales sur le choix des couleurs ................................ — 5 6.2 Couleurs des parois..................................................................................... — 5 6.3 Ombres et lumières..................................................................................... — 6 7 . Équilibre performance, hygiène, agrément ...................................... — 7 8. Exemples d’influences indirectes sur le vécu de l’ambiance visuelle........................................................................................................ — 7 8.1 Situation de l’espace visuel, géographie, climat, architecture ................ — 7 8.2 Ambiance et place dans l’entreprise.......................................................... — 8 9. Essai de structuration de l’espace visuel ................................... — 8 I L’ESPACE VISUEL ET SON CONTRÔLE _______________________________________________________________________________________________________ Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie C 3 343 − 2 est strictement interdite. — © Editions T .I. 1. Modes d’appropriation de l’espace visuel intérieur C’est le système visuel, œil et cerveau, impressionné et informé par la lumière qui permet la perception de l’espace. Cette perception résulte de l’analyse et de la confrontation (entre elles et avec des situations mémorisées) d’une suite de fixations, 5 à 10 par seconde, procurant des images stables en fond d’œil. Pour chacune de ces images, seule une faible partie peut être analysée finement (1˚ d’angle environ autour de l’axe visuel). Au total, un champ central de 10 à 20˚ peut ainsi être analysé sans déplacement de la tête. Le reste du champ visuel ne peut être reconnu que s’il a été analysé antérieurement pour des positions différentes du regard et de la tête. À tout instant, le système visuel doit donc s’adapter à la quan- tité de lumière qu’il reçoit, à la nature de cette lumière et évaluer les distances et les positions des images perçues. Face à une situation nouvelle, l’individu construit, à partir des signaux lumineux issus de son environnement, une première image mentale. Cette image mentale servira de référence aux explorations visuelles ultérieures qui lui permettront de prendre en compte les modifications de son environnement et de faire évoluer cette pre- mière référence mentale. Tant que la perception et l’image mentale resteront compatibles, l’individu pourra s’approprier l’espace. Si un signal de « danger » ou un changement imprévu apparaissent, une réaction deviendra nécessaire qui mobilisera l’individu et changera son rapport à l’envi- ronnement. Si l’environnement évolue ou si l’individu se déplace dans son environnement, l’image mentale doit évoluer. Cette évolution devra se faire plus ou moins rapidement selon la conformation des locaux. Dans un grand espace, la perception de l’espace ne se modifie que lentement. Dans un local de petites dimensions, un simple change- ment d’attitude peut changer totalement le champ visuel. Compte tenu des temps d’adaptation et d’analyse du système visuel, on con- çoit que les rythmes de l’espace et du temps joueront un grand rôle dans l’appropriation de notre environnement. En réalité, les autres sens, l’ouie, l’odorat, la peau (sensible à l’ambiance thermique) participent grandement à cette appropria- tion. Cependant le système visuel est celui qui permet l’appropria- tion la plus précise de l’espace. Selon les psychologues, l’espace est appréhendé selon trois modes différents, le mode topologique, le mode projectif, le mode euclidien. ■Le mode topologique est le plus simple et le plus général, le pre- mier perçu par le très jeune enfant. L ’espace est fermé ou ouvert, continu ou discontinu, intérieur ou extérieur. L ’individu organise mentalement cet espace et y définit des zones où peuvent se passer différents phénomènes : la zone intime, tou- chable sans déplacement du corps, la zone sécurisante ou d’évolu- tion libre, la zone supputable pour laquelle les informations reçues du système visuel ne peuvent être directement vérifiées. On parle aussi de bulles. On rencontre successivement : — une bulle intime qui correspond à la longueur du bras ; toute irruption dans cette zone déclenche une réaction de défense ; — une bulle personnelle, zone des conversations particulières, qui s’étend environ à un mètre au-delà de la zone intime ; — une bulle sociale qui s’étend jusqu’à environ trois mètres ; — une bulle, ou plutôt une distance de sécurité, qui est éga- lement à prendre en compte. Elle peut être considérée comme la distance pour laquelle une réaction de fuite ou de défense est possi- ble. On peut considérer qu’elle définit aussi la distance à partir de laquelle un visage doit pouvoir être perçu. Pour l’appropriation topologique, l’espace doit être stable et bien défini. L ’image de l’environnement doit se conserver dans le pas- sage de la position de travail visuel à la position de repos. ■Le mode projectif est celui qui permet au corps de se positionner, de se projeter dans l’espace à partir d’axes définis par l’axe du corps, la ligne passant par les deux yeux, la perpendiculaire aux deux droites précédentes. Cela définit les notions de haut, de bas, de droite, de gauche, d’avant et d’arrière. Comparée aux repères de l’espace, cette projection du corps permet le mouvement précis et l’action. Pour l’appropriation projective, l’orientation doit pouvoir se faire par rapport à des axes bien définis de l’environnement. ■Le mode euclidien concerne le mesurable ou, au moins, le com- mensurable. L ’unité de mesure n’est généralement pas une mesure officielle de longueur. Ce peut être la main, le bras, la taille humaine, voire le temps. De toute façon, un étalon susceptible de permettre l’appropriation dimensionnelle de l’espace. Peu précise hors de la sphère intime ou relationnelle, elle est très précise dans la zone où s’effectuent les gestes. Pour l’appropriation euclidienne, l’espace doit être suffisant pour assurer la liberté des mouvements. Visuellement, il ne doit pas paraître encombré (occupants, mobilier...). D’un point de vue visuel, l’appropriation de l’espace peut se décomposer en trois phases : une phase de balayage correspondant à un parcours visuel bien déterminé, une phase de fixation, une phase d’analyse. Après la phase de balayage de l’espace visuel ambiant, les deux dernières phases ne sont possibles qu’avec le sup- port d’un élément précis du champ visuel. Cet élément, sur lequel va s’effectuer la fixation, situé face à l’individu et différencié dans le plan d’accommodation ou plan focal, prend le nom d’objet focal. Cet objet focal peut être aléatoire mais, dans de nombreux cas, il sera souhaitable de le prédéterminer ou, du moins, de fournir des éléments qui pourront jouer ce rôle et soient compatibles avec l’acti- vité. L ’objet focal est nécessaire pour assurer la désaccommodation car l’accommodation spontanée en l’absence d’objet focal (accom- modation tonique) se réglerait à 80 cm environ. 2. Luminances relatives, références, notion de blanc Dans un local, par définition constitué de parois et d’objets, le schéma des luminances est perçu comme un schéma de contrastes ou de rapports de clartés. Or, dans notre expérience visuelle ordi- naire, ces rapports de clartés sont interprétés comme des rapports de facteurs de réflexion, de façon largement indépendante du niveau moyen de luminosité. Les rapports de luminances de surfa- ces pouvant conduire à une telle interprétation sont donc forcément limités. Lors de l’entrée dans un local, le système visuel choisit une réfé- rence de luminance par rapport à laquelle va se construire l’espace visuel. uploads/s3/ l-x27-espace-visuel-et-son-controle-l-x27-environnement-visuel-pdf.pdf
Documents similaires






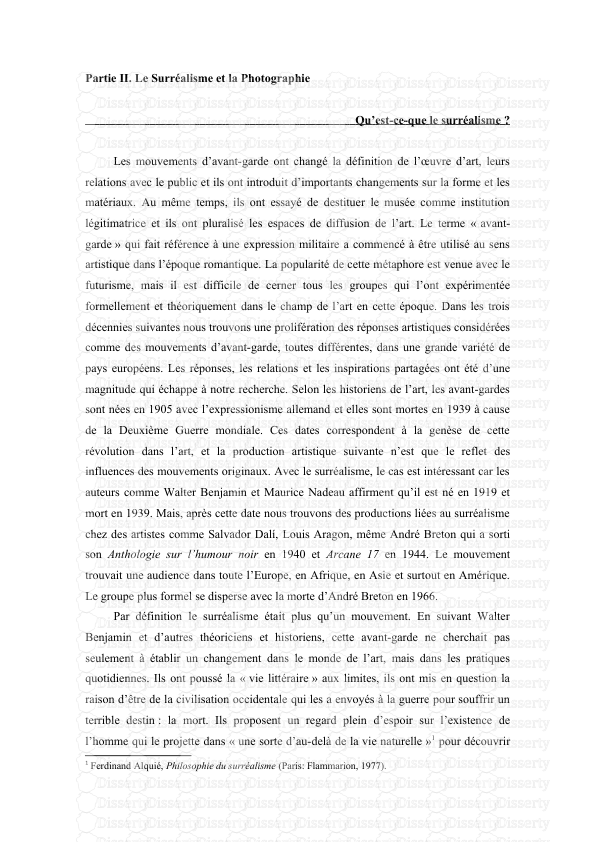



-
39
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 12, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2106MB


