Le Palimpseste --> traduction (provisoire) d'un texte d'Hakim Bey Nietzsche éta
Le Palimpseste --> traduction (provisoire) d'un texte d'Hakim Bey Nietzsche était sain d’esprit ; cela le conduisit à la folie. Charles Fourier était si fou qu’il parvint à une sorte de parfaite santé mentale. Nietszche exaltait le surhomme comme individu («aristocratie radicale»). Sa société d’esprits libres consistait en fait en une «union de ceux qui s’appartiennent». Fourier exaltait les Séries passionnées. Pour lui l’individu ne pouvait exister que dans l’Association Harmonique. Ces vues sont diamétralement opposées. Comment se fait-il alors que je les vois comme complémentaires, s’illuminant mutuellement, et toutes deux entièrement réalisables ? Une réponse pourrait être la «dialectique». Pour être plus précis, la «dialectique taoïste», qui n’est pas tant une valse qu’un shimmy (1) - subtile, serpentine et fractale. Une autre réponse pourrait être le «surréalisme» - comme une bicyclette faite de cœurs et de coups de foudre. L’«idéologie» n’est PAS une réponse, ce grand rassemblement de zombies, ce triomphalisme de fantômes à la parade. La «théorie» ne peut être assimilée à l’idéologie, pas même à l’idéologie-en-chantier, parce que la théorie s’est laissée dériver hors de toutes ces catégories, parce que la théorie n’est rien si elle n’est pas situationn(al)iste, parce que la théorie n’a pas abandonné le désir à l’«Histoire». Alors la théorie dérive, telle un nomade parmi les nomades d’Ibn Khaldun, tandis que l’idéologie demeure rigide et immobile afin de construire des cités et des impératifs moraux ; la théorie peut être violente, mais l’idéologie est cruelle. La «civilisation» ne peut pas exister sans l’idéologie (le calendrier est sans doute la première idéologie) parce que la civilisation naît de la concrétisation de catégories abstraites plutôt que de poussées «naturelles» ou «organiques». Pourtant, paradoxalement, l’idéologie n’a pas d’autre objet qu’elle-même. L’idéologie justifie tout et n’importe quoi, sanglante expiation ou cannibalisme ; elle sacrifie l’organique afin justement de parvenir à l’inorganique - le «but» de l’Histoire - qui, en fin de compte, se révèle être... l’idéologie. La théorie, au contraire, refuse d’abandonner le désir, et parvient de ce fait à une objectivité véritable, un mouvement au-dehors d’elle-même qui est organique et «matériel» et s’oppose de façon cognitive à l’altruisme factice et à l’aliénation de la civilisation (sur ce point, Fourier et Nietzsche sont à peu près d’accord). Pour terminer cependant, je proposerai ce que j’appelle une théorie palimpsestique de la théorie. Un palimpseste est un manuscrit qui a été ré-utilisé en écrivant par-dessus l’écriture originaire, se superposant souvent à angles droits avec, et parfois plusieurs fois. Fréquemment il est impossible de dire quelle strate fut la première inscrite ; dans tous les cas tout «développement» (sauf dans l’orthographe) de strate en strate est un pur accident. Les connections entre les strates ne se succèdent pas dans le temps ; elles se juxtaposent dans l’espace. Des lettres de la strate B peuvent masquer des lettres de la strate A, ou vice versa, ; elles peuvent encore laisser des zones vierges sans aucune marque, mais on ne peut pas dire que la strate A «se développe» dans la strate B (nous ne sommes même pas sûrs de savoir laquelle est la première.) Et pourtant ces juxtapositions ne peuvent être simplement «dûes au hasard» ou «sans signification». Une connection possible pourrait traîner au royaume de la bibliomancie surréaliste, ou «synchronisme» — et ainsi que le disaient les Cabalistes de l’ancien temps, les espaces blancs entre les lettres pourraient bien «signifier» plus que les lettres elles-mêmes. Même le «développement» peut fournir un modèle possible de lecture — On peut émettre des hypothèses sur les diachronismes, composer une «histoire» pour le manuscrit, dater les strates comme dans des fouilles archéologiques. Tant que nous ne vouons pas un culte au «développement», nous pouvons toujours l’utiliser comme une structure possible pour élaborer nos théories. La différence entre un manuscrit palimpseste et une théorie palimpseste est que la seconde n’est jamais fixée. Elle peut être réécrite — réinscrite — à chaque nouvelle strate de concrétion. Toutes les strates sont transparentes, translucides, sauf lorsque des groupes d’inscriptions bloquent la lumière cabalistique — comme si un faisceau d’animation se figeait. Toutes les strates sont «présentes» à la surface du palimpseste — mais leur développement ( y compris leur développement dialectique) est devenu «invisible», peut-être même «hors sens». Cette théorie palimpsestique de la théorie ne pourra échapper à l’accusation d’appropriationnisme subjectif et chapardeur — une pointe de critique ici, une louche de proposition utopique là — mais notre plaidoyer devra consister dans cette revendication que nous ne sommes pas à la recherche d’ironies délicieuses mais d’explosions de lumière. Si vous êtes assoiffés de Déconstruction PoMo (2) ou d’hyperconformisme narquois, retournez à l’école, trouvez-vous un boulot — nous avons d’autres chats à fouetter. Ainsi, nous construisons un système épistémologique — une manière d’apprendre et de savoir basée sur la juxtaposition d’éléments théoriques plutôt que sur leur développement idéologique, un système anhistorique en un sens. Nous évitons également d’autres formes de linéarité, telles que la séquence logique ou l’exclusion logique. Si nous admettons l’histoire dans ce procédé, c’est simplement pour l’utiliser comme une forme de juxtaposition de plus, sans la fétichiser comme un absolu — la même chose est vraie pour la logique, etc. Cette approche ludique de la théorie ne devra pas être confondue avec le «relativisme moral» (la dévaluation des valeurs) ; elle en est sauvée par notre «téléologie subjective». C’est-à-dire que nous (et non pas l’«histoire») sommes à la recherche d’usages, de buts, d’objets-de-désir (la réévaluation des valeurs). La nature enjouée de cette action provient du déploiement de l’imagination (ou de l’«Imagination Créatrice» ainsi que l’appellent H. Corbin et les soufis) — elle provient également de la discipline visionnaire de la «paranoïa critique» (S. Dali), de la réévaluation subjective des catégories esthétiques. «Le personnel est le politique». Juxtaposition, superposition et motifs complexes produisent donc une unité malléable (comme le monisme caché du polythéisme, plutôt que comme le dualisme caché du monothéisme) — la paradoxologie comme méthode épistémique — quelque chose qui ressemblerait à la pataphysique ou à l’«épistémologie anarcho-dadaïste» de Feyerabend (Contre la Méthode). «Des insignes ? Nous n’avons pas besoin d’insignes puants ?» Maintenant j’aimerais pour ainsi-dire «lire entre les lignes du rapport officiel» de l’ensemble du débat théorético-historique sur l’«Art» comme catégorie séparée (un musée de fétiches) et comme une des sources de reproduction de la misère et de l’aliénation par l’exclusion des non-«artistes» des plaisirs de la créativité (ou «travail passionné» ainsi que l’appelle Fourier). Je veux signaler la proposition situationniste pour la «suppression et la réalisation de l’Art», i.e. sa suppression révolutionnaire comme catégorie et sa réalisation au niveau de la «vie quotidienne» (à savoir la vie plutôt que le spectacle). Cette proposition à son tour se base sur l’affirmation que l’art en fin de compte a échoué dans sa fonction d’«avant-garde» à peu près à l’époque où les surréalistes entrèrent au Parti Communiste — et simultanément, dans le «monde de l’art» musée/galerie du fétichisme de la marchandise — se convertissant ainsi à l’idéologie fallacieuse et à l’élitisme dans un bide spectaculaire. A ce moment-là, les débris de l’avant-garde démarrèrent un processus de tentative de retrait de l’idéologie et de la marchandisation (qui se poursuit plus ou moins depuis dada à Berlin) : lettrisme, situationnisme, No-Art, Fluxus, mail art, neoisme... — processus dans lequel l’emphase glissa de l’avantgardisme à un décentrement radical de la pulsion créatrice, loin des galeries et des musées et des enclaves du privilège bohème — vers la disparition de l’«Art» et la réapparition du créatif dans le social. Bien entendu, les musées font aujourd’hui main basse sur ces «mouvements» eux aussi, comme pour prouver que tout — même l’«anti-Art» — peut devenir marchandise. Chacun de ces mouvements post-avant-garde a été, à un moment ou à un autre, en proie à la confusion ou à la tentation, et a essayé de se comporter comme l’une des avant-garde classiques, et chacun a échoué, de même qu’échoua le surréalisme, à libérer l’œuvre d’art de son rôle de marchandise. Par conséquent le monde de l’art a mangé et digéré la théorie de l’art qui devait — si on la prenait au sérieux — provoquer son autodestruction. Les galeries prospèrent (ou au moins survivent) sur un nihilisme qui ne peut être contenu que par l’ironie, et qui sans cela rongerait et ferait fondre jusqu’aux murs des musées. Cet essai, par exemple, sera imprimé dans le catalogue d’une exposition dans une galerie, perpétuant ainsi l’ironie qu’il y a à appeler à la suppression et à la réalisation de l’art depuis l’intérieur de la structure même qui perpétue l’aliénation du non-artiste et la fétichisation de l’œuvre d’art. Et bien, merde à l’ironie. On peut seulement espérer que chaque compromis sera le dernier. Ceux qui n’arrivent pas à éprouver le malaise de cette situation arrêteront là leur lecture. La théorie a bien assez à faire sans avoir à expliquer sa propre nausée... ad nauseam. La fascination du 20ième siècle pour le «primitif» et pour le «naïf» sert de mesure, tout d’abord à l’épuisement de l’«Histoire de l’Art» et deuxièmement au désir utopique d’un art qui ne serait pas uploads/s3/ le-palimpseste-hakim-bay-ii.pdf
Documents similaires






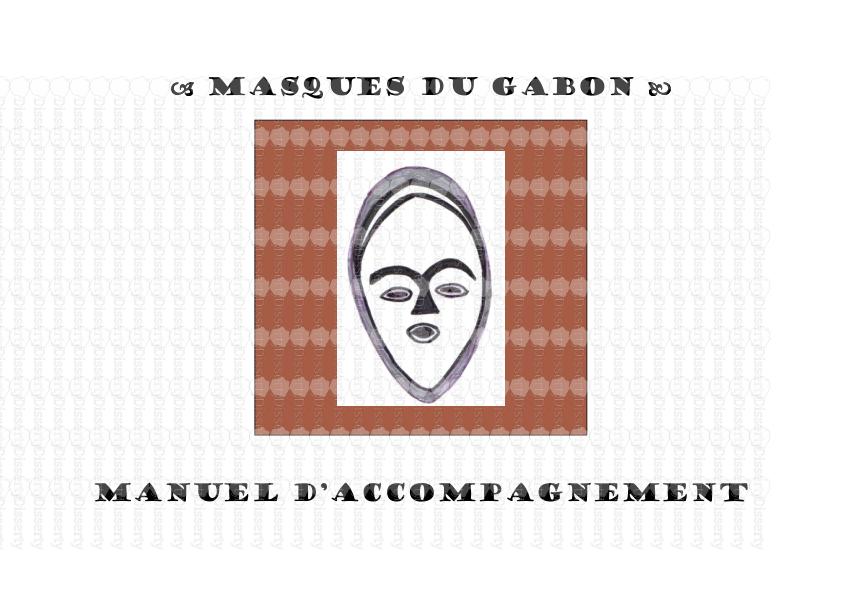

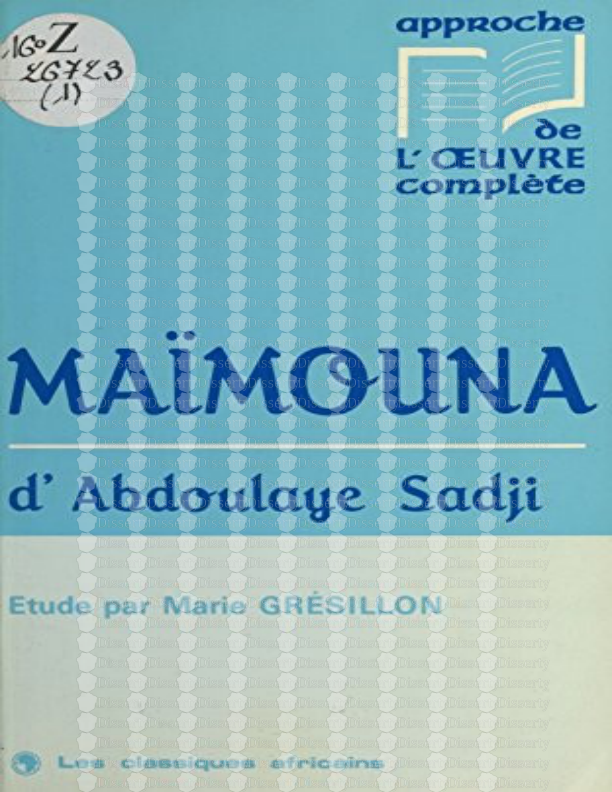

-
94
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 13, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1390MB


