FORME © Encyclopædia Universalis France Page 1 sur 65 FORME Prise de vue L'hist
FORME © Encyclopædia Universalis France Page 1 sur 65 FORME Prise de vue L'histoire du concept de forme et des théories de la forme est des plus singulières. Nous vivons dans un monde constitué de formes naturelles. Celles-ci sont omniprésentes dans notre environnement et dans les représentations que nous nous en faisons. Et pourtant, jusqu'à une époque récente, on ne disposait d'aucune science morphologique à proprement parler. Ce n'est que vers la fin des années 1960 qu'on a commencé à comprendre de quel concept de naturalité et d'objectivité l'on fait usage lorsqu'on parle de formes naturelles objectives. Jusque-là, un insurmontable obstacle épistémologique (au sens de Bachelard) faisait obstruction à une telle compréhension. La raison en est d'ailleurs assez simple. Tenter de développer une théorie objective (donc compatible, sinon réductible, à des contenus physiques) des formes, c'est chercher à généraliser l'objectivité physique en direction d'une « ontologie qualitative ». Or, d'une façon ou d'une autre, toute ontologie qualitative est néo-aristotélicienne. Mais, précisément, le concept moderne d'objectivité physique s'est édifié à partir d'un concept mécaniste (galiléen-newtonien) qui rompait avec la tradition aristotélicienne (ce que l'on a appelé la « coupure épistémologique »). Le développement physico-mathématique d'une mécanique des forces a, pendant environ trois siècles, totalement fait écran à toute dynamique des formes. La conséquence en a été que le concept de forme a été pensé de façon alternative. L'impossibilité où l'on croyait être d'en théoriser les aspects objectifs a conduit à en théoriser les aspects subjectifs. Tel a été le cas dans les approches psychologiques (de la Gestalt-théorie aux sciences cognitives contemporaines), dans les approches phénoménologiques (de Husserl à Merleau-Ponty et aux reprises actuelles de certains thèmes husserliens) ou dans les approches sémantiques et sémio-linguistiques. Ainsi s'est installée l'évidence (fallacieuse) d'un conflit irréductible entre une phénoménologie des formes et une physique de la matière. Ce n'est qu'à une époque récente qu'on a commencé à comprendre les processus permettant à la matière de s'organiser et de se structurer qualitativement en formes. FORME © Encyclopædia Universalis France Page 2 sur 65 I - Forme et phénomène Nous ne traiterons de façon systématique ni de l'histoire métaphysique du concept de forme depuis Aristote, ni de ses innombrables usages disciplinaires en logique, en linguistique, en sémiotique structurale, en esthétique et dans les sciences humaines en général. Nous nous restreindrons au problème de la compréhension théorique des formes naturelles. Ces formes sont innombrables, physico-chimiques (cristaux, flammes, turbulences, nuages, réactions chimiques oscillantes, ondes chimiques, transitions de phases, défauts dans les cristaux liquides, etc.) ou biologiques (plantes, animaux, etc.). Avant de chercher à en penser le statut objectif, il est bon de les décrire comme de purs . phénomènes Description phénoménologique Les formes naturelles se manifestent. Elles sont des constituants fondamentaux de la façon dont le monde externe nous apparaît. Pour en donner une description phénoménologique en tant que données originaires, on peut préciser des descriptions déjà proposées par Husserl et les premiers gestalt-théoriciens (Stumpf, Meinong, von Ehrenfels...). Une forme sensible F donnée dans l'espace extérieur E occupe une certaine portion W de E (nous prenons des notations qui nous seront utiles plus bas). Ce domaine d'occupation – que Husserl appelait le « corps spatial » de la forme – est limité par un bord B = ∂W. Il est en outre rempli par des qualités sensibles , ..., , les biens connues « qualités secondes » de la tradition q 1 q n philosophique, qualités s'opposant à la « qualité première » qu'est l'extension spatiale. Mais il doit l'être d'une façon telle que l'extension ainsi qualifiée manifeste une certaine saillance phénoménologique permettant à la forme d'être appréhendée et saisie perceptivement, c'est-à-dire au phénomène de se détacher comme phénomène. Ici, c'est le concept de discontinuité qualitative qui est fondamental. Il a été très bien exposé par Husserl dans la troisième , texte qu'on peut à bon droit considérer, avec K. Mulligan et Recherche logique B. Smith, comme « la plus importante contribution à une ontologie réaliste [aristotélicienne] à l'époque moderne ». L'opposition fondamentale est celle entre, d'un côté, les qualités sensibles localement « fusionnées » intuitivement (le concept de fusionnement, , est dû à Carl Stumpf), c'est-à-dire « fondues » avec les qualités locales Verschmelzung voisines, et, d'un autre côté, les qualités sensibles localement « séparées » intuitivement, c'est-à-dire « se détachant », « se scindant », « se séparant » des qualités locales voisines FORME © Encyclopædia Universalis France Page 3 sur 65 par une « délimitation ». Si l'on traite les qualités sensibles comme des grandeurs intensives possédant un degré, alors l'opposition entre fusionnement et détachement devient celle entre continuité et discontinuité : le fusionnement correspond à une variation continue du degré de la qualité considérée, tandis que le détachement correspond au contraire à une variation discontinue. L'idée est donc que l'extension spatiale W de la forme F contrôle la variation des qualités sensibles qui la remplissent. Il y a toujours variation continue dans W mais, à la q i traversée de limites (de discontinuités), certaines qualités peuvent varier discontinûment. Ainsi que l'affirme Husserl : « C'est à partir d'une limite de l'espace [...] que l'on saute d'une qualité à une autre. Dans ce passage continu d'une partie d'espace à une autre partie d'espace, nous ne progressons pas d'une manière également continue dans la qualité qui les recouvre, mais [...] à un endroit de l'espace les qualités limitrophes ont un écart fini (et pas trop petit) » (Husserl, p. 29 [1969]). Notons K l'ensemble des discontinuités qualitatives ainsi définies dans W. Avec le bord B = ∂W, K est la caractéristique morphologique essentielle de la forme F : ce qui fait que le substrat matériel occupant l'extension W est une forme est qu'il est qualitativement structuré et organisé par les « accidents » morphologiques (B, K). On remarquera que cette morphologie est constituée de bords : bords délimitant W de l'extérieur, bords délimitant des catégories différentes de qualités. Nous avons jusqu'ici supposé que W était un domaine spatial et F une forme statique. Si on introduit le temps, W devient un domaine de l'espace-temps et on peut alors considérer des formes évoluant dynamiquement et soumises à des processus de morphogenèse. Au cours de tels processus, les bords B et K peuvent évoluer et subir des événements les transformant qualitativement (cf., par exemple, l'embryogenèse). De façon plus générale, on peut considérer que W n'est pas l'extension spatio-temporelle d'un objet mais un espace de paramètres de contrôle permettant d'agir w i sur un système S. À la traversée de certaines valeurs – dites critiques – des , le système S w i peut subir des transformations brusques d'état interne. Tel est le cas des phénomènes critiques comme les phénomènes thermodynamiques de transitions de phase. Nous y reviendrons. Description « catastrophiste » FORME © Encyclopædia Universalis France Page 4 sur 65 Ainsi, qu'il s'agisse de formes sensibles, spatio-temporelles ou de formes plus abstraites dans des espaces de contrôle, une forme se trouve phénoménologiquement décrite comme un ensemble de discontinuités qualitatives sur un espace substrat. Cette idée a été formalisée par . Soit W un espace substrat rempli de qualités sensibles (de René Thom grandeurs intensives) ( ). Thom distingue phénoménologiquement deux types de points q i w w ∈ W. On dit que est régulier s'il existe un voisinage de où les varient continûment. Par w w q i définition, les réguliers engendrent un ouvert U de W. Si ∈ U, le substrat est w w qualitativement homogène localement en . Les points non réguliers ∉ U sont dits w w singuliers ou « catastrophiques ». Ils engendrent le fermé K de W complémentaire de U dans W. Si ∈ K, le substrat est qualitativement hétérogène localement en . K définit le substrat w w comme forme et comme phénomène. Toute la question est alors d'en comprendre la genèse physique. Telle est l'ambition de la « théorie des catastrophes ». Nous y reviendrons. II - La disjonction transcendantale entre phénoménologie et physique Le concept général de forme que nous venons de définir peut évidemment être considérablement complexifié. Les morphologies K ne possèdent pas nécessairement de géométrie simple. Elles peuvent être chaotiques, et même fractales. Elles peuvent être structurées à plusieurs niveaux – à plusieurs échelles – différents. Mais, aussi compliquées soient-elles, elles ne sont pour l'instant définies que de façon purement phénoménologique. C'est dire qu'elles constituent une interface entre le sujet percevant et le monde extérieur et que la question de leur nature n'est pas encore posée. Si on les pense « côté sujet », on cherchera à les théoriser comme des constructions psychologiques. Si on les pense « côté objet », on cherchera au contraire à les théoriser comme des structures qualitatives émergeant de l'intériorité substantielle de la matière. Or c'est précisément cette dernière voie qui a été barrée par le triomphe du mécanisme aux et siècles. Si la physique de la matière se réduit à une mécanique de points XVIIe XVIIIe matériels en interaction, alors le concept de forme perd tout contenu ontologique. Cela est déjà manifeste chez uploads/s3/ phi-article-universalis-forme-pdf.pdf
Documents similaires









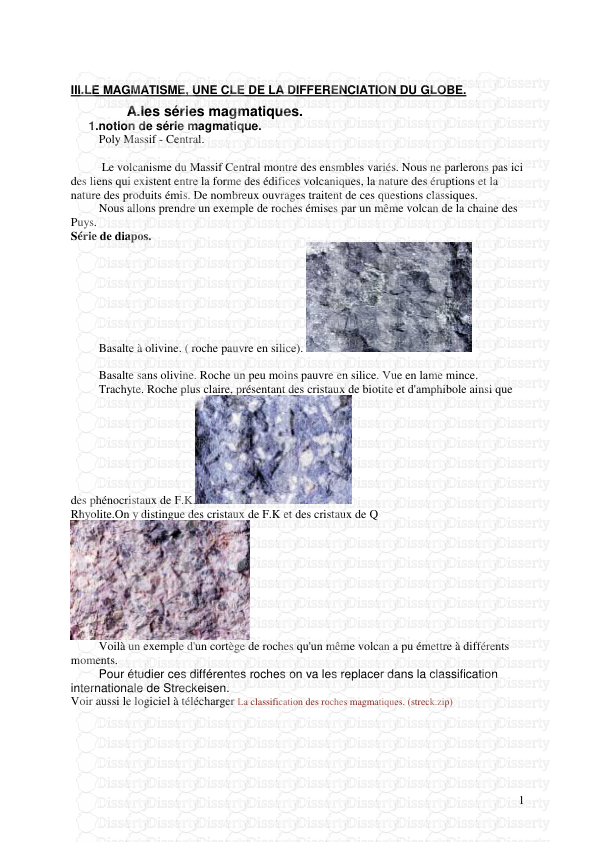
-
91
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 16, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3510MB


