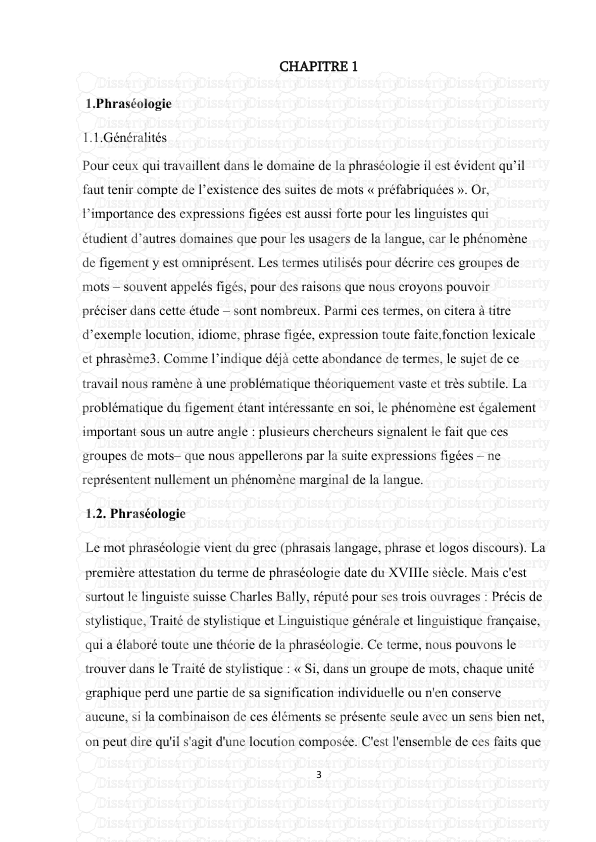CHAPITRE 1 1.Phraséologie 1.1.Généralités Pour ceux qui travaillent dans le dom
CHAPITRE 1 1.Phraséologie 1.1.Généralités Pour ceux qui travaillent dans le domaine de la phraséologie il est évident qu’il faut tenir compte de l’existence des suites de mots « préfabriquées ». Or, l’importance des expressions figées est aussi forte pour les linguistes qui étudient d’autres domaines que pour les usagers de la langue, car le phénomène de figement y est omniprésent. Les termes utilisés pour décrire ces groupes de mots – souvent appelés figés, pour des raisons que nous croyons pouvoir préciser dans cette étude – sont nombreux. Parmi ces termes, on citera à titre d’exemple locution, idiome, phrase figée, expression toute faite,fonction lexicale et phrasème3. Comme l’indique déjà cette abondance de termes, le sujet de ce travail nous ramène à une problématique théoriquement vaste et très subtile. La problématique du figement étant intéressante en soi, le phénomène est également important sous un autre angle : plusieurs chercheurs signalent le fait que ces groupes de mots– que nous appellerons par la suite expressions figées – ne représentent nullement un phénomène marginal de la langue. 1.2. Phraséologie Le mot phraséologie vient du grec (phrasais langage, phrase et logos discours). La première attestation du terme de phraséologie date du XVIIIe siècle. Mais c'est surtout le linguiste suisse Charles Bally, réputé pour ses trois ouvrages : Précis de stylistique, Traité de stylistique et Linguistique générale et linguistique française, qui a élaboré toute une théorie de la phraséologie. Ce terme, nous pouvons le trouver dans le Traité de stylistique : « Si, dans un groupe de mots, chaque unité graphique perd une partie de sa signification individuelle ou n'en conserve aucune, si la combinaison de ces éléments se présente seule avec un sens bien net, on peut dire qu'il s'agit d'une locution composée. C'est l'ensemble de ces faits que 3 nous comprenons sous le terme général de phraséologie » (Bally, 1951, P. 65– 66.). Le terme « phraséologie » est traité de différentes façons dans les dictionnaires des langues différentes. Traiter de la phraséologie en tant que problème terminologique n'est pas une question nouvelle, mais les théories et les pratiques sont encore loin d'être unifiées. Le Nouveau Petit Robert par exemple présente la phraséologie sous la dénomination « Locution » qui est présentée comme « groupe de mots formant une unité et ne pouvant pas être modifié à volonté ». Les catégories suivantes sont ainsi classifiées : « locution adverbiale », « locution conjonctive », « locution prépositive », « locution adjective », « locution figurée », « locution familière » et « locution proverbiale » (Le Nouveau Petit Robert, 1993, Préface). La définition donnée par le Grand Larousse de la langue française dénomme la phraséologie comme une construction de phrase, ou procédé d'expression propre à une langue, une époque, à une discipline, à un milieu, à un auteur donné. (Grand Larousse, 1971). I. Des met définit la phraséologie comme une combinaison de lexèmes qui n'est ni complètement figée ni complètement libre et qui présente une certaine flexibilité et dont les composantes peuvent varier morphosyntaxiquement (Desmet, 1994). Z. Khovanskaia et L. Dmitrieva dans leur « Stylistique française » parlent de l'actualisation des unités phraséologiques. Les unités se distinguent des groupes de mots libres par leur stabilité, leur invariance formelle et leur reproduction en parole en tant que telles, référant à un objet ou un phénomène de la réalité. Cela veut dire que les unités phraséologiques font partie des groupes de mots figés qui se trouvent à la limite du lexique et de la syntaxe et mettent en évidence la relation réciproque de ces niveaux de langue qui se manifeste dans la transformation des groupes de mots libres en unités du vocabulaire. Tout d'abord nous allons examiner la spécificité des groupes de mots figés. « Un groupe de mots figé est une dénomination complexe toute faite qui s'emploie sans aucune modification d'ordre morphologique, syntaxique ou lexicale. Autrement dit, elle existe dans le système de la langue au même titre que les unités lexicales et fait 4 partie d'une classe finie de moyens d'expression constituant le vocabulaire dont le locuteur choisit une dénomination qui correspond le mieux à sa tache communicative, tandis que les groupes de mots libres se construisent à nouveau à chaque nouvel emploi, leur nombre est aussi infinie que celui des situations réelles. Leur construction obéit à des modèles bien déterminés tandis que leur contenu lexical est variable ». Les groupes figés du type phraséologique, qui nous intéressent en premier lieu, représentent d'habitude des moyens de dénomination secondaire, ce qui veut dire qu'ils ont des synonymes neutres désignant les mêmes objets ou phénomènes de la réalité. Les unités phraséologiques revêtent toujours un caractère imagé étant donné qu'elles résultent d'un changement de sens d'un de leurs éléments ou du groupe tout entier. Les expressions idiomatiques françaises Quelques aspects historiques propres d’un peuple ou d’une culture vivent de nos jours dans la mémoire des gens grâce aux expressions idiomatiques, qui se transmettent de génération en génération. Ces unités phraséologiques nous informent sur l’histoire ou les mœurs d’autrefois. Je présenterai par la suite quelques exemples d’expressions idiomatiques utilisées de nos jours, mais dont le contenu culturel est difficile à comprendre, car leur origine remonte au Moyen Âge et même bien avant. En ce qui concerne le français, les expressions idiomatiques en abondent. Elles font partie du patrimoine culturel et linguistique du pays, car elles se figent et perdurent dans le temps. Le français par exemple garde aujourd’hui des expressions du Moyen Âge, comme « de bon aloi », « rester sur le carreau », ou « sous le boisseau ». Des expressions qui renvoient à des situations quotidiennes que nous vivons aussi de nos jours. Par exemple, l’expression « tomber dans les pommes », qui est une expression très utilisée en France, pour indiquer un état de malaise, vient de l’expression « tomber dans les pâmes » qui remonte au XVème 5 siècle: En France, comme dans d’autres pays francophones (comme le Québec, quelques pays d’Afrique, la Belgique ou la Suisse), on utilise un langage très imagé pour décrire des situations courantes de tous les jours. Des expressions telles que mettre une mine, être un cafard, avoir un poil dans la main, se faire cramer ou mettre un vent à quelqu’un sont prononcées par des locuteurs francophones tous les jours rendant le discours plus dynamique et coloré. Un langage qui permet, d’un côté, aux locuteurs de s’exprimer de manière précise, et d’un autre côté, de montrer qu’ils ne sont pas responsables de leurs propos ou de leurs opinions, comme le remarque González Rey: « en effet, la reproduction d'énoncés déjà construits peut représenter pour le locuteur l'occasion de se décharger de la responsabilité de "produire" par lui-même: il délègue sur un autrui anonyme son instance énonciative »1. Des expressions qui, à cause de leurs propriétés, ne sont pas toujours faciles à comprendre par les étrangers et même par les gens du pays en question. Un locuteur étranger aura plus ou moins de facilité à l’heure de reconnaître une expression idiomatique selon la manière qui aura le locuteur natif de l’introduire dans le discours:2 Qu'est-ce qu'une traduction ? 1 González Rey, 1999: 250 2 6 González Rey, 1999: 250 6 Traduire, c'est restituer un texte écrit dans une langue (appelée langue source) dans une autre (appelée langue cible), en prenant soin de ne pas en changer le sens. Théoriquement, la personne qui lit une traduction ne doit pas se rendre compte que le texte qu'elle lit n'est pas l'original mais qu'il s'agit de la retranscription d'un message d'abord transmis dans une langue étrangère. Les difficultés inhérentes à la traduction sont nombreuses, elles peuvent concerner, par exemple, la grammaire, la culture ou le contexte. La plupart des langues sont issues d'une langue ancestrale commune, mais elles ne partagent pas les mêmes racines récentes, ce qui signifie que leurs structures peuvent énormément varier de l'une à l'autre, rendant les structures grammaticales impossibles à transcrire dans l'autre langue sans une modification en profondeur du lexique. Les différences de culture et de contexte social, historique ou géographique sont des aspects non négligeables de la traduction. En effet, des expressions comme "fish-and-chips", "the Big Apple", ou "la ville qui ne dort jamais" pourraient-elles, une fois traduites, être comprises par une personne possédant une langue et une culture différentes ? Le niveau de difficulté de certaines traductions exige d'un traducteur consciencieux qu'il possède une grande maîtrise des deux langues à partir desquelles il travaille, mais également une connaissance approfondie des deux cultures. Cette exigence rend difficile la traduction à partir d'un grand nombre de langues différentes, car une culture s'acquiert sur le long terme. Cependant ce problème a été en grande partie résolu par le développement d'Internet, outil de recherche conférant au traducteur rapidité et certitudes lui permettant d'éviter les erreurs d'interprétation. Les étapes pour mener à bien une traduction 7 Généralement, la traduction d'un document, quelle que soit sa nature, passe par trois étapes distinctes : 1. La compréhension : le traducteur lit le texte avec soin, en recherchant les expressions, notions et uploads/s3/ traduction.pdf
Documents similaires

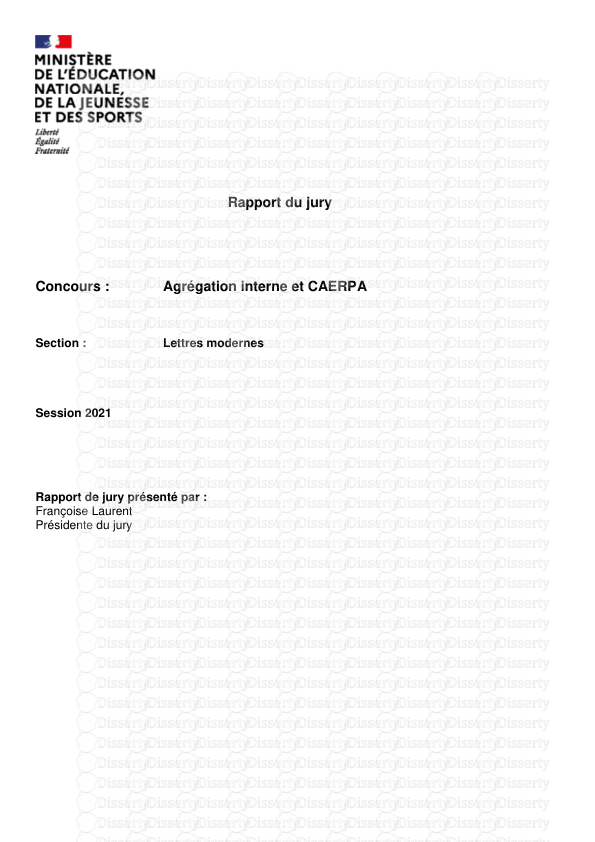



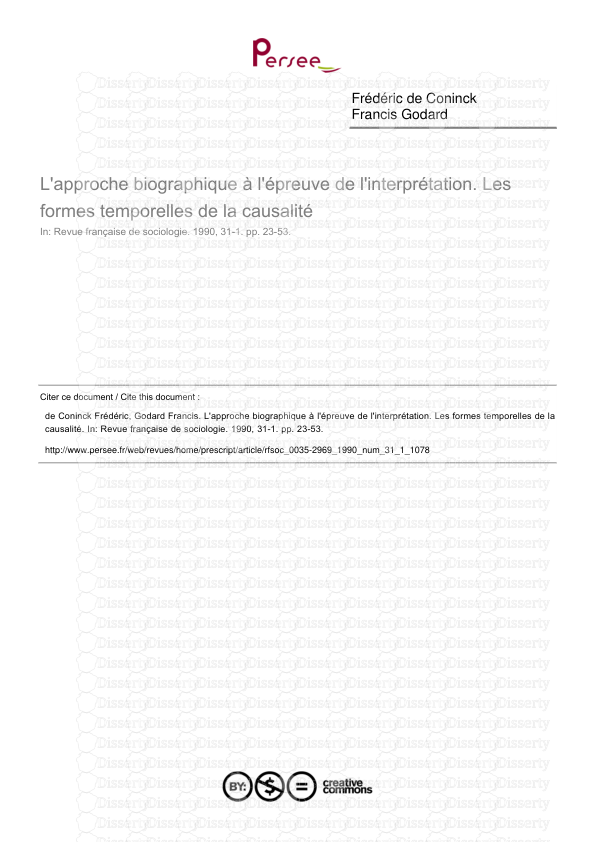




-
89
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 22, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1243MB