CAHIERS / N° 49 • REVUE MENSUELLE DU CINÉMA • JUILLET 1955 Kirk Douglas est, av
CAHIERS / N° 49 • REVUE MENSUELLE DU CINÉMA • JUILLET 1955 Kirk Douglas est, avec Jeanne Grain et Claire Trevor, la vedette de L’HOMME QUI N’A PAS D ’ETOILE (Man Without a'Slar), de K i n g Y i d o r . (Universal Film S.A.) Dean Martin et Jerry Lewis, joyeux farceurs de LE CLOWN EST ROI (Three Ring Circus), de Joseph Devney. Joanne Dru, Zsa Zsa Gabor et Wallace Ford les entourent. (Paramount.) Cahiers du Cinéma NOTRE COUVERTURE BLINKITY BLANK de Nor man Mac Laren. Dans L ’E s s a i d e C r i t i q u e I n d i r e c t e , Jean Cocteau évoque un « public amoureux du bien-être q u i souffre déjà des inventions Qui chaque jour le boitsculent et l’obligent à progresser dans Is noir ». Cela n’a jamais été plus vrai, que pour Blinkity Blank, gallinacé fantastique qui honore notre couverture. JUILLET 1955 TOME IX. No 49 S O M M A I R E Dominique A ubier....... Mythologie de « La Strada » ..................... S Eric Rhomer ................. Le celluloïd et le marbre {II. Le siècle des Peintres) ........................................................... 10 André M artin ............... Cinéma d'animatïon, Millésime 54 et 55 ... 16 Francis P o u len c........... Musique de film .................................... ............. 27 Pierre M ich au t............. Un film-ballet ; « Roméo et Juliette » ___ 29 Jacques Audiberti ........ Billet LX ............................................................... 32 H. Agel, A. Bazin, R, Lachenay et A. Mar- Petit journal intime du Cinéma .................. 35 "k Les Films Jacques Doniol-Valcroze Une belle ténébreuse (« La Comtesse aux pieds1 nus ») .................................................... 40 François Truffaut ___ La Comtesse était Beyle {« La Comtesse aux pieds nus ») ............................................ 41 Philippe Dcmonsablon, Des anciens e,t des modernes (« La Com tesse aux pieds nus ») ................................. 44 Claude Chabrol ........... Clés pour la Comtesse (« La Comtessje aux pieds nus) ....................................................... 45 Jacques Doniol-Yalcroze Les fleurs y poussèrent (« La Colline 24 ne répond plus ») ........................................ 46 Philippe Demonsablon. Portrait d’un honnête homme (« Le Secret magnifique ») .................................................. 49 Willy Acher ................... L’amour des antipodes (« Les amours de 50 Liang Shan Po et Chu Ying Tai ») ___ Claude Chabrol ___ Raoul (« Le Cri de la victoire ») .................. :k 51 Philippe S a b a n t........... Nouveaux objectifs du Cinéma soviétique .. 53 Films sortis à Paris du 1«- au 21 juin 1955 ............................................ 59 Table des matières du Tome V III,............................................................... 61 ★ CAHIERS DU CINEMA, revue mensuelle du Cinéma et du Télé-cinéma, 146, Champs-Elysées, PABIS (8») - Elysées 05-38 - Rédacteur* en chef : André Bazin, Jacques Donlol-Valcroze et Lo Duca. Directeur-gérant : L. Keigel. Tous droits réservés — Copyright by les Editions de l’Etoile. MYTHOLOGIE DE LA STRADA par Dominique Aubier Un film comme La Strada appartient à la classe des ouvrages mythologiques, lesquels attendent de la critique, puis du public qu’ils accomplissent un travail com plexe et subtil d ’adhésion. Nous attendons trop du cinéma quJ il parle comme on lance des pierres, sans accomplir ces détours ou ces bonds inévitables dès qu’une œuvre porte l'empreinte spirituelle de son créateur. Federico Fellini atteint pour tant à cette supériorité qu'ignorent tant de travailleurs du cinéma : le style, au ser vice d’un univers mythologique d ’artiste. Son exemple nous prouve, une fois de plus, que le cinéma a moins besoin de techniciens — il eh compte plus qu’il ne lui en faut — que de quelques structures mentales. . Certains esprits répugnent à mettre au clair ce qu’ils ont senti par le mystère de l’adhésion artistique. Il est sûr que La Strada vit d’une vie organique et propre. Il se peut qu’en effet, rationnaliser les faits et les idées qui la soutiennent ne redonne pas plus le sentiment de sa réalité que ne le donne de notre corps l’inventaire des mille et un osselets qui font notre squelette. Pourtant, les œuvres poétiques de bonne tenue supportent qu’on les ouvre, qu’on les vide et qu’on regarde. Elles ressemblent, et c’est merveille, à ces poissons dont parle Antonio Machado, à propos de poésie, poissons qui se laissent pêcher comme les autres mais demeurent éternellement vivants. Selon moi, La Strada peut être-sortie de l ’eau. Elle n’y perdra pas son souffle- On a dit, et Fellini lui-même l’aurait déclaré, que La Strada était d ’inspiration franciscaine. Certes, comment ne pas identifier, ici et là, certaines réminiscences du Poverello ? Ce film raconte une aventure spirituelle. La Strada, ce sont bien en effet, les Fioretti modernes, une œuvre reconnaissante et généreuse, d ’amour et de simpli cité où les grands thèmes du maçon de Saint Darnian peuvent se retrouver. Quelques transparences laissent même voir des souvenirs précis. Le portrait de Gelsomina est tout entier d ’inspiration franciscaine. Cette jeune fille qui prend la pose des arbres, qui plante des tomates (pommes d’or ou d ’amour) qui plaît aux enfants et à qui chacun s’intéresse, qui va faire rire les malades, dont l’attention est toujours tournée vers les autres (ne parle-t-elle pas de la Rosa quand elle veut parler d’elle même ?) et que certains critiques ont qualifiée sérieuse ment d’idiote quand ce genre d ’anormaux fait l’honneur de notre monde et de notre littérature depuis celui de Dostoiewsky jusqu’à Chariot, cette Gelsomina douée pour la vie intérieure, si musicale, est comme une sœur de Saint François. L ’un est amou reux du Christ, l ’autre est amoureuse de la musique. Elle suit son époux terrestre, cet homme, cette brute qui a besoin d’âme. (Et qui resterait avec lui si moi je n’y res tais pas ?) Gelsomina et Zampano constituent les deux parties de notre être. On se souvient du mythe du satyre grec moitié bouc et moitié joueur de -flûte. L ’un est la part bestiale, l ’autre est l ’ange, a De la ceinture par en bas, tout--le travail, assure un proverbe méditerranéen. Par en haut, paix et olivier ! » Fellini coupe dans la définition de l’homme et donne vie à chaque moitié. N.D.L.R. — Voir toutes les notes en fin d’article. 3 Mais le véritable héros du film, c ’est II Matto, le Fou. Saint François d;Assise préférait le fous aux gens trop' sensés, Fellini a repris à son compte ce sentiment. Mais avec quelles précautions ! Cet homme qui a le droit de porter des ailes d’ange, qui marche sur la corde raide à quarante mètres au-dessus du sol, celui de Zampano, dans sa protestation haineuse nomme si bien le grand homme « hé l Grand1 uomo î * qu7 il supporte l’idéal humain que propose Fellini. Il est le poète, l ’artiste, celui qui sème la joie de ville en ville. La folie est ici regardée comme un don, une richesse, non une misère. « Il n ’y a de véritable fou que ceux qui ne le sont jamais » dit un autre proverbe latin. Et l’on songerait plutôt à Zampano. Basehart interprète, si admirablement qu'un psy chiatre doit faire le diagnostic de son anomalie mentale à première vue, un cas psychologique. Il joue un de ces être émotifs, schyzotimiques, comme la famille des saints, des chamans, des sorciers' et des artistes, des mystiques, en compte de nom breux à travers les siècles, les civilisations, les religions et le monde. Un être qui souffre d’exagération sensible, qui oppose des réactions excessives à de petites causes, qui manque de ce que nous appelons bon sens parce qu’il a sans doute un sens de plus. Ne le plaignons pas ! La nature a un peu tiré sur le tissu spirituel pour le confectionner. Selon Fellini, il tient à l ’humain par le meilleur bout. Mais revenons à l’influence de Saint François d’Assise ? Influence ? Il s ’agi rait plutôt de cette fraternité lointaine qu’impose l’admiration. Il y a des sympa thies humaines qui se prolongent généreusement sans que l’on puisse parler d ’imita tion. Dans ~La Sirada, quelques déchirures laissent entrevoir des images où l ’on peut deviner le souvenir de Saint François. On sait que le fils du drapier d’Assise respectait le feu, comme le meilleur élément donné à l’homme. Mon frère le feu, comme mon frère le soleil. Un jour que ses vêtements brûlaient il refusa qu’on les éteignît. Fellini place dans son film quel ques feux fraternels qui accompagnent ses personnages. C ’est ainsi que la plus grande flamme jaillit de l’automobile renversée, pour saluer la mort de celui qui avait en quelque sorte le plus d’âme (i). L ’admirable scène où les trois musiciens arrivent, à la queue leu leu, comme des prédicateurs d ’une autre foi, pour entraîner la jeune fille vers le cirque, rappelle ce frère de Saint François qui, aux carrefours, tournait sur lui-même jusqu’à ivresse complète afin de s’écrouler devant la route à suivre. Mais le propos de Fellini dont j ’ai plaisir à croire qu’il a présidé de façon très volontaire aux significations secrètes ou cachées uploads/s3/ cahiers-49-revue-mensuelle-du-cinema-juillet-1955.pdf
Documents similaires

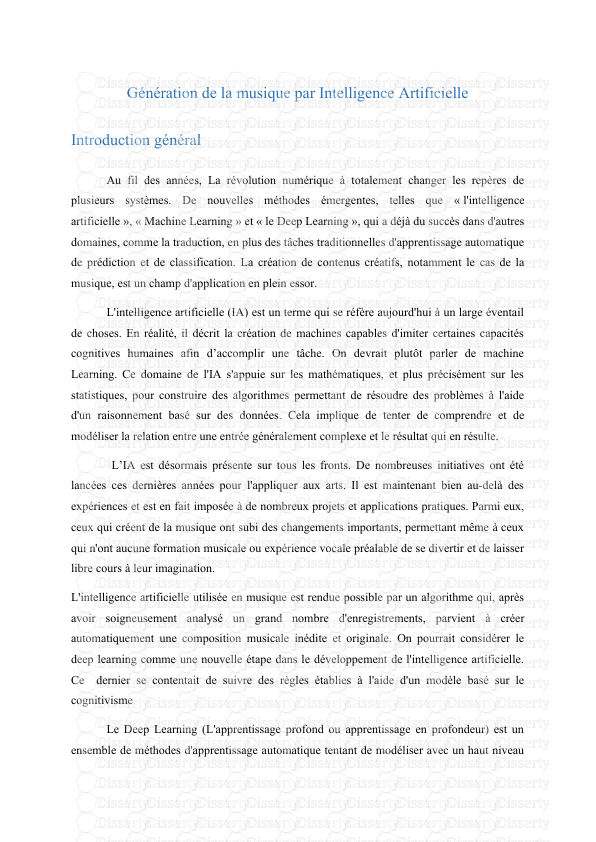








-
48
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 06, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 5.4681MB


