1 Les théories de l’apprentissage I. Le behaviorisme Extrait du cours « Psychol
1 Les théories de l’apprentissage I. Le behaviorisme Extrait du cours « Psychologie de l’Education », par Christian Depover, Bruno De Lièvre, Jean-Jacques Quintin et Sandrine Decamps, Université de Mons (http://deste.umons.ac.be/cours/psychoeduc/) 1. Ebbinghaus et l'étude de la mémorisation Lorsque la psychologie s'est définitivement détachée de la philosophie sous l'impulsion de chercheurs comme Ebbinghaus (1850-1909), c'est au nom de la revendication d'asseoir la psychologie sur une approche scientifique des phénomènes que le schisme a eu lieu. Par la suite différents auteurs tels que Watson puis Skinner ont approfondi l'exigence énoncée par Ebbinghaus en insistant sur le fait que l'étude des processus psychologiques ne pouvait se faire qu'à travers l'observation objective des comportements manifestés par l'individu. C'est de la systématisation de cette exigence qu'est née, sous l'impulsion de Watson, la dénomination béhaviorisme. Très rapidement Ebbinghaus s'est attaché à systématiser ses observations qui portaient sur la mémorisation de syllabes sans signification sous forme de lois dont la plus connue décrit le phénomène d'oubli : l'oubli du matériel mémorisé est important en début de période puis décroît ensuite plus lentement conformément à la courbe présentée dans la figure 1.1. Figure 1.1 :La courbe d'oubli d'après Ebbinghaus Pour interpréter ses résultats Ebbinghaus fait appel à la notion d'association pour expliquer que le réapprentissage est beaucoup plus facile lorsque les syllabes sont placées dans le même ordre que lors de l'apprentissage initial : "Au cours du premier apprentissage, il s'est créé une association directe entre les termes immédiatement contigus dans la série. La force de cette association directe est relativement élevée puisqu'elle se traduit par une économie (une réduction du temps consacré au réapprentissage par rapport au temps consacré à l'apprentissage initial) importante au niveau du réapprentissage des mêmes syllabes, placées dans le même ordre, le jour suivant.". 2 La notion d'association qui est utilisée par Ebbinghaus pour interpréter ses résultats est loin d'être nouvelle puisqu'elle a déjà servi, dans le cadre d'approches purement spéculatives, aux philosophes du XVIIe siècle comme Locke ou Hume pour tenter d'expliquer le fonctionnement de l'esprit humain. D'autre part, le concept d'association, sous des formes diverses, continuera à marquer le développement de la psychologie de l'apprentissage puisque toutes les conceptions béhavioristes et néo-béhavioristes y feront appel. Les travaux de Thorndike (1932) ont très fortement marqué la première moitié du 20e siècle par le caractère essentiellement expérimental de sa démarche. Ses travaux représentent sans doute la première tentative systématique pour dégager les lois fondamentales de l'apprentissage dans le cadre d'une psychologie scientifique. 2. Thorndike et l'apprentissage par essai et erreur Le dispositif utilisé par Thorndike est simple : on enferme un chat affamé dans une cage comportant une porte munie d'un loquet. Un peu de nourriture est placée à l'extérieur. Si l'animal manœuvre efficacement le loquet, la porte s'ouvre et il peut atteindre la nourriture. Placé dans cette situation l'animal manifeste des comportements divers dits exploratoires puis, par hasard, il manœuvre le loquet ce qui lui donne accès à la nourriture. Lorsqu'on recommence l'expérience, on s'aperçoit que le temps mis par l'animal pour sortir de la cage décroît progressivement ; au bout d'un certain nombre d'essais, l'animal parvient à ouvrir le loquet dès qu'il est placé dans la cage. L'apprentissage est alors considéré comme réalisé. Le comportement de l'animal peut être représenté sous la forme de courbe d'apprentissage en mesurant à chaque essai le temps qui s'écoule entre le moment où le chat est placé dans la cage et celui où il parvient à manœuvrer le loquet pour sortir (Figure 1.2). Figure 1.2 : Courbe d'apprentissage d'après Thorndike 3 C'est à partir de nombreuses observations comme celles que nous venons de décrire que Thorndike va formuler ses lois de l'apprentissage dont les deux principales sont: la loi de l'exercice et la loi de l'effet. Loi de l'exercice Les connexions entre la situation et la réponse sont renforcées par l'exercice et affaiblies lorsque l'exercice est arrêté. Le renforcement des connexions entre une situation (la cage dans laquelle se trouve l'animal) et la réponse (la manipulation adéquate du loquet) conduit à une augmentation de la fréquence d'apparition de la réponse correcte. Loi de l'effet Une connexion est renforcée ou affaiblie par l'effet de ses conséquences. Si la connexion situation-réponse est suivie d'un état de satisfaction du sujet (récompense) elle est renforcée ; si elle est suivie d'un état non satisfaisant (punition) elle est affaiblie. Thorndike met également en évidence la nécessaire complémentarité de ces deux lois : L'exercice ne favorise l'apprentissage que dans les situations permettant l'intervention de la loi de l'effet. Ainsi, dans une situation d'apprentissage où l'on demande au sujet de tracer, les yeux fermés, une ligne d'une longueur déterminée, la seule répétition des essais ne conduit à aucune amélioration des performances. Pour qu'il y ait apprentissage, il faut, à chaque essai, fournir des indications précises sur le résultat de son comportement : trop long, trop court… On voit ici apparaître la notion de feed-back qui constituera une composante essentielle de l'approche de Skinner, auteur que nous envisagerons plus avant. Thorndike insiste beaucoup, comme le fera Skinner par la suite, sur le fait que, pour qu'un apprentissage puisse se réaliser, il est essentiel que l'animal soit actif. Au départ, il procède par une série d'essais infructueux puis par la suite sa conduite s'affine pour éliminer progressivement les comportements les moins efficaces et aboutir de plus en plus rapidement à une solution. Thorndike désigne cette forme d'apprentissage par l'expression "apprentissage par essai et erreur". Les travaux de Thorndike, tout comme ceux des chercheurs que nous envisagerons par la suite dans le cadre de l'approche behavioriste, reposent sur l'hypothèse de Darwin, fort en vogue à l'époque, de la continuité des espèces entre l'animal et l'homme. Sur cette base, il apparaît normal à ces chercheurs d'accepter l'idée que les phénomènes expliquant le comportement animal peuvent aussi servir à comprendre le comportement humain. S'appuyant sur cette hypothèse de continuité, Thorndike propose en 1922 dans un ouvrage intitulé "The Psychology of Arithmetic" un certain nombre d'exemples d'application de sa méthode à l'apprentissage chez l'homme. Pour cet auteur, l'enseignement d'une compétence repose sur une décomposition de celle-ci en ses composantes élémentaires. Ainsi, l'addition écrite de deux nombres de deux chiffres implique la maîtrise d'un certain nombre de sous- compétences telles que : aligner correctement les chiffres en colonnes, additionner deux nombres d'un seul chiffre, réaliser le report à la dizaine … Pour maîtriser l'addition écrite de deux nombres de deux chiffres, il est essentiel de maîtriser chacune de ces sous-compétences mais aussi de pouvoir les mettre en œuvre simultanément. 4 Cette approche conduit l'auteur à proposer des fiches de progression centrées sur le "drill and practice" de chacune de ces compétences. Cette focalisation sur l'exercice" aveugle " de la compétence a par la suite fait l'objet de nombreuses critiques basées sur l'argument selon lequel le "drill" répétitif ne conduit pas à une compréhension profonde des notions alors que le but premier de l'arithmétique c'est de raisonner sur des quantités plutôt que de réaliser des opérations sans compréhension profonde de celles-ci. 3. Pavlov et le conditionnement répondant Les travaux de Pavlov (1927) s'inscrivent parfaitement dans la perspective évolutionniste basée sur l'expérimentation animale que nous venons de rappeler. Physiologiste de formation, Pavlov fonde son approche à la fois sur le modèle associationniste et sur l'étude des réflexes. De ce rapprochement découle son expérience la plus classique basée sur le constat que la présentation de nourriture à un chien entraîne un réflexe de salivation : il fait retentir une cloche en même temps qu'il présente de la nourriture à un chien, répète un certain nombre de fois cette association entre le bruit de la cloche et la présentation de la nourriture et constate ensuite que l'animal salive à la seule audition de la cloche. Plus formellement on peut décrire cette expérience de la manière suivante : • La présentation d'un stimulus neutre (la cloche) n'entraîne aucune réponse salivaire chez le chien (figure 1.3). Figure 1.3 : Présentation d'un stimulus neutre • La présentation d'un stimulus inconditionnel (la nourriture) entraîne une réponse salivaire dite inconditionnelle chez le chien (figure 1.4). 5 Figure 1.4 : Présentation d'un stimulus inconditionnel • La présentation simultanée des deux stimuli (nourriture + bruit de la cloche) entraîne une réponse dite inconditionnelle chez le chien (figure 1.5). Figure 1.5 : Présentation simultanée d'un stimulus neutre et inconditionnel • Après avoir répété un certain nombre de fois la présentation simultanée des deux stimuli, on constate que la présentation du stimulus neutre seule entraîne une réponse salivaire. On dit alors que la réaction conditionnelle est établie : le stimulus initialement neutre est devenu un stimulus conditionnel capable de provoquer une réaction salivaire qualifiée de réponse conditionnelle (figure 1.6). Figure 1.6 : Présentation d'un stimulus conditionnel Cette expérience classique a par la suite fait l'objet de nombreuses variantes qui ont notamment permis de montrer : • que la présentation pendant une longue période du stimulus conditionnel seul entraîne la disparition de la réponse (phénomène d'extinction); • qu'il est possible d'établir des conditionnements en chaîne en associant, à un premier stimulus conditionnel, uploads/s3/ behaviorisme 1 .pdf
Documents similaires






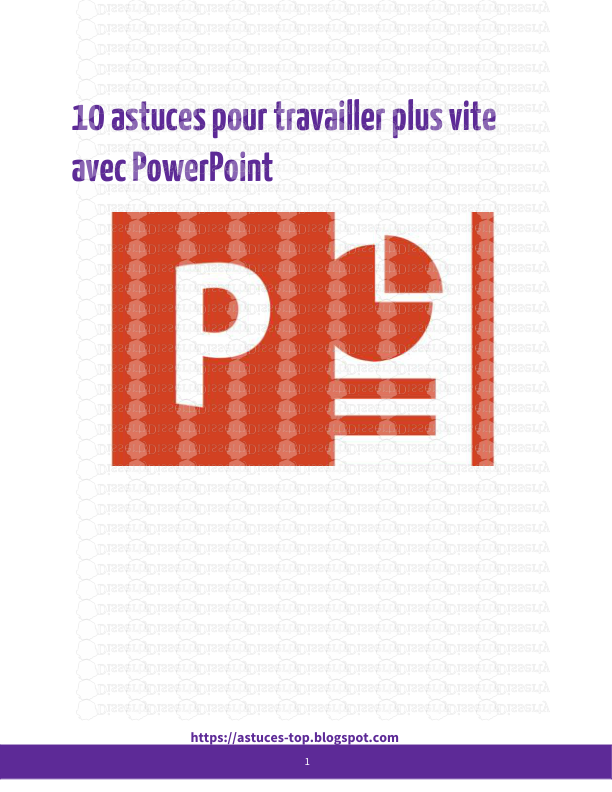



-
70
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 02, 2023
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.6883MB


