Imprimer Glossaire de linguistique Termes et concepts classés par ordre alphabé
Imprimer Glossaire de linguistique Termes et concepts classés par ordre alphabétique A Accent primaire : l'accent résulte de l'accentuation qui est un type de proéminence particulier permettant de mettre une partie de la chaîne parlée en relief. En français, l'accent est porté par la dernière syllabe pleine d'un mot. Il s’accompagne généralement d’un allongement de la syllabe et peut être suivi d’une pause : « absolument » --> [apsɔly’mɑ] ̃ . Tous les mots ne portent pas l'accent primaire : les clitiques n'ont pas d'accent. Accent secondaire : il frappe le plus souvent la syllabe initiale d’un mot. C’est un accent d’insistance : « circulation » --> [‘sirkyla’sjɔ] ̃ . Les clitiques peuvent recevoir l'accent secondaire. Actes de langage : le locuteur cherche à informer, inciter, demander, communiquer, etc. Acte à valeur illocutoire : ce qui est fait en disant ce que l'on dit. Acte à valeur locutoire : dit en tant que tel. Acte à valeur perlocutoire : effet psychologique que produit la phrase sur le récepteur. Acronyme : sigle qui se prononce comme un mot ordinaire (ex : UNESCO, SIDA...). Abréviation : procédé exclusivement graphique qui consiste à écrire un mot en n'utilisant qu'une partie de ses lettres. Adstrat : phénomène d'emprunt d'une langue à une autre par proximité géographique. Affixe : élément susceptible d'être incorporé à un mot, avant, dans ou après le radical, pour en modifier le sens ou la fonction ( préfixe et/ou suffixe ). Analyse conversationnelle : dialogue et échanges verbaux oraux ou écrits. Analyse du discours : va étudier le contexte dans lequel le discours est produit, le contenu du discours oral et écrit. Amuïssement : effacement d'un son dans la prononciation ou disparition d'un son dans la chaîne parlée. Arbitraire du signe : selon Saussure, un signe arbitraire signifie qu'il n'y a pas de rapport naturel entre le signifié et le signifiant. Akkadienne : n.m Langue sémitique ancienne, utilisée en Mésopotamie à partir du III millénaire avant J.-C. (Influencé par le sumérien, l'akkadien s'écrivait en caractères cunéiformes. Au II millénaire, il se scinda en deux dialectes, l'assyrien et le babylonien. Il fut supplanté par l'araméen à la fin du vi s. avant J.-C.) Larousse. Allomorphe : un morphème avec différentes réalisations. Exemple : le morphème verbal "aller" : "j'irai" "tu vas" "nous allons". Aphasie : trouble de la communication qui peut se manifester dans l'expression et/ou la compréhension orale ou écrite. Aphasie de Broca : altération ou perte du langage acquis (oral ou écrit). •aphasie d’expression, antérieure, motrice ou expressive •Expression complexe mais avec sens •Lobe frontal atteint Aphasie de Wernicke : trouble de compréhension écrite ou orale. •aphasie de réception, sensorielle, réceptive ou postérieure •Expression aisée mais sans sens •Lobe temporal atteint Aphérèse : chute d'un ou plusieurs phonèmes au début d'un mot. Exemple : "vous" réduit au z de liaison « Z'avez pas soif ? » Apocope : chute d'un ou plusieurs phonèmes à la fin d'un mot. Exemple : cinéma =>ciné. Archiphonème : il s'agit d'un phonème qui résulte de la neutralisation de deux phonèmes oppositifs. L'archiphonème se note en majuscule. Exemple : mERci -> que l'on dise meRci ou mɛRci, le sens ne change pas. Contrairement à "poignée" et "poignet" et e et ɛ sont oppositifs. Le R en français est donc un archiphonème : il n'y a d'opposition entre r et ʁ, le sens ne sera pas modifié selon la prononciation. Associative ? Argot : système réduit au lexique utilisé par un groupe de locuteur restreint, qui permet une certaine connivence de groupe. A l'origine utilisés par des personnes qui se veulent en marge de la société. Axe syntagmatique : combinaison dans l'enchaînement de l'énoncé (relation sujet-verbe, adjectif-complément). Axe paradigmatique : chaque unité en tout point de l'énoncé, peut être associée à d'autres unités (cela change le sens de l'énoncé). Accentuation : mise en relief d'un élément de la chaîne parlée. B Behaviorisme : n.m (américain behaviorism) Courant de la psychologie scientifique, qui ne prend en considération que les relations directes ou presque directes entre les stimulus et les réponses. Synonyme : comportementalisme (Larousse). Bilinguisme : fait de posséder deux langues qui ont un statut équivalent. Boucle audio-phonatoire : rétroaction, feed-back ; couplage de l'appareil vocal et de l'appareil auditif qui permet naturellement à l'émetteur de s'entendre parler. Base : élément sur lequel opère un affixe ou une flexion. Il peut être composé d'un ou plusieurs morphèmes (ex : nationalisation : 4 morphèmes, {nation} = base). C Calque sémantique : emprunt d’une acception nouvelle et étrangère mais pour un signifiant qui existe déjà dans la langue cible. S'oppose à l'emprunt ancien qui lui va emprunter à une autre langue au cours de son histoire. Canal : dans le schéma de communication de Jakobson, cela fait référence au contact. Fonction phatique : reflet des conditions de communication. Exemple : dire "allô" au téléphone pour voir si l'autre m'entend => établir le contact. Classe distributionnelle : éléments qui partagent la même distribution. Clitique : unités non accentogènes, tels que : les pronoms, déterminants, prépositions, conjonctions. Code : n.m Ensemble de conventions permettant d'envoyer un message. Moyen et support de la communication. Communiquer : transmettre des informations sur un objet donné à l'aide d'un code ou d'un système de signes. Commutation : opération sur l'axe paradigmatique qui consiste à remplacer une unité ou un segment phonique ou sémantique de la chaine du langage par une unité ou segment de la même classe pour constituer d'autres mots de la langue et dégager des distinctions linguistiques pertinentes. Composé : association figée dont les éléments ont perdu leur autonomie. Composition savante : lexème emprunté à une langue (non autonome dans la langue emprunteuse), fonctionnent comme des lexèmes lexicaux et renvoient à des éléments du monde réel. Corpus : n.m (latin corpus, corps) 1. Recueil de documents relatifs à une discipline, réunis en vue de leur conservation : Corpus des inscriptions grecques. 2. Ensemble fini d'énoncés écrits ou enregistrés, constitué en vue de leur analyse linguistique. (Larousse) 3. Structure et code particulier de la langue. C’est une méthode structuraliste développée par Saussure. Il y a 2 étapes pour analyser un corpus : l’analyse des paires minimales (aux niveaux phonologique, morphologique et syntagmatique) ensuite la classification sur base de la distribution (l’ensemble des environnements dans lesquels apparaît un élément de la langue). (Voir chapitre 1 module 2 p.24). Conative : définition spécifique du cours à indiquer (pas du dictionnaire Larousse, sens commun) Continuum: phénomène progressif dont on ne peut considérer une partie que par abstraction. Crible phonologique : Grille phonologique qui nous permet de distinguer les sons de notre langue maternelle (s’installe vers 6 mois) Contour mélodique : la courbe de la chaine parlée qui correspond en fonction du point de vu où l'on se place : - auditif : courbe mélodique perçu ou - acoustique : tracé de fréquence mesuré sur le segment portant le contour. Consonne : une consonne se définit par trois critères : l'opposition voisé ou non voisé, le mode d'articulation (plosives, nasales vibrantes, fricatives, approximante et approximantes latérales) et le lieu d'articulation (geste articulatoire des lèvres jusqu'à la luette). D Dialecte : forme régionale d'une langue considérée comme un système linguistique en soi. Descriptivisme : conception scientifique d'une langue en fonction de l'observation objective de son usage. ( Amérique, XIXème siècle) Déictique : éléments de discours qui vont renvoyer à la situation d’énonciation et qui ne peuvent être compris que dans son contexte Dérivation : la dérivation se définit comme la procédure de formation de mots par combinaison d'un élément lexical et d'un morphème grammatical. Dérivé : lexème construit par opération de dérivation. Différenciation dialectale : processus pendant lequel deux dialectes se différencient. Diglossie (≠ bilinguisme) : situation dans laquelle deux langues coexistent dans le même pays mais ont un statut différent (ex : l'arabe dit littéraire vs. l'arabe parlé, comme l'argot algérien). En fonction des circonstances, une communauté linguistique va recourir alternativement à une langue familière (dialecte) ou à un langage plus prestigieux, qui est la langue régionale. Par opposition, dans le cas du bilinguisme, les deux langues ont un statut équivalent. Dilation : n.f. Harmonisation vocalique. Plus précisément l’assimilation du timbre de deux voyelles non contigües. Distribution : somme des environnements dans lesquels un élément peut apparaître. Distributionnalisme : courant linguistique américain fondé au XX -ème siècle par Léonard Bloomfield et qui envisage la langue de manière mécaniste, c'est à dire comme un système de régularité démontrable, une mécanique prévisible explicable par ses conditions externes. // comportement. Double articulation : conceptualisée par Martinet durant le XXème siècle, c'est le fait d'envisager la langue comme une combinaison d'unités afin d'obtenir un sens. Une unité de première articulation (significative) : les monèmes ( = lexèmes et morphème) qui sont les plus petites unités de sens dotés d'une forme phonique. Ceux-ci sont composés d'une unité de seconde articulation (distinctives) : les phonèmes qui sont la plus petite unité de son, mais qui permettent de distinguer les monèmes. Ils sont dénués de sens et n'en prennent qu' en s'assemblant en morphème. Discours uploads/s3/ prettyview 1 .pdf
Documents similaires







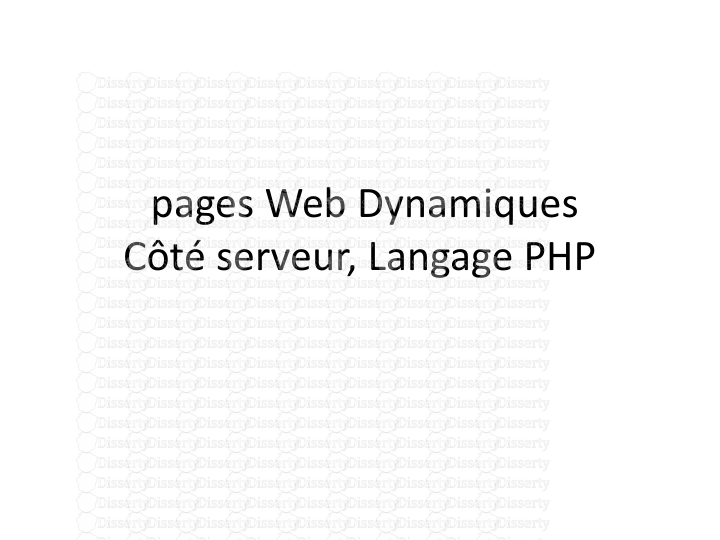


-
50
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 23, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0859MB


