LE STUDIO – PHILHARMONIE Vendredi 11 octobre 2019 – 20h30 Quatuor Arod Elsa Dre
LE STUDIO – PHILHARMONIE Vendredi 11 octobre 2019 – 20h30 Quatuor Arod Elsa Dreisig Programme Franz Schubert Quatuor à cordes no 4 Anton Webern Langsamer Satz ENTRACTE Arnold Schönberg Quatuor à cordes no 2 Quatuor Arod Jordan Victoria, violon Alexandre Vu, violon Tanguy Parisot, alto Samy Rachid, violoncelle Elsa Dreisig, soprano FIN DU CONCERT VERS 21H50. Livret en page 14. 4 Les œuvres Franz Schubert (1797-1828) Quatuor à cordes no 4, en ut majeur D 46 I. Adagio. Allegro con moto II. Andante con moto III. Menuetto IV. Allegro Composition : 3-7 mars 1813. Création : probablement en 1813, chez les Schubert. Effectif : 2 violons, alto, violoncelle. Durée : environ 25 minutes. Entre 13 et 16 ans, Franz Schubert est déjà un compositeur. Outre ses dons exceptionnels, il baigne depuis toujours dans une ambiance viennoise extrêmement favorable, héritière de Haydn et Mozart ; tout le monde trouve normal que soit produite une abondante musique classico-populaire, à peu près la même pour tous les horizons sociaux. De plus, Schubert reçoit dans son pensionnat, le Konvikt, une éducation musicale très poussée. Il étudie d’abord avec Wenzel Ruzicka, puis il est pris en main par Antonio Salieri, qui lui donnera des leçons jusqu’en 1816 ou 1817. L’adolescent trouve tout naturel, lui aussi, d’écrire quantité d’œuvres, qui seront jouées au Konvikt mais aussi à la maison, pendant ses brèves vacances : en effet, dans le quatuor familial, il tient l’alto pendant que son père joue du violoncelle, et ses deux frères, Ferdinand et Ignaz, du violon. Toute la famille est ravie – sans pour autant crier au génie –, et Franz, placide, ne proteste pas si ses opus sont parfois attribués à ses frères… Ses onze premiers quatuors, jusqu’à ses 19 ans, sont écrits alors qu’il dépend encore de ses parents. L’année 1813, est incroyablement productive : six quatuors, dont un perdu, écrits parfois en quelques jours ! Légèrement inégaux, comme on peut s’y attendre, ces ouvrages de première jeunesse sont immanquablement agréables, quand ils ne laissent pas entrevoir une forte personnalité ; ils sont tous placés sous le signe de l’abondance, non seulement par leur quantité mais aussi par leur tendance à développer généreusement le discours. 5 Le Quatuor no 4 en ut majeur, plein de caractère, a été écrit extrêmement rapidement, et la vivacité de trois mouvements sur quatre, du premier et du dernier surtout, reflète peut- être l’inspiration pressante du jeune compositeur, qui se surpasse. Nourri de Mozart à ce moment-là, il prend probablement modèle sur le Quatuor « Les Dissonances » K 465, dont il reprend l’idée d’un exorde lent et angoissé ; mais, pour son finale, il imite peut-être certains quatuors de Haydn. Pour introduire son premier mouvement, Schubert adopte des lignes chromatiques tombantes, qui se répondent en canon comme des larmes maussades. Puis l’électrique Allegro con moto s’élance en un galop de triolets, avec un sens du fantastique tout proche du Roi des aulnes (celui-ci verra le jour en 18 15) ou du finale du Quatuor « La Jeune Fille et la Mort » (1824-1826). Appels de détresse aux violons, abîmes d’unissons, le tableau de panique ne s’interrompt que pour rappeler le sombre motif d’introduction, à la clôture de l’exposition et du développement. L’Andante con moto est d’une calme mélancolie. Le thème, très sage, est présenté en deux reprises, développé en quelques inflexions plus tendues, puis doucement ramené à sa case départ. Le Menuetto, par son tempo assez vif et spirituel, est presque un scherzo ; il commence sur un arpège audacieux et se poursuit par un battement sourd et prolongé en staccato. Le trio est annoncé par les « appels de cor » à l’alto ; puis il tourne une danse villageoise aux effets de « violoneux ». Le finale est une polka très enlevée et insouciante, qui suit un dynamique plan de sonate. Le piétinement vigoureux et populaire du thème principal est traité avec un certain humour dans le développement, mais aussi avec mystère, sur un long bourdon où les appels se prolongent… Isabelle Werck L’électrique Allegro con moto s’élance en un galop de triolets, avec un sens du fantastique tout proche du Roi des aulnes ou du finale du Quatuor “La Jeune Fille et la Mort”. 6 Anton Webern (1883-1945) Langsamer Satz [Mouvement lent] Composition : juin 1905. Création : le 27 mai 1962, à Seattle, par le quatuor à cordes de l’Université de Washington. Effectif : 2 violons, alto, violoncelle. Durée : 9 minutes environ. De tous les compositeurs de l’École de Vienne, Anton Webern est celui dont l’évolution s’avère la plus spectaculaire. À la fin de la première décennie du xxe siècle, il a déjà aban donné le langage tonal et les élans postromantiques encore perceptibles dans les œuvres de maturité d’Arnold Schönberg et Alban Berg. Mais en juin 1905, alors qu’il étudie avec Schönberg depuis quelques mois, rien ne laisse présager cette mue rapide. Le Langsamer Satz s’inscrit dans l’héritage de Brahms, Wagner et Mahler, même si son écriture contra puntique et sa souplesse rythmique resteront des marques stylistiques. Au printemps 1905, le jeune musicien voyage en Basse-Autriche avec Wilhelmine Mörtl, qu’il épousera en 191 1. Ces moments d’idylle sont à l’origine du Langsamer Satz et d’un Quatuor à cordes longtemps restés inédits. Webern écrit dans son journal : « Marcher pour toujours ainsi parmi les fleurs, avec ma bien-aimée auprès de moi, se sentir si puissamment ne faire qu’un avec l’univers, sans inquiétude aucune, aussi libre que l’alouette dans le ciel – oh, quelle splendeur... Lorsque la nuit tomba (après la pluie), le ciel versa des larmes amères, mais je marchais avec elle le long d’une route. Un manteau nous abritait. Notre amour s’éleva à des hauteurs infinies et emplit tout l’univers. Deux âmes étaient ravies. » Reflet de l’intimité du compositeur, la musique semble traduire ces confidences passionnées. Webern conservera par la suite une propension au lyrisme, mais dépouillé de ses effusions pour n’en conserver que l’essence. Hélène Cao 7 Arnold Schönberg (1874-1951) Quatuor à cordes no 2, en fa dièse mineur avec soprano op. 10 I. Mäßig II. Scherzo. Sehr Rasch III. Litanei. Langsam IV. Entrückung. Sehr langsam Composition : 9 mars 1907-11 août 1908, les troisième et quatrième mouvements composés sur des textes de Stefan George. Dédicace : « À ma femme ». Création : le 21 décembre 1908, à la Bösendorfer-Saal, à Vienne, par le Quatuor Rosé et la soprano Marie Gutheil-Schoder. Édition : privée, en 1909 ; puis par Universal Edition, Vienne,1912 ; révisée en 1921. Effectif : soprano – 2 violons, alto, violoncelle. Durée : environ 32 minutes. Prise à revers des habitudes d’écriture les mieux paramétrées, vacillement des fondements d’un langage harmonique séculaire : le Quatuor no 2 d’Arnold Schönberg est généralement considéré comme l’un des nœuds de l’histoire de la musique, contemporain (et équivalent sous certains aspects) du passage à l’abstraction chez Kandinsky. En faisant du vers de Stefan George « Je sens l’air d’autres planètes » une parole performative par laquelle le quatuor s’achemine à l’extrême limite de la tonalité au point d’en sortir, Schönberg invente, dans le champ technique et historique du langage musical, une figure littérale de la trans cendance. La voix humaine ajoutée au quatuor est non seulement le porte-parole de ce franchissement mais aussi sa condition de possibilité – à la fois comme timbre (proximité avec le violon), comme texte (à travers les métaphores du texte de George), comme sym bole (la cinquième voix qui guide la sortie hors du soi du quatuor à cordes). Schönberg a montré comment l’utilisation de textes, dans des moments de forte incertitude esthétique (voir par exemple Erwartung en 1909), lui avait permis pratiquement de structurer dans le temps un discours musical dont la cohérence propre n’était plus garantie. 8 Le premier mouvement, composé en 1907, est encore proche de l’écriture tonale telle que Schönberg la pratiquait dans son Quatuor no 1 ou dans la première Symphonie de chambre. Il introduit plusieurs thèmes bientôt développés par cellules motiviques distinctes, selon une logique de variation intensive qui brouille la distinction entre réexposition et coda. Le second mouvement, composé comme les suivants en 1908, est un scherzo aux fondements tonals bien établis mais qui contextualisent en fait un matériau mélodique presque atonal, parfois d’autant plus déconcertant qu’il répète compulsivement des cellules rythmiques bien déterminées. C’est pendant l’exécution de ce mouvement que survint, lors de la création de l’œuvre, un scandale resté célèbre : « L’auditoire [était resté passif] pendant le premier mouvement, sans réaction ni pour ni contre. Mais dès qu’on attaqua le deuxième mouvement, une partie du public se mit à éclater de rire aux dessins qui la déconcertaient et continua d’exploser bruyamment pendant presque tout le mouvement. Un scherzo est un genre de musique conçu pour provoquer la gaieté. J’aurais donc très bien compris qu’une sorte de sourire accueillît un passage comme celui où j’avais combiné mes thèmes de façon tragico-comique avec la chanson populaire viennoise “Ach, du lieber Augustin” dont les paroles sont : “Hélas, mon pauvre garçon, tout est perdu”. uploads/s3/ quatuor-arod 1 .pdf
Documents similaires




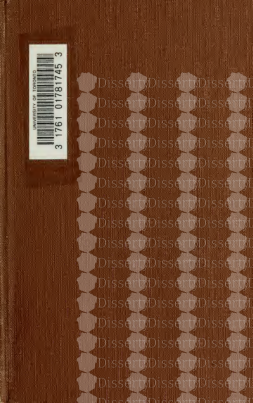





-
71
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 30, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1865MB


