CONSULAT de COMMERCE et de MER puis TRIBUNAL de COMMERCE de NICE Sous-série 06
CONSULAT de COMMERCE et de MER puis TRIBUNAL de COMMERCE de NICE Sous-série 06 FS RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ dressé par Simonetta TOMBACCINI VILLEFRANQUE Attaché de conservation du patrimoine Sous la direction d’Yves KINOSSIAN Directeur ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES ALPES-MARITIMES 2018 Introduction L’institution En revenant dans ses États de terre ferme après la chute de Napoléon, Victor Emmanuel Ier songea à restaurer le corpus normatif sarde en vigueur sous l’Ancien Régime. L’édit royal du 21 mai 1814 l’annonçait explicitement : le système établi par les rois de Sardaigne dans les domaines judiciaire et administratif s’étant révélé comme « le plus conforme à la constitution du pays, aux mœurs, aux coutumes de ses habitants et au bien général de l’État », le législateur décidait de rétablir les Constitutions royales de 1770 et toutes les dispositions édictées jusqu’au 23 juin 18001. Par conséquent, la plupart des institutions niçoises, telles que le sénat et l’intendance générale, se remettaient aussitôt à fonctionner. Pour le consulat de commerce et de mer il faut par contre attendre le mois de juillet, lorsque le roi daigna envoyer des indications par le biais d’un billet spécifique. Celui- ci prévoyait effectivement la réorganisation provisoire du Magistrat consulaire et la reprise imminente de son activité, « soit par rapport aux matières civiles et criminelles lui revenant, soit par rapport à toutes les autres attributions concernant le commerce et la navigation », selon la teneur de l’édit du 15 juillet 1750 qui avait confirmé et détaillé ses compétences2. Il renaissait de ses cendres apparemment à l’identique, retrouvant son rang de cour souveraine et s’installant même au premier étage du palais municipal de la place Saint-François, siège de l’institution avant 1792. Or, en dépit de cette volonté de restauration, les bouleversements de l’annexion française et les résolutions du congrès de Vienne devaient apporter des changements. Ces derniers touchaient tout d’abord son ressort géographique qui dorénavant comprendrait, outre le comté de Nice et les anciennes dépendances en terre ligure, la totalité du territoire allant de Vintimille à Oneille. Car, l’objectif du congrès étant de former des états- tampons assez forts pour brider d’éventuelles ambitions expansionnistes de la France, les plénipotentiaires décrétaient la disparition de la république de Gênes au profit du royaume de Sardaigne. Cet agrandissement territorial comportait néanmoins quelques conditions : dans ces régions nouvellement acquises le roi sarde devait conserver les tribunaux et la chambre de commerce instaurés au cours de la période napoléonienne et le code de commerce français. Des exigences entérinées par Turin dès le 30 décembre 1814 et confirmées le 13 mai 1815 par un règlement où, à l’art. 1er du titre LXIII, lisait-on : « Les tribunaux de commerce actuellement existant dans le duché de Gênes exerceront leur juridiction dans les districts qu’on leur a actuellement assigné et avec les mêmes attributions qu’ils ont aujourd’hui » et à l’art. 4 « Pour l’heure rien n’est innové quant aux lois en vigueur en matière de commerce, ni quant à la façon de procéder devant le tribunal de commerce »3. Le souverain entérinait cette particularité tout en ressuscitant les institutions de l’organisation judiciaire sarde. De ce fait, le 24 avril 1815, un édit prescrivait l’établissement d’un sénat à Gênes et de plusieurs conseils de justice en Ligurie, dont celui d’Oneille. Et afin de compléter ce tableau, le 23 avril 1816 des patentes fixaient les juridictions des tribunaux de commerce de Gênes, Chiavari, Novi, Savona et San Remo et donnaient des dispositions sur les attributions des conseils de justice en matière commerciale4. Parallèlement on détaillait la composition de la province d’Oneille, désormais divisée en deux districts, l’un relevant du tribunal de commerce de San Remo, 1 Raccolta degli atti del governo di S. M. il re di Sardegna, vol. 1er, 1814, Torino, Tipografia Pignetti e Carena, 1842, p. 15-16. 2 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 5 AFF 14, Manifeste du consulat de mer, 9 juillet 1814. 3 Raccolta degli atti del governo di S. M. il re di Sardegna, vol. 2, 1815, Torino, Tipografia Pignetti e Carena, 1842, p. 546-547. 4 Raccolta degli atti del governo di S. M. il re di Sardegna, vol. 2, 1815, cité, p.198-207 et vol. 1816, p. 619-622. l’autre du conseil de justice d’Oneille. Les sentences que leurs juges prononceraient, quoique fondées sur des textes législatifs différents, seraient pareillement portées devant le consulat de Nice en cas d’appel. En définitive, la nouvelle donne politique avait engendré une disparité de traitement : dans les possessions historiques de la maison de Savoie on appliquerait les Constitutions Royales, tandis que dans les provinces anciennement génoises resterait en vigueur la législation commerciale transalpine. Cette disparité subsiste au lendemain de l’édit du 27 septembre 1822 qui pourtant introduisait des modifications dans l’ordre judiciaire, éliminant des vestiges de l’Ancien Régime et instituant, en lieu et place des conseils de justice, les tribunaux de préfecture. C’est à ces organismes que l’édit réservait la connaissance, en première instance, des différends commerciaux, sauf dans les villes où résidaient les consulats. De la sorte, le tribunal de préfecture de Nice ne saurait trancher les litiges de cette nature, alors que celui d’Oneille en avait la compétence, « tout en conservant – précisait l’art. 18 – la procédure prescrite par les Constitutions générales pour les Magistrats du consulat et tout en sauvegardant l’appellation auxdits Magistrats […] dans les procès excédant la valeur de 1 200 lires »5. La dichotomie législative demeurait encore au début des années 1840, lorsque Charles-Albert songea à y mettre fin. En effet, dans le dessein d’uniformiser les lois de commerce dans tous ses États et d’introduire ces améliorations que l’expérience et l’exemple d’autres nations lui avaient suggérées, il préconisa la compilation d’un code destiné à effacer « ogni differenza di legislazione in tale materia tra le diverse parti dello Stato »6. Annoncé en décembre 1842, ce nouveau code entre en vigueur le 1er juillet 1843. Il y avait là une innovation qui allait simplifier le travail des magistrats, sans pour autant modifier le fonctionnement de l’institution, ni ses compétences, ni même son antique dénomination. Du reste, les lettres patentes du 24 avril 1843 le confirmaient7. Et ce statu quo persiste jusqu’en 1855, lorsque la loi du 19 mars sanctionna la suppression des consulats de Turin et de Nice pour le 31 mars suivant, les remplaçant par des tribunaux formés conformément aux normes du Code de commerce albertin8. ♦ Le personnel Selon les Constitutions de 1770, exhumées au moment de la Restauration, le consulat de Nice se composait d’un président, de deux juges legali ou togati (légaux ou gradués), de deux consuls choisis parmi « les négocians les plus accrédités par leurs expérience et probité », d’un procureur général du commerce, d’un secrétaire, de deux commis aux écritures et d’un huissier9. Or, à en croire le sénateur Cristini, nommé régent du consulat en octobre 1814, au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle le nombre des juges légaux était monté à cinq, en raison de la « multiplicité et de l’importance des affaires commerciales et maritimes »10. Cette explication suffit probablement à convaincre le gouvernement sarde, puisque, dès le début, le Magistrat niçois aligna quatre, voire cinq juges légaux – le cinquième étant surnuméraire – choisis pour la plupart au sein de l’élite locale et des anciens émigrés. 5 Raccolta dei regj editti, manifesti ed altre provvidenze de’ magistrati ed uffizj, vol. XVIII, Torino, 1822, Tipografia Davico e Picco, p. 325. 6 Codice di commercio per gli Stati di S. M. il re di Sardegna, Torino, Stamperia reale, 1842. Cet exemplaire du code, conservé aux Archives départementales des Alpes-Maritimes, a vraisemblablement appartenu à l’avocat Malaussena. Il présente des annotations marginales renvoyant aux législations sarde et française. 7 Raccolta degli atti del governo …, vol. 11, 87-93. 8 Ibidem, vol. 24, p. 341-343 et 381-384. 9 Leggi e costituzioni di Sua Maestà. Loix et constitutions de Sa Majesté, tome 1, 1770, Torino, Stamperia reale, p.197-199. 10 Lettre du sénateur Cristini du 28 juin 1814, conservée à l’Archivio di Stato de Turin, citée par Lucie Ménard dans La jurisprudence commerciale du consulat de mer de Nice entre droit sarde, droit français et jus commune (1814-1844), thèse de doctorat, 2013, p. 28. À leur tête figurait un président ou régent : Alberti de Villanova pendant les premiers mois de la Restauration, puis Cristini jusqu’à sa nomination à la direction du conseil de justice d’Oneille, en août 1815. Le président du sénat qui, avant 1792, pilotait également le consulat était pour l’heure écarté, peut-être en vertu des suggestions de Cristini, pour qui « les deux charges de sénateur et de régent [étaient] par ailleurs assez importantes et telles à satisfaire les désirs de deux personnes sans qu’il soit nécessaire de les unir pour gratifier un seul sujet »11. Et cette séparation perdurera jusqu’en 1831, lorsque le sénateur Hilarion de Cessole, chef du consulat depuis 1819, accéda à la présidence du sénat, cumulant les deux fonctions. C’était un précédent destiné à se pérenniser : après le décès de Cessole en 1845, ses successeurs garderont les rênes des deux cours suprêmes. Les uploads/S4/ 6fs-consulat-mer-tribunal-commerce-nice-pdf.pdf
Documents similaires



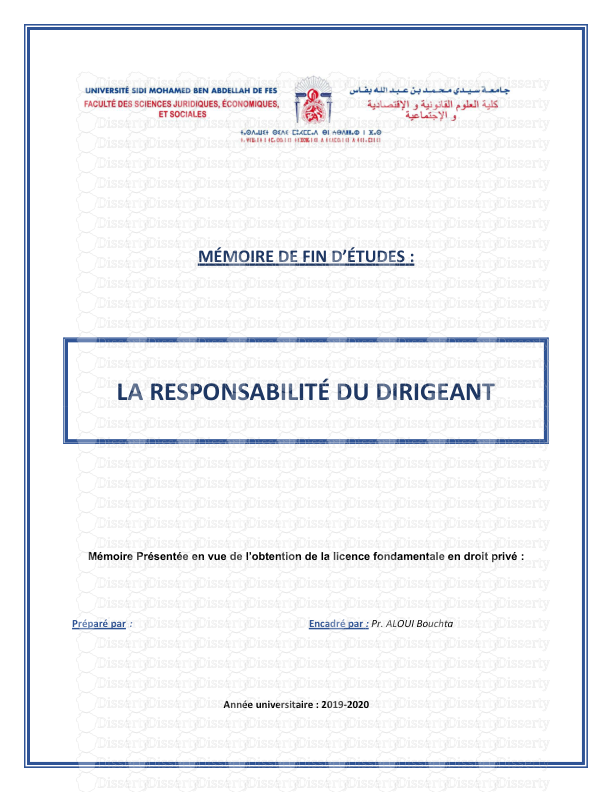






-
33
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.5021MB


