Université de Lille II – Droit et santé Faculté de sciences juridiques, politiq
Université de Lille II – Droit et santé Faculté de sciences juridiques, politiques et sociales L’APPLICATION DES TECHNIQUES CIVILISTES AUX VALEURS MOBILIERES Antoine DESPINOY DEA de Droit des Contrats option Droit des Affaires Année universitaire 2000-2001 Septembre 2001 Mémoire de DEA sous la direction de Madame Marie-Christine MONSALLIER L’APPLICATION DES TECHNIQUES CIVILISTES AUX VALEURS MOBILIERES Liste des principales abréviations utilisées Al. Alinéa ANSA Association Nationale des Sociétés par Actions Art. Article Ass. Plén. Assemblée plénière de la Cour de cassation Bull. Civ. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambre civile Bull. Joly Bulletin Joly CA Cour d’appel Cass. Cour de cassation Cass. Civ. Chambre civile de la Cour de cassation Cass. Com. Chambre commerciale de la Cour de cassation Cf. confère c. civ. Code civil c. com. Code de commerce CJ Comité Juridique Com. Chambre commerciale D. Recueil Dalloz Defrénois Répertoire du notariat Defrénois DP Dalloz Périodique Dr. Sociétés Droit des sociétés éd. Edition Fasc. Fascicule G.P. ou Gaz. Pal. Gazette du Palais I.R. ou Inf. Rap. Informations Rapides J.C.P., éd. E. Jurisclasseur Périodique, édition entreprise J.C.P., éd. G. Jurisclasseur Périodique, édition générale J.C.P., éd. N. Jurisclasseur Périodique, édition notariale JO Journal officiel Jour. Soc. Journal des sociétés L.G.D.J. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence Loc. cit. Loco citato Obs. Observations Op. cit. opus citatum (ouvrage cité) P.A. Petites Affiches Rép. Répertoire Req. Chambre des Requêtes Rev. Revue Rev. Jurisp. Com Revue de Jurisprudence Commerciale Rev. Soc. Revue des Sociétés R.J.D.A. Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires R.T.D. Civ. Revue Trimestrielle de Droit Civil R.T.D. Com. Revue Trimestrielle de Droit Commercial S. Sirey S.A. Société Anonyme S.A.R.L. Société à Responsabilité Limitée Spéc. Spécialement t. 1 ou t. 2 Tome 1 ou Tome 2 Trib. Tribunal Sommaire Introduction 1ère partie : Les finalités des techniques civilistes appliquées aux valeurs mobilières A – L’aménagement des prérogatives de l’associé § 1. Les caractères de la qualité d’actionnaire § 2. L’aménagement de la participation à la vie sociale B - La mise à disposition d’actions à des administrateurs ou à des membres du conseil de surveillance § 1. Le prêt d’actions § 2. La vente à réméré et la cession d’actions « en blanc » 2ème partie : La limitation des aménagements conventionnels A – L’inadaptation des techniques civilistes classiques § 1. L’imperfection des techniques civilistes visant à la mise à disposition d’actions § 2. La faveur de la pratique pour le portage ou une convention sui generis B – Les limites posées par les règles issues du droit des sociétés § 1. L’ordre public sociétaire § 2. L’intérêt social Conclusion INTRODUCTION Depuis toujours on a discuté sur le point de savoir si la nature des sociétés commerciales ressortait plutôt de la théorie de l’institution ou plutôt de la liberté contractuelle laissée aux parties. La nature de la société oscille entre ces deux conceptions. Le débat emporte de nombreuses conséquences pratiques. Si dans un premier temps c’est la théorie institutionnelle qui a dominé, on constate depuis quelques années un regain de faveur pour la théorie contractuelle en réaction à une législation jugée trop contraignante1. La pratique ainsi qu’une grande partie de la doctrine se montre extrêmement favorable à l’aménagement du fonctionnement des sociétés, en particulier des sociétés par actions, qui le permettent plus aisément. C’est dans ce cadre de regain de contractualisation de la vie de la société que s’inscrit la question de l’application de techniques civilistes aux valeurs mobilières, éléments spécifiques aux sociétés commerciales, au droit des sociétés. La contractualisation des valeurs mobilières est un des éléments les plus utiles à l’assouplissement de la vie sociétaire, favorisant l’activité des affaires. La contractualisation des valeurs mobilières par l’application de techniques proprement civilistes marque une volonté de liberté contractuelle qui doit s’accommoder des spécificités du droit des sociétés. Deux courants s’affrontent donc. Les rédacteurs du Code civil comme du Code de commerce envisageaient la société comme un contrat. L’article 1832 du code civil disposait (jusqu’à la loi du 11 juillet 1985) que « La société est un contrat… ». Le code de commerce n’avait consacré que 46 articles aux sociétés, la loi du 24 juillet 1867 en comprenait une soixantaine. Selon cette conception d’essence anglo-saxonne, c’est la liberté contractuelle qui doit dominer, sous réserve de l’ordre public des articles 6 et 1134 du Code civil. Tout ce qui n’est pas expressément interdit doit être autorisé. Comme tout contrat, elle doit donc avoir, par exemple, un objet licite. La loi de 1994 instaurant la société par actions simplifiée marque le regain de la théorie contractuelle ces dernières années en laissant une très grande liberté aux parties. 1 Monsallier (M.-C.) : L’aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme, L.G.D.J, 1998 ; Guyon (Y.) : Traité des contrats, Les sociétés, Aménagements statutaires et conventions entre associés, L.G.D.J., 4ème édition, 1999, n° 8. La conception de la société peut aussi être d’inspiration légale ou institutionnelle. Elle suppose alors une subordination des intérêts particuliers aux fins poursuivies par la société. Selon la définition de l’institution d’Hauriou, la société s’entendrait alors comme une organisation emprunte d’autorité visant à la satisfaction d’une idée mère. Cette conception germanique a inspiré la loi de 1966 qui a instauré un système d’une grande rigidité et laisse une large place à l’ordre public et à l’intérêt alors que ce système peut aussi être plus ou moins marqué et seulement fixer les règles générales en laissant une place à la liberté des parties. Ainsi s’explique que la société et le droit des associés ne soient pas figés par l’acte constitutif de la société, mais puissent être modifiés par une décision ultérieure. L’article 24 de la loi du 8 août 1994 abaissant le quorum des assemblées générales extraordinaires est une manifestation de cette théorie. Cette conception justifie les nombreuses interventions législatives visant à surveiller l’activité des sociétés dans la vie économique. La loi du 11 juillet 1985 est la consécration officielle de cette théorie. La société est maintenant « instituée » et non plus constituée. Selon Monsieur le Professeur Guyon, cette modification terminologique doit s’expliquer par l’apparition de la société unipersonnelle plutôt que par une véritable volonté de faire triompher la théorie institutionnelle. Face à cette rigidité des règles, la pratique a tenté de réintroduire des espaces de liberté contractuelle pour faciliter la rapidité et la souplesse de la vie des affaires. Cette place laissée à la liberté peut passer par des aménagements statutaires ou par des conventions extra-statutaires, comme les conventions de vote, les aménagements dans l’organisation interne des organes des sociétés, la conclusion de conventions visant à augmenter la stabilité des dirigeants… c’est dans cet esprit que se développent les techniques envisagées appliquées aux valeurs mobilières. La pratique a, pour ce faire, utilisé les valeurs mobilières qui permettent entre autres d’acquérir la qualité d’actionnaire d’une société, de participer à la vie sociétaire et d’accéder aux fonctions électives, en leur appliquant un certain nombre de techniques connues. C’est cette application de techniques civilistes aux valeurs mobilières qui sera l’objet de notre étude ; il convient d’en définir les contours avec précision. 1) Définition des termes du sujet L’intitulé du sujet de cette étude comprend deux expressions qui méritent d’être définies afin de mieux les cerner et de mieux envisager les frontières de ce mémoire. • Les valeurs mobilières - Eléments de définition des valeurs mobilières Les valeurs mobilières – expression que nous devons au préalable définir- sont très nombreuses et reçoivent des applications variées. Toutes ne font pas l’objet de la contractualisation des sociétés telle que nous l’envisageons. Il convient donc d’en dresser un rapide inventaire et de ne se concentrer que sur celles intéressant notre matière. Selon la doctrine - qui reprend la définition donnée par le règlement général de la SICOVAM et par la circulaire du 8 août 1983 relative au régime des valeurs mobilières, « Le terme de valeurs mobilières s’entend d’un ensemble de titres de même nature, cotés ou susceptibles de l’être, issus d’un même émetteur et conférant par eux-mêmes, des droits identiques à leurs détenteurs ; et tous les droits détachés d’une valeur mobilière, négociables ou susceptibles de l’être (droits de souscription ou d’attribution) sont assimilés à une valeur mobilière »2. Ou encore plus simplement ce sont « les titres de capital ou de créance, négociables conférant des droits identiques par catégorie ». Et pour conclure, la vision du romancier que cite Monsieur le Professeur Cozian : - « Qu’est-ce que ces actions, je ne comprends pas bien ? demanda Ivan Matvéevitch. - C’est une invention allemande ! dit Tarantiev, agressif. Par exemple, un arnaqueur trouve un procédé pour construire des maisons qui résistent au feu. Il décide de bâtir toute une ville : il a besoin d’argent. Alors, il met en vente des bouts de papier, disons de cinq cent roubles chacun ; une foule d’imbéciles les achète et les revend les uns aux autres. Le bruit court que l’entreprise marche bien, le prix des papiers monte ; ou qu’elle marche mal, et tout s’effondre. Il te reste des bouts de papier, mais ils ne valent uploads/S4/ application-des-techniques-civilistes-aux-valeurs-mobilieres.pdf
Documents similaires
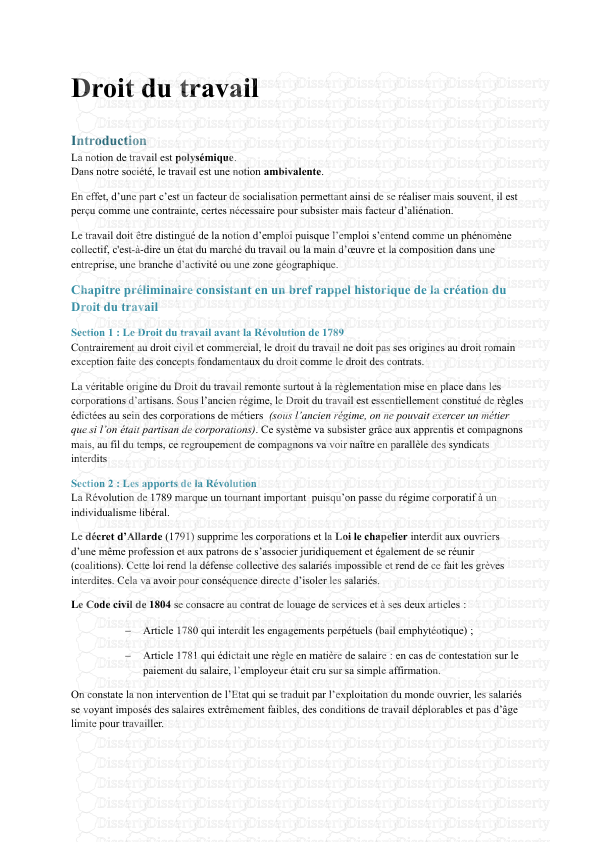









-
50
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 31, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2604MB


