INTRODUCTION Le droit du commerce international est-il une discipline autonome
INTRODUCTION Le droit du commerce international est-il une discipline autonome ? Cette question est valable pour toutes les disciplines qui gravitent autour du droit civil (droit commun qui régit les relations entre les personnes). Certaines disciplines envisagent certains types de rapports dans certaines circonstances (droit de la consommation, droit commercial…). L’autonomie du droit commercial peut ainsi se poser : le droit commercial est une discipline juridique autonome parce qu’il a un objet spécifique (régir les relations entre commerçants) et parce qu’il répond à des critères précis. Les sources du droit commercial sont aussi autonomes du droit civil (regroupées dans le Code de commerce). Enfin, le droit commercial répond à des méthodes qui lui sont propres (titres cambiaires…). Le droit du commerce international est dans la même position avec le droit international privé que l’est le droit commercial avec le droit civil : objets, sources et méthodes doivent être envisagés. §1 L’histoire du droit du commerce international Le commerce résulte de la vente. Avant l’apparition de la notion de monnaie, il n’y avait pas de vente mais seulement des échanges (forme primitive). Il n’y avait donc pas de spéculation. Il n’y avait pas de richesse, pas de gain dans l’échange. L’apparition de la monnaie permet la substitution de la vente à l’échange, chez les peuples antiques en tant qu’élément de base de l’économie, et donc l’apparition du gain c’est-à-dire l’origine du commerce. Ainsi, le premier acte de commerce définit dans le Code de commerce est l’achat en vue de la revente. Le commerce remonte donc à l’Antiquité et, est immédiatement international : les phéniciens (Liban) commercent avec l’Afrique du nord, la Gaulle, le Moyen-Orient… L’apparition du commerce ne signifie pas forcément l’apparition d’un droit spécifique aux relations commerciales. A Rome, le commerce était très largement développé. Pourtant, les commerçants ne disposaient pas d’un droit propre (même contrat que celui des individus contractants : le droit civil régissait toutes les opérations). La première véritable expérience de droit commercial entendu comme un droit spécifique aux commerçants remonte au XIXème siècle. Elle apparait dans les foires marchandes d’Europe occidentale (foire de Champagne, foire de Francfort, de Bruges, de Troyes et en Italie du nord). On parle à l’époque uniquement d’un droit des marchands (lex mercatoria) et non de droit commercial. Un droit spécifique des marchands apparait en raison de : - La diversité des droits. A cette époque, le droit est morcelé (entre coutumes selon les provinces). Les rapports entre les peuples de différentes provinces sont rares (mariage…). En revanche, pour les marchands, cette diversité des coutumes devient gênante : dans les foires, les différents provinciaux se rencontrent et leurs différentes coutumes se rencontrent. Pour lutter contre cette diversité, source d’insécurité, les marchands vont peu à peu forger un droit qui leur est propre, qui leur est unique. Les règles coutumières s’unifient pour les marchands pour lutter contre cette insécurité. - Certaines spécificités des relations entre marchands justifient l’apparition de relations propres aux marchands. Le contrat de change est ainsi une création de la pratique marchande qui est expliquée par l’apparition des foires de Champagnes : pour éviter le risque d’attaque lors des déplacements entre provinces avec de l’argent, les commerçants créent le contrat de change. Avec ce contrat, un commerçant lillois peut se rendre à Paris en évaluant l’argent dont il avait besoin, en donnant cet argent contre une lettre constatant la somme (titre représentant la créance) ; à Paris, ce commerçant payait avec le titre à un changeur titre dont le vendeur remettait ce titre à son changeur qui lui remettait l’argent correspondant. Entre changeurs, il s’opère une compensation. Le droit des marchands est donc un embryon du droit commercial et du droit du commerce international. Ce droit des marchands perdure jusqu’à la Révolution. A cette époque, les commerçants s’organisent en corporations qui édictent leurs propres règles (rôle d’édiction de normes). Les corporations se mettent peu à peu à arbitrer les conflits entre leurs membres (rôle de juridiction). En 1563 Charles IX crée les premières véritables juridictions commerciales. Colbert (sous Louis XIV) rend une ordonnance unifiant le droit du commerce. La Révolution fait table rase du passé : suppression des juridictions commerciales… Après ce mouvement, un mouvement inverse réincorpore les développements passés et un mouvement de Codification a lieu (1804 : Code civil ; 1807 : Code de commerce). Le droit commercial devient un droit écrit et unifié pour l’ensemble de la France. Les conflits de coutumes disparaissent donc. Il y a alors une véritable distinction entre le droit commercial interne et le droit du commerce international (pour les relations avec d’autres Etats que la France). L’Europe devient une aire de guerre. Elle reste déchirée jusqu’en 1945. De 1799 à 1945 un nationalisme particulier marque les relations internationales. Les relations sont donc réduites. Après la seconde guerre mondiale, le commerce international se développe à nouveau de même que le droit du commerce international. §2 L’objet du droit du commerce international L’objet du droit du commerce international est de règlementer les relations d’affaires internationales. A Le caractère international Le caractère international peut être a priori défini comme dans les autres domaines du droit soit comme en droit international privé. L’internationalité correspond alors à l’existence de point de contacts avec plusieurs ordres juridiques étatiques. Il faut donc distinguer la situation interne (point de contact avec un seul ordre juridique étatique) de la situation internationale (point de contact avec un autre Etat que la France). Le point de contact est appelé élément d’extranéité (siège social d’une société, lieu de conclusion ou d’exécution d’un contrat, nationalité des parties, résidence des parties, choix d’une législation étrangère, saisine d’un juge étranger…). Cet élément correspond aux « critères juridiques de l’internationalité ». Il est généralement jugé suffisant pour déclencher l’application des règles du droit international c’est-à-dire soit celles du droit international privé soit celles du droit du commerce international. Les règles de conflit de lois sont déclenchées par l’existence d’un élément d’extranéité. Pour savoir si les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat, il faut savoir si le contrat est international et pour le savoir il faut recherche un élément d’extranéité. Le critère juridique est normalement suffisant. Parfois, certaines règles sont plus importantes et supposent un élément plus marqué. Il s’agit des « règles matérielles internationales ». L’internationalité doit être plus nette que dans l’élément d’extranéité. Une règle matérielle (de fond, qui régit directement les relations) est ainsi par exemple une clause valeur or ou une clause désignant une monnaie étrangère. En droit interne, afin de garantir l’effectivité de la monnaie nationale, il est interdit d’utiliser une monnaie étrangère ou l’or (au Liban, cette règle n’existe pas : il est possible de payer en dollars ou en livre libanaise). Cette règle n’est plus adaptée dès lors que l’on envisage une relation internationale : une monnaie doit être choisie et donc, une monnaie nationale sera écartée (voir même les deux). Rapidement, la règle matérielle de droit français interdisant la référence à l’or ou à une monnaie étrangère est doublée d’une règle internationale contraire. A partir de quand la situation est-elle internationale (afin de savoir si la règle internationale peut s’appliquer) ? L’élément d’extranéité n’est pas suffisant pour justifier la mise à l’écart de la règle interne au profit de la règle internationale (exemple de Goldman : acheter une bouteille de Coca à l’épicier algérien du coin : il y a un élément d’extranéité). Il faut plus qu’un simple critère juridique. Il faut une véritable mise en cause du commerce international. On choisit donc un critère renforcé : le critère économique. L’internationalité doit être réelle : la situation met-elle réellement en jeu les intérêts du commerce international ? Le critère juridique est donc maintenu pour les règles de conflit de loi. Pour l’élément d’extranéité, le critère juridique doit être doublé du critère économique. Matter (conseiller à la Cour de Cassation) définit le critère économique dans ses conclusions sur l’arrêt de la Cour de Cassation de 1927, Pélissier Du Besset : le critère économique est « un double mouvement de flux ou de reflux, au-delà des frontières, de valeurs, de biens ou de services, des conséquences réciproques dans un pays et dans un autres ». Il peut s’agir d’un paiement transfrontière, d’une livraison dans un autre Etat… Un simple mouvement de flux suffit (paiement transfrontière) ; le reflux n’est pas toujours nécessaire. Deux questions se posent : - Conflictuelle : Quand met-on en œuvre la règle de droit (internationalité conflictuelle : à laquelle répond le critère juridique, c’est-à-dire l’élément d’extranéité) ? - Matérielle : Qui répond à un critère économique (flux de valeurs, de services par-delà les frontières). B Le caractère commercial Il n’y a ici aucun critère relatif au caractère commercial. En droit interne, l’article L.110-1 du Code de commerce distingue l’activité commerciale de l’activité civile, pas en droit du commerce international. En effet, la distinction du civil et du commercial est peu rependue en droit comparé. Les pays qui l’adoptent ne retiennent d’ailleurs pas forcément les mêmes critères que le droit français. De plus, les règles du droit uploads/S4/ code-de-commerce-1-l-histoire-du-droit-du-commerce-international.pdf
Documents similaires







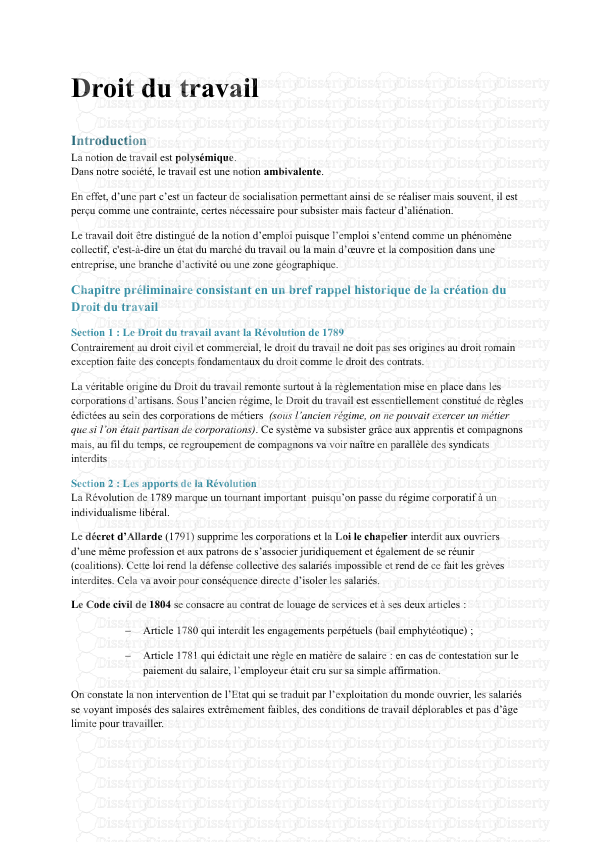


-
93
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.3574MB


