[TYPE THE DOCUMENT TITLE] 1 DROIT DES OBLIGATIONS II T.D. n°7 : La causalité Co
[TYPE THE DOCUMENT TITLE] 1 DROIT DES OBLIGATIONS II T.D. n°7 : La causalité Commentaire : Civ. 1ère 24 septembre 2009 L’affaire dont il est question dans cet arrêt est bien connue du grand public. La prise du DES, hormone de synthèse découverte en 1938 et bien connue pour diminuer les risques de fausse couche, fut très répandue dans la France d’après-‐guerre, à la faveur de la politique nataliste menée alors. Cependant, dès les années 50, des doutes furent émis sur l’efficacité de ce médicament et les années 70 virent se multiplier les études scientifiques en dénonçant les effets secondaires particulièrement néfastes. Il fut ainsi établit un lien entre la prise du DES et la survenance de cancers du col de l’utérus chez des jeunes femmes ayant été exposées in utero. Le DES est alors retiré du marché français en 1976 et devient même, l’année suivante, contre-‐indiqué aux femmes enceintes. Il a fallu attendre 2006 pour que la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur les affaires liées aux dommages causés par le DES. Mais alors que ces premiers arrêts statuaient uniquement sur la faute des laboratoires commercialisant ce médicament en retenant un manquement à une obligation de vigilance, les arrêts du 24 septembre 2009 se prononcent sur le lien de causalité entre les fautes des laboratoires et les graves affections dont souffraient les victimes. L’extrait que nous avons ici à commenter est issu d’un de ces arrêts : celui rendu par la Première Chambre civile le 24 septembre 2009. En l’espèce, une femme atteinte d’un cancer avait assigné en réparation du préjudice subit les deux laboratoires fabriquant le DES, en invoquant le lien de causalité entre sa maladie et la prise de ce médicament durant la grossesse de sa mère. Mais la victime ne parvenait pas à établir lequel des deux laboratoires avait fabriqué le produit ingéré par sa mère. La Cour d’appel la débouta de sa demande en retenant que le fait que les deux laboratoires aient mis sur le marché la molécule à l’origine du dommage (fait non contesté) ne peut fonder une action collective, ce fait n’étant pas en relation directe avec le dommage subit par la victime, et aucun élément de preuve n’établissait l’administration à celle-‐ci ni du médicament fabriqué par UCB Pharma ni de celui fabriqué par Novartis. La demanderesse s’est alors pourvue en cassation. La question de droit à laquelle les magistrats de la haute juridiction doivent répondre est alors la suivante : la charge de démontrer quel labo a été le fabricant du médicament litigieux repose-‐t-‐elle sur la victime ? 2 [TYPE THE DOCUMENT TITLE] La Cour de cassation, en répondant négativement à cette question, a pris le parti de favoriser la victime dès lors qu’il est établit que le DES est la cause directe de la pathologie. L’arrêt est rendu aux visas des articles 1382 et 1315 du Code civil. En effet, faute de pouvoir appliquer le droit issu de la directive du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux en raison de la date de mise en circulation du produit, c’est sur le fondement du droit commun que statuent les tribunaux. Ce faisant, la recherche d’une solution équitable pour les victimes a poussé les juges de la Cour de cassation a posé une nouvelle présomption de causalité (I), laissant aux défendeurs la tâche ardue de prouver leur innocence (II). w w w I. Une présomption de causalité poussée par l’équité Cette solution qui cherche à favoriser le sort des victimes (A), pose une présomption de causalité dont le caractère novateur est à discuter (B). A) Une solution qui favorise le sort des victimes L’arrêt rendu en appel impose à l’initiatrice d’une demande en responsabilité d’établir qu’elle a été exposée à la molécule DES sous la forme de celle fabriquée par l’un des deux laboratoires impliqué dans sa commercialisation à l’époque des faits (Distilbène ou Stilbestrol) et que le médicament a été la cause du dommage. Il est donc nécessaire pour la demanderesse de prouver la causalité entre le fait générateur et le dommage subit. Cette condition est en soi tout à fait classique mais peut s’avérer particulièrement lourde pour la plupart des victimes concernées par le DES. En effet, bien que la preuve du lien de causalité puisse résulter des expertises scientifiques produites par les plaignantes, les victimes du DES se heurtent à la difficulté de retrouver, des dizaines d’années après, des éléments de preuve matérielle attestant la prise du médicament par leurs mères (ordonnances, certificats médicaux,…) et précisant de quel médicament il s’agit. La solution retenue par la Cour de cassation, consistant à transférer aux laboratoires pharmaceutiques la charge de démontrer que leur produit n’a pas été administré aux mères des femmes atteintes d’adénocarcinomes, vise bien sûr à favoriser le sort des victimes. Il leur appartient désormais seulement de prouver que leur préjudice découle directement de leur exposition au DES durant la grossesse de leur mère. [TYPE THE DOCUMENT TITLE] 3 B) Une « nouvelle » présomption de causalité 1/ L’inspiration d’une jurisprudence antérieure Pour engager la responsabilité d’un des laboratoires, un lien doit permettre d’identifier l’auteur de la faute à l’origine du dommage (en plus du lien de causalité permettant de désigner le produit à l’origine du dommage). La présomption ici admise par la Cour de cassation rappelle celle que la jurisprudence pose lorsque le dommage est causé par une personne non identifiée faisant partie d’un groupe déterminé de personnes. Dans cette hypothèse, si une incertitude pèse sur l’identité de l’auteur du dommage, les juges admettent que la responsabilité du dommage, résultant d’une « action commune » incombe in solidum à chacun des participants, ce qui revient à présumer, jusqu’à preuve du contraire, le caractère causal de la participation de chacun d’eux (G. Viney et P. Jourdain, Les conditions de la responsabilité). En censurant en l’espèce l’arrêt qui avait écarté la responsabilité des laboratoires au motif qu’elle ne pouvait être fondée sur une « action collective », la Cour de cassation semble s’inspirer de cette jurisprudence (voir notamment Civ. 2e, 5 février 1960 sur la garde collective de la « gerbe de plomb »). L’avant-‐projet Catala de réforme du droit des obligations a d’ailleurs souhaité entériner et même élargir cette jurisprudence en proposant que « lorsqu’un dommage est causé par un membre indéterminé d’un groupe, tous les membres identifiés en répondent solidairement sauf pour chacun d’eux à démontrer qu’il ne peut en être l’auteur » (art. 1384 nouv. c.civ.). Puisqu’il appartient à chaque laboratoire de prouver que son produit n’est pas à l’origine du dommage, c’est bien une présomption de causalité qui pèse sur chacun d’eux. 2/ Une nouvelle jurisprudence quelque peu novatrice Mais l’arrêt en l’espèce ne respecte pas scrupuleusement les conditions d’application de cette jurisprudence qui fut surtout appliquée à des chasseurs, à des sportifs ou à des enfants participant à une activité collective et agissant ensemble en formant un groupe auquel appartenait l’auteur resté anonyme. Tel n’était pas le cas en l’espèce. Aucune « action commune » émanant des membres d’un véritable « groupe » de personnes ne pouvait être relevée pour justifier leur responsabilité in solidum. Le simple fait que le médicament ait été mis sur le marché à une même époque ne suffisait certainement pas à constituer un tel groupe et à révéler une action collective des laboratoires, qui n’agissaient nullement ensemble. L'avant-‐projet Catala avait ainsi proposé une extension de la responsabilité collective en observant, dans une note, que la responsabilité solidaire pourrait apporter une solution à des situations nouvelles, en particulier « en cas de dommages causés par un produit distribué par quelques entreprises, toutes identifiées, lorsqu'on ne peut établir laquelle d'entre elles a vendu le produit même qui est à l'origine des préjudices subis par les victimes ». Mais, plus prudente, la Cour de cassation avait marqué les limites de sa jurisprudence dans une affaire de contamination transfusionnelle par le VHC, où elle refusait de condamner un fournisseur de produits sanguins 4 [TYPE THE DOCUMENT TITLE] alors qu'un autre avait également fourni de tels produits sans que l'on sache lesquels étaient contaminants (Civ 1re, 28 mars 2000). uploads/S4/ commentaire-d-x27-arret-civ-1ere-24-septembre-2004.pdf
Documents similaires
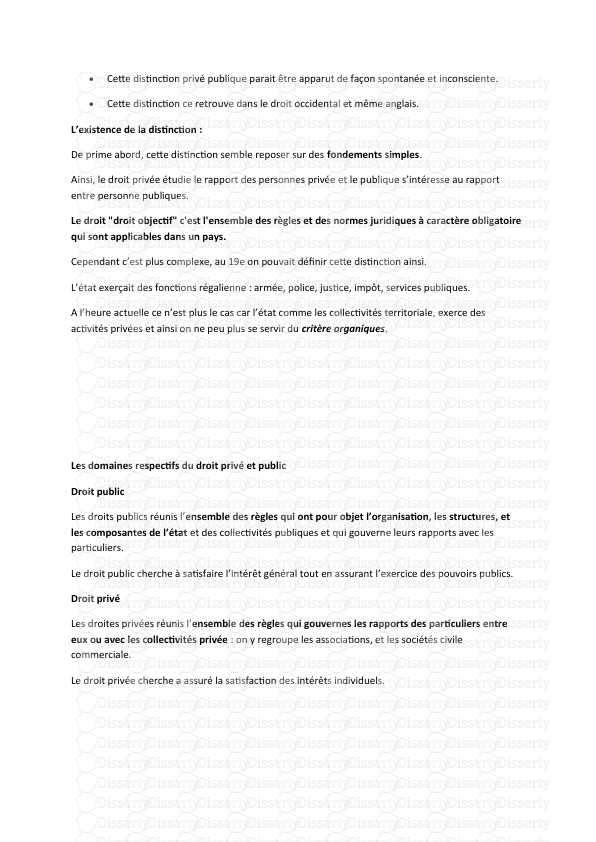









-
44
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 04, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0790MB


