PLAN Introduction 1- Conditions de fond a- Conditions de droit commun b- Transp
PLAN Introduction 1- Conditions de fond a- Conditions de droit commun b- Transposition au droit des sociétés 1- La capacité selon la forme de société 2- Le consentement Sur quoi doit porter le consentement des associés Résulte de quoi { signature des statuts} Objet {principe de spécialité| raison juridique-licite Les frontières entre la cause et objet 2- Conditions de forme et de publicité a- Conditions de forme L’exigence d’un écrit { statuts} La nature juridique La rédaction des statuts Enregistrement des statuts b- Les conditions de publicité Le dépôt du greffe L’immatriculation au RC La publication L’importance du guichet unique INTRODUCTION . Le dahir formant code des obligations et contrats marocain est un code voyageur. Originaire de Tunisie, pays qui l’a vu naître, cette expérience juridique passera par le Maroc, la Mauritanie et finira par influencer le code libanais des obligations de 1932. « Noyau dure d’un code maghrébin » le DOC est l’exemple d’un code réussi. Aidé par l’écoulement du temps mais aussi par une jurisprudence dynamique, le DOC est en 2013 un fort séculaire. Il est donc nécessaire de faire l’histoire du DOC, non pour établir des vérités, l’histoire du droit étant un chantier perpétuel, mais au moins pour déterminer les acteurs et analyser les logiques qui ont donné naissance au DOC. En droit marocain, le contrat de société est définie comme un acte juridique, par lequel un ou plusieurs associés conviennent d'affecter des apports à une entreprise commune, en vue de réaliser et de partager des bénéfices, ou de profiter des économies qui en résultent. Ce contrat spécial est défini au DOC , et régi par des dispositions spécifiques du Code civil et du Code de commerce, selon la forme de la société. Quel que soit le contrat, sa formation exige la réunion de plusieurs conditions qu’il faut d’abord étudier. La conclusion du contrat répond à des conditions de fond et à des conditions de forme et publicités. Mais il faut également s’interroger sur le sort du contrat lorsque l’une des conditions fait défaut, ce qui nous conduira à envisager la nullité du contrat. À la lumière de ce qui a été développé ci-dessus, il convient de nous poser les questions suivantes : est-ce qu’on se contente de l’autonomie de la volonté ou le législateur vent qu’on la dépasse ? Pour répondre à cette Interrogation, nous optons pour un plan de deux parties : Nous allons traiter les conditions de fond comme première partie puis les conditions de forme et de publicité comme deuxième partie. . Partie I : Les conditions de fond Le contrat de travail se soumet aux règles de droit commun [consentement, capacité, objet, cause]. Comme tout contrat, le contrat de travail ne pourra être considéré conclu s’il a été vicié par dol, erreur ou violence. Il s’agit d’un contrat emprunt de consensualisme [accord de volontés]. Ainsi, la phase précontractuelle peut reposer sur des pourparlers, ou encore sur une promesse d’embauche. Le consentement est parfois difficile à déterminer. Ainsi, le consentement, comme en droit commun, ne doit pas avoir été obtenu par dol, violence ou erreur. La promesse d’embauche va engendrer l’obligation de conclure le contrat de travail. Pour que celle-ci soit valable, elle doit être ferme, adressée à une personne désignée, contenir les éléments essentiels du contrat de travail. Les règles de capacité sont celles du droit commun - Les mineurs non émancipés doivent pour effectuer une prestation avoir l’autorisation d’un représentant légal - Les majeurs sous tutelle peuvent exercer, mais doivent être représentés. Le contrat doit avoir un objet, il consiste en la rémunération pour le salarié, et en la prestation pour l’employeur. Partie 1. Les conditions du droit commun Les conditions de validité du contrat sont prévues par l’article 2 du D.O.C dispose qu’il faut la capacité de s’obliger, une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l’obligation, un objet certain pouvant former objet d’obligation et une cause licite de s’obliger. Section 1. Le consentement Le consentement doit être libre et éclairé, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être vicié. En effet, si l’une des parties n’a pas donné son consentement en pleine connaissance de cause, ou si elle a subi une pression, son consentement est vicié. L’article 39 du DOC répertorie trois vices du consentement à savoir l’erreur, le dol et la violence. L’erreur peut être définie comme l’appréciation inexacte de la réalité qui est spontanée et ne nécessite pas la mauvaise foi. Elle doit être déterminante. Par contre, le dol est le fait d’induire une personne en erreur. Il nécessite la mauvaise foi. Quant à la violence, c’est le fait de recourir à la force pour obliger quelqu’un à conclure un contrat. Section 2. La capacité Pour pouvoir conclure un contrat de travail, les parties doivent disposer. De la capacité nécessaire. Les principes de droit civil de la capacité s’appliquent à l’employeur et au travailleur en tant que partie au contrat. Pour les travailleurs mineurs d’âge, il existe cependant des règles particulières relatives à la capacité pour la conclusion et la rupture d’un contrat de travail. Pour l’employeur cela peut- être une personne physique ou morale. Pour le salarié cela ne peut s’agir que d’une personne physique. Ils doivent tous les deux la capacité de contracter. Les incapables selon l’article 217 du code de la famille, le majeur sous tutelle peut signer un contrat avec l’accord de son tuteur. Le mineur, peut signer un contrat à partir de 14ans [contrat d’apprentissage] avec l’accord de son représentant légal SAUF SI le mineur est émancipé. Personne de nationalité, étrangère, il peut travailler s’il est titulaire d’une carte ou d’un titre de séjour et d’une autorisation légale. Section 3. L’objet Il convient de préciser que le contrat crée des obligations et que ce sont les obligations issues du contrat qui ont un objet. L’objet dont il s’agit ici n’est donc pas, à proprement parler, l’objet du contrat mais l’objet des obligations contractuelles. Ce n’est que par commodité et par raccourci que l’on parle de l’objet du contrat au lieu de parler de l’objet de l’obligation contractuelle. Par conséquent, l’objet peut être défini comme ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier. La validité du contrat est subordonnée à l’existence de l’objet selon l’article 2 du DOC, à la détermination de l’objet prévue par l’article 58 du DOC et à la licéité de l’objet conformément à l’article 57 du même dahir. Section 4. La cause La cause est une notion contrversée ; certains auteurs n’en voient pas la nécessité mais la Cour de cassation maintient que la cause constitue un élément nécessaire à la validité d’un contrat. La cause est définie dans les contrats synallagmatiques comme la prestation du cocontractant. Ainsi, si je vends une maison, c’est pour recevoir un prix ; le prix est donc la cause de mon engagement. Deux époux établissent deux testaments qui, ensemble, visent à réaliser le partage le plus équitable de leurs biens entre leurs enfants ; l’un des testaments est annulé ; l’autre l’est aussi mais pour défaut de cause. Plusieurs auteurs ne voient pas l’utilité de ce concept dans cette acception et définissent la cause comme les mobiles déterminants entrés dans le champ contractuel. Que signifie « entrés dans le champ contractuel ? » Il faut que les motifs déterminants d’une partie soient connus ou ne puissent être ignorés du cocontractant et que celui-ci les ait acceptés, fût-ce tacitement comme éléments du contrat.41 L’on peut prendre l’exemple suivant ; j’achète un terrain sur lequel je crois comme le vendeur que je vais pouvoir bâtir ; je paie le prix d’un terrain à bâtir ; par la suite, il apparaît que ce terrain n’était pas constructible car ne répondant pas à certaines normes urbanistiques. La constructibilité est entrée dans le champ contractuel et le contrat pourra être annulé pour défaut de cause. . Est nul le contrat dépourvu de toute cause mais aussi le contrat entaché d’une cause illicite. Vous louez une maison dans l’unique but d’y exercer un trafic de drogue, le contrat est nul pour cause illicite. Pour être valablement formé, le contrat doit avoir une cause et cette cause doit être licite selon l’article 2 et 62 du DOC. CHAPITRE 2. Transposition au droit des sociétés Le contrat de société est un contrat spécial, le législateur a essayé d’adopter des conditions de validité du contrat pour répondre à quelques objectifs. Section 1. La capacité Dans le cadre des sociétés, l'exigence de la capacité varie selon la forme de société et le type des associés. Dans les sociétés de personnes1, les associés dans une société en nom collectif, des commandités au niveau de la société en commandite simple et des gérants des sociétés en participation2 doivent avoir la capacité commerciale. Par conséquent, le mineur et les incapables majeurs ne peuvent pas être associés dans une société en nom collectif, ou associés commandités dans une société en commandita simple ou une société en commandite par actions, car dans ces différentes situations, l'associé acquiert la qualité de commerçant. Par conséquent, le mineur uploads/S4/ conditions-de-formation-du-contrat.pdf
Documents similaires









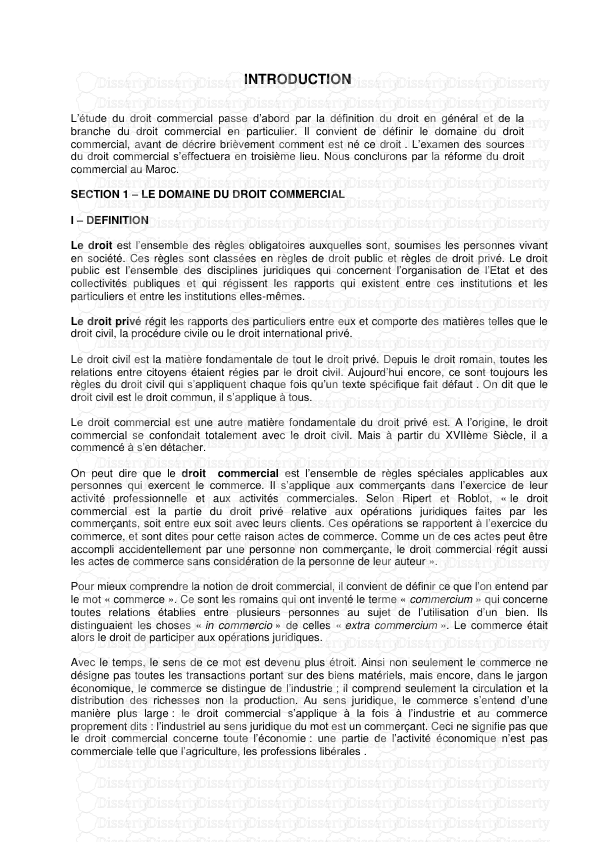
-
54
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 27, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1909MB


