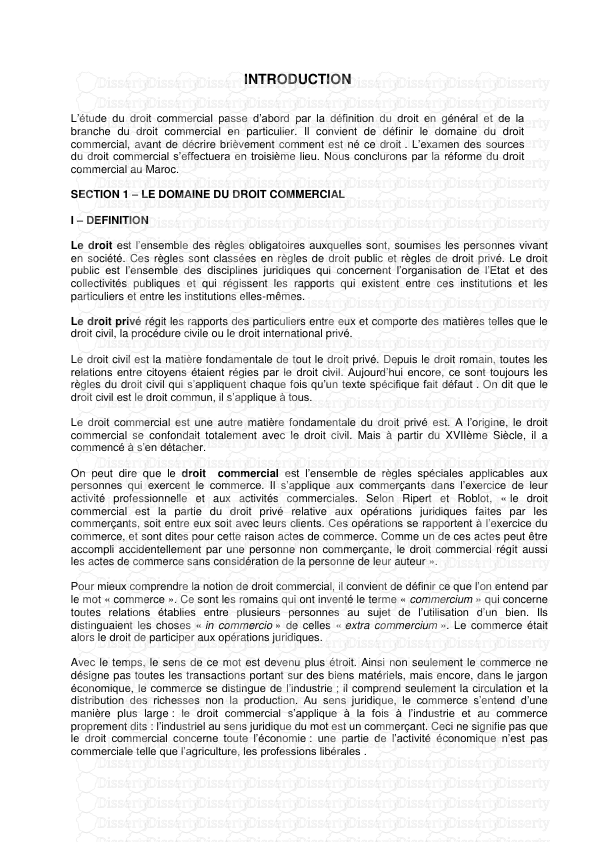INTRODUCTION L’étude du droit commercial passe d’abord par la définition du dro
INTRODUCTION L’étude du droit commercial passe d’abord par la définition du droit en général et de la branche du droit commercial en particulier. Il convient de définir le domaine du droit commercial, avant de décrire brièvement comment est né ce droit . L’examen des sources du droit commercial s’effectuera en troisième lieu. Nous conclurons par la réforme du droit commercial au Maroc. SECTION 1 – LE DOMAINE DU DROIT COMMERCIAL I – DEFINITION Le droit est l’ensemble des règles obligatoires auxquelles sont, soumises les personnes vivant en société. Ces règles sont classées en règles de droit public et règles de droit privé. Le droit public est l’ensemble des disciplines juridiques qui concernent l’organisation de l’Etat et des collectivités publiques et qui régissent les rapports qui existent entre ces institutions et les particuliers et entre les institutions elles-mêmes. Le droit privé régit les rapports des particuliers entre eux et comporte des matières telles que le droit civil, la procédure civile ou le droit international privé. Le droit civil est la matière fondamentale de tout le droit privé. Depuis le droit romain, toutes les relations entre citoyens étaient régies par le droit civil. Aujourd’hui encore, ce sont toujours les règles du droit civil qui s’appliquent chaque fois qu’un texte spécifique fait défaut . On dit que le droit civil est le droit commun, il s’applique à tous. Le droit commercial est une autre matière fondamentale du droit privé est. A l’origine, le droit commercial se confondait totalement avec le droit civil. Mais à partir du XVIIème Siècle, il a commencé à s’en détacher. On peut dire que le droit commercial est l’ensemble de règles spéciales applicables aux personnes qui exercent le commerce. Il s’applique aux commerçants dans l’exercice de leur activité professionnelle et aux activités commerciales. Selon Ripert et Roblot, « le droit commercial est la partie du droit privé relative aux opérations juridiques faites par les commerçants, soit entre eux soit avec leurs clients. Ces opérations se rapportent à l’exercice du commerce, et sont dites pour cette raison actes de commerce. Comme un de ces actes peut être accompli accidentellement par une personne non commerçante, le droit commercial régit aussi les actes de commerce sans considération de la personne de leur auteur ». Pour mieux comprendre la notion de droit commercial, il convient de définir ce que l’on entend par le mot « commerce ». Ce sont les romains qui ont inventé le terme « commercium » qui concerne toutes relations établies entre plusieurs personnes au sujet de l’utilisation d’un bien. Ils distinguaient les choses « in commercio » de celles « extra commercium ». Le commerce était alors le droit de participer aux opérations juridiques. Avec le temps, le sens de ce mot est devenu plus étroit. Ainsi non seulement le commerce ne désigne pas toutes les transactions portant sur des biens matériels, mais encore, dans le jargon économique, le commerce se distingue de l’industrie ; il comprend seulement la circulation et la distribution des richesses non la production. Au sens juridique, le commerce s’entend d’une manière plus large : le droit commercial s’applique à la fois à l’industrie et au commerce proprement dits : l’industriel au sens juridique du mot est un commerçant. Ceci ne signifie pas que le droit commercial concerne toute l’économie : une partie de l’activité économique n’est pas commerciale telle que l’agriculture, les professions libérales . II – CONCEPTION OBJECTIVE ET SUBJECTIVE DU DROIT COMMERCIAL La doctrine française considère que le droit commercial est à la fois objectif et subjectif. Une règle est objective lorsqu’elle s’applique à certains faits ; juridiques (objets du droit) en raison de leur nature même ou de dispositions de la loi ; elle est subjective lorsqu’elle s’applique à certaines personnes (sujets de droit en raison de leur statut civique ou professionnel. Une conception purement objective voudraient que le droit commercial s’applique aux actes de commerce, c’est-à-dire aux actes qui constituent la vie des affaires, indépendamment de la profession de ceux qui exercent ces actes. Une conception purement subjective voudrait que le droit commercial ne s’applique qu’aux personnes ayant la qualité de commerçant. La conception subjective se prévaut de la tradition. Le droit commercial s’est formé en France par les usages suivis et les règlements établis dans les corporations de marchands. Il était un droit professionnel. Malgré la suppression en France des corporations et la proclamation de l’égalité civile, il a gardé ce caractère professionnel. Cette conception est nette et simple. Aujourd’hui les commerçants sont enregistrés et sauf si le commerce est exercé de manière clandestine, il n’y a pas de doute sur l’exercice de la profession. Mais cette conception se heurte à deux problèmes : d’une part, elle exige une détermination ou un classement légal des professions commerciales et d’autre part, tous les actes accomplis par le commerçant ne se rapportent pas tous à l’exercice de sa profession. Inversement, les personnes qui ne font pas le commerce usent de plus en plus des opérations juridiques inventées pour les commerçants. Ceci nous oblige donc à examiner la nature et la forme des actes, ce qui détruit l’unicité de cette conception subjective. Dans la conception objective, on se base sur les opérations juridiques qui obéissent à des règles particulières car elles constituent des actes de commerce. Ce qui s’explique historiquement puisque cette conception va dans le sens du principe de l’égalité civile proclamé par la Révolution française. En effet, si un code de commerce a été rédigé à cette époque, c’était pour régir non pas une classe particulière de sujets de droit, mais une catégorie d’actes : selon Ripert, c’est un code du commerce et non un code des commerçants . En effet, il est logique d’appliquer les mêmes règles aux mêmes actes quelle que soit la qualité de ceux qui les font. Ex : la loi détermine les règles applicables à la lettre de change peu importe que le signataire soit ou non un commerçant . Mais beaucoup d’actes juridiques tels que le contrat de vente, de transport, de mandat sont utilisés aussi bien dans la vie commerciale que dans la vie civile. Ni leur forme, ni leur objet ne permettent de les caractériser. Il faut alors rechercher pour quelles fins ils ont été passés ; il faut pour cela analyser l’activité économique des contractants pour affirmer qu’ils sont commerciaux parce qu’ils sont faits par des commerçants. On retrouve ainsi la conception subjective du droit commercial. Dans le contexte marocain, le nouveau code de commerce loi n°15-95 du 13 mai 1996 dispose dans son article 1er que « la présente loi régit les actes de commerce et les commerçants ». Ce qui a permis à Didier R. Martin d’affirmer que « le code combine les théories objective et subjective de la commercialité ». Les actes de commerce sont définis par leur nature ou leur forme ou par accessoire. Les commerçants tiennent leur qualité de l’exercice habituel ou professionnel des activités énumérées par le code de commerce. SECTION 2 – L’INFLUENCE HISTORIQUE DU DROIT COMMERCIAL FRANCAIS Le droit commercial marocain s’inspire largement du droit commercial occidental et notamment du droit commercial français. C’est pourquoi, nous examinerons d’abord l’évolution du droit commercial en Europe. Les pratiques des marchands et le développement des échanges ont donné naissance, à toutes les époques, à des techniques ou règles juridiques spéciales. L’examen de l’histoire du droit commercial est plus difficile que celui du droit civil, car le droit commercial n’a pas laissé de traces écrites. C’est un droit qui n’est pas formaliste. Les grandes périodes à distinguer dans l’histoire du droit des affaires sont l’Antiquité, le Moyen-Age et les temps modernes. I – HISTOIRE DU DROIT COMMERCIAL FRANCAIS A – L’ANTIQUITE Des règles relatives au transport de marchandises, à leur vente ou à leur échange ont existé dès la plus haute antiquité. Si on n’en a trouvé que peu de traces dans la civilisation égyptienne, ces traces existent en revanche chez les babyloniens, notamment dans le code d’Hammourabi (Empire de Babylone : 1750 avant Jésus-Christ ; on a retrouvé des traces du prêt à intérêt et des opérations de commission). Après les babyloniens, ce sont les phéniciens qui se sont distingués dans le commerce, notamment dans la navigation et qui sont à l’origine de concepts qui existent encore en droit maritime tels que l’avarie commune qui consiste en un sacrifice commun (ex : le jet à la mer d’une partie de la cargaison ) pour sauver le navire. On ne connaît pas beaucoup de règles aux grecs sauf le prêt nautique connu en droit maritime sous l’expression le prêt à la grosse aventure. Quant aux romains, ils étaient davantage tournés vers l’agriculture et l’apport du droit romain a concerné surtout la théorie générale des contrats et des obligations en droit civil. En matière commercial, le droit romain a réglementé la représentation et les opérations de banque . B – LE MOYEN AGE La naissance d’une véritable branche du droit spécifique aux professionnels et opérations du commerce coïncide avec l’essor du commerce à partir du 11ème siècle dans uploads/S4/ cours-de-droit-commercial-bassime-1.pdf
Documents similaires










-
98
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 06, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.7437MB