Droit constitutionnel Préambule 1) Le travail Le rythme des cours de droit cons
Droit constitutionnel Préambule 1) Le travail Le rythme des cours de droit constitutionnel risque d’être relativement irrégulier durant l’année universitaire. Cela est dû au fait que durant certaines périodes un surplus de travail sera exigé pour réaliser les Travaux Dirigés Les travaux dirigés ont avant tout un rôle d’approfondissement dans les matières les plus fondamentales Le travail exigé est triple : - tout d’abord les cours magistraux qui représentent environ un tiers du travail de l’étudiant. Les exemples qui sont cités aident à retenir les différentes notions du cours. Il faut ensuite créer son propre cours en reprenant l’architecture du cours. Il est donc conseillé de le connaître par cœur. -les TD doivent être préparés à la fois en lisant le dossier de document mais aussi en faisant les exercices. - enfin il est très important de réaliser des recherches personnelles. Il s’agit de lire de grands débats critiques quand indiqué en cours afin de trouver les avis divergents. Il s’agit également de consulter d’autres auteurs, d’autres commentaires. Deux lieux peuvent nous aider dans ce but : la bibliothèque universitaire et l’ENT. Il y est possible de consulter des manuels et des traités constitutionnels. 2) Principes de la matière Le sujet pose un problème auquel il faut répondre par le droit grâce à l’argumentation sans réciter le cours. Le droit français à l’inverse du droit anglo-saxon est un occidental continental qui descend du droit romain. Ils a donc un principe déductif. C’est-à-dire qu’on doit déduire la solution de cas particuliers à partir de notions générales. Des connaissances précises sont donc exigées en devoir ainsi qu’un devoir structuré comportant une introduction et un plan. Le contexte peut également changer le sens d’une définition Les examens peuvent être sous quatre formes différentes : dissertations juridique Commentaire de texte Commentaire d’arrêt Cas pratique 3) Méthodologie Mise en forme d’un devoir I Titre Chapeau A sous-titre Transition B sous-titre Transition II Titre A sous-titre B sous-titre Le plan est hérité d’une tradition il s’agit donc de le respecter à la lettre. De plus le plan doit être visible avec des titres sans phrase, sans verbe conjugué et sans suspens. Toute l’argumentation doit être contenue dans le plan et ne surtout pas figurer dans l’introduction. De plus le devoir ne doit pas comporter de conclusion. Le plan doit être équilibré avec autant d’arguments dans la partie A que la B. De plus l’argumentation doit être logique et ne pas mélanger des arguments incompatibles. L’introduction est l’une des parties les plus importantes du devoir et elle doit comporter 5 points. -1 l’attaque ou accroche, elle est composée d’une citation, d’un clin d’œil à une personne célèbre, d’un cours ou même d’un fait d’actualité en une ou deux phrases. -2 la présentation du sujet, elle consiste dans le cas d’une disserte de reprendre l’énoncé de l’intitulé et dans le cas d’un commentaire de texte de présenter l’auteur ou la source. -3 donner l’intérêt du sujet (c’est la phase la plus longue) c’est le replonger dans son contexte et ainsi comprendre pourquoi on nous demande de le traiter. Il faut donc isoler les termes du sujet pour les définir. Dans le cas d’un commentaire il faudra le donner dans son contexte, son analyse ne viendra que ultérieurement. Le grand intérêt de cette étape et quelle permet de singulariser son devoir. Le but est également de montrer comment le sujet s’insère dans la matière (exemple : fédéral historique, géographique, actualité). -4 la démonstration (problématique) répond au problème posé par le sujet. Dans le cadre du commentaire de texte la démonstration se limite au cadre posé par le texte. Cette étape est relativement courte, pas plus d’une phrase qui se doit d’être toujours affirmative. -5 l’annonce de plan qui donne seulement les deux parties, pas les sous-parties. L’objectif de l’argumentation est de démontrer que notre interprétation est la bonne. Cependant le niveau de langue est important, il faudra utiliser le subjonctif et faire attention à la double négation. L’orthographe est la syntaxe participent également à l’appréciation d’une bonne copie. Introduction Le droit constitutionnel est une des branches du droit qui structure l’ordre juridique d’un pays. Ordre juridique : ensembles de normes juridiques qui s’appliquent d’un pays donné à une époque donné. Toutes ses normes n’ont pourtant pas la même valeur, en cas de conflit certaines l’emportent sur d’autres (règles constitutionnelles). Comprendre l’ordre constitutionnel c’est comprendre la structure juridique. Droit : il possède des sens très différents les uns des autres – il désigne la faculté à accomplir certaines actions ou à prendre certaines décisions (exemple : droit de vote, droit de passer un contrat avec autrui…) -il est également une discipline juridique (ensemble de normes qui régissent un domaine d’activité particulier), exemple : le droit de l’urbanisme, droit des contrats, droit constitutionnel, droit pénal… -une science qui étudie les normes juridiques, leur organisation, les principes qui les régisses et les méthodes qui convient d’appliquer en cas de conflit de norme juridiques. Le droit est donc un concept POLYSEMIQUE s’est à dire qu’il a plusieurs sens. Le droit comme discipline appartient à la branche des sciences sociales car il l’étudie comme une des conséquences tangible de l’organisation sociale. UBI SOCIETAS, IBI JUS (là où il y a société il y a droit). En effet les sociétés sans droit sont très rares et concernent des groupes humains de faible nombre et de faible degré d’organisation. Mais très souvent des règles explicites sont nécessaires, il y a donc création de droit. Il permet de concilier la capacité de liberté de choix des individus et la nécessité d’un ordre social de l’autre pour éviter l’anarchie. Le droit peut également être analysé en tant que discours de pouvoir car il en est l’émanation. Il est créé, édicté, appliqué par les organes du pouvoir dans les sociétés de manière directe ou indirecte. Il est également un moyen de se légitimer pour ceux qui détiennent les capacités de décision ou d’agir en utilisant ses capacités d’action. Le pouvoir est donc encadré par le droit. Exemple : l’Etat peut prélever les impôts mais il est encadré par le droit fiscal. Cet aspect lie le pouvoir et le droit. Cette dimension est centrale dans le droit constitutionnel. Droit constitutionnel : ensemble de règles qui ont pour ambition d’encadrer et de limiter le pouvoir dans l’une de ses manifestation les plus forte, le pouvoir politique qui s’impose à des millions d’individus. Le droit constitutionnel est en équilibre constant entre droit et politique. Le droit constitutionnel correspond surtout à la deuxième et troisième définition du droit (discipline juridique et théorie). Comment cerner le droit constitutionnel ? Quelles sont ses caractéristiques ? Section 1 le droit constitutionnel : une branche du droit Le doit est à la fois un mode de régulation sociale mais aussi en même temps le fruit du discours du pouvoir. Il désigne l’ensemble des règles nécessaires à la vie au sein d’une société donnée. Les premières opinions sur la nature du droit viennent avec le XVIIIème siècle avec KANT dans la métaphysique des mœurs. Il y analyse la notion de règle et distingue les différentes sortes de règles pour identifier les spécificités de chaque règle. Il distingue ainsi deux types : les règles autonomes que chacun s’impose à soi-même, on estime devoir les appliquer sans en être contraint par une puissance extérieure. Elles sont plus ou moins liés aux idées de conscience (règles morales, éthique, religieuses, de politesse….). Les règles hétéronomes sont quand t’a elles des règles imposées par d’autres, par une autorité, une pourvoir (exemple ère moderne : règles juridiques imposées par un Etat. Leur application peut être forcée par un organe du pouvoir. Le droit regroupes l’ensemble des règles édictées et sanctionnés par l’Etat qui s’impose aux individus soumis à l’Etat afin d’organiser les relations sociales. Cette première définition cherche à identifier la nature des règles juridiques par rapport à l’ensemble des règles qui peuvent exister dans une société. Elle donne un contour au droit mais ne donne pas son contenu. Le droit est donc divisé en deux grands ensembles : droit publique et droit privé. Cette distinction est cependant plus pédagogique et la distinction entre les deux n’est pas toujours aussi nette. Le droit Romain est donc ici en parfaite contradiction avec le Comon Law qui ne reconnait pas cette distinction. Comment distinguer droit publique, droit privé ? Comment face à sa complexité y mettre un peu d’ordre ? Dans les sociétés de droit occidental continental, les solutions découlent du système du droit romain. Cet ordre juridique a été élaboré durant l’antiquité romaine durant la république mais surtout durant l’Empire. Ce droit était d’une très grande sophistication mais une très grande partie a disparu durant sa chute. Cependant de nombreuses traces ont été retrouvées au Moyen-Age dans les premières universités en particulier à Bologne. C’est cette analyse du droit romain qui structure les règles juridiques des pays d’Europe occidentale et continental. Cette analyse cherche à distinguer les règles juridiques entre particuliers et celles qui impliquent la puissance publique. 1 Droit privé :( ensemble de règles uploads/S4/ droit-constitutionnel 5 .pdf
Documents similaires







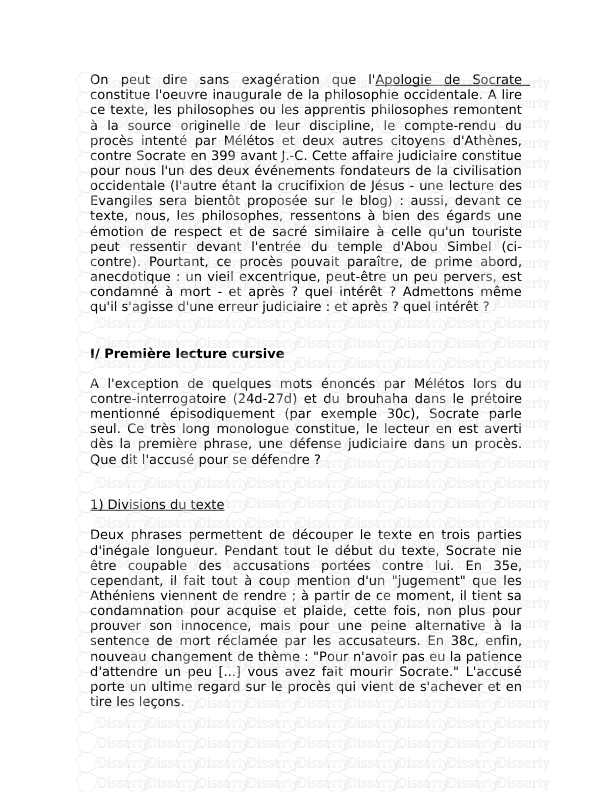


-
86
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.3671MB


