Droit de l’emploi 2011 Gérard COUTURIER Professeur à l’Ecole de droit de la Sor
Droit de l’emploi 2011 Gérard COUTURIER Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université de Paris I) Plan général Première partie – Aspects institutionnels du droit de l’emploi Chapitre 1 - Evolution du service public de l’emploi Section 1 – Emergence du service public de l’emploi Section 2 - La fin du monopole public du placement Section 3 - La réforme de l’organisation du service public de l’emploi (loi du 13 février 2008) Section 4 – Le FNE Chapitre 2 - Droit de l’emploi et droit du chômage Section 1 – Particularisme des sources : paritarisme et droit négocié Section 2 – Droits et devoirs des demandeurs d’emploi Section 3 – La formalisation d’un accompagnement contraignant Section 4 - Contrôles et sanctions Deuxième partie – Politiques de l’emploi Chapitre 1 - Emploi des jeunes, emploi des seniors Section 1 – Des mesures pour l’emploi des jeunes Section 2 - Politique en faveur de l’emploi des seniors Chapitre 2 – Alternance et professionnalisation Chapitre 3 - Insertion, réinsertion et retour à l’emploi Chapitre 4 – Partages du travail Section 1 - Cessations anticipées et mesures d’âge Section 2 – Réduction de la durée du travail Troisième partie — Gestion de l’emploi dans l’entreprise Chapitre 1 – Gestion du temps de travail Section 1 - heures supplémentaires Section 2 - Les forfaits Section 3 - Aménagements du temps de travail Section 4 – Compte épargne temps Chapitre 2 – Gestion prévisionnelle et gestion négociée de l’emploi Section 1 - GPEC et PSE Section 2 - Accords de méthode et négociation du plan de sauvegarde de l’emploi Chapitre 3 - Conversion, reclassement, mobilité Section 1 - Historique des dispositifs de conversion et de reclassement Section 2 - Le congé de reclassement et de mobilité Section 3 - La convention de reclassement personnalisé Section 4 - Le contrat de transition professionnelle Chapitre 4 — Les alternatives au licenciement économique Section 1 - Chômage partiel Section 2 – Plans de départ volontaire 1 Introduction L’objet spécifique d’un cours de droit de l’emploi I – Le droit de l’emploi dans le droit social Ce qui caractérise réellement le droit de l’emploi : la fonction des règles qui le constituent. Orientées vers des objectifs relatifs à l’emploi - des instruments au titre de politiques de l’emploi - des instruments au titre de la gestion de l’emploi dans l’entreprise Des périmètres plus ou moins larges en fonction de frontières à tracer avec les différentes branches du droit social — Vis à vis du droit du travail Une situation à la frontière ? Cf. A. Jeammaud, qui situe ainsi le droit de l’emploi : « un corps de dispositions qui saisissent la périphérie des rapports de travail en traitant de la formation et du placement des demandeurs d’emploi ou de l’indemnisation des chômeurs, mais aussi en aménageant une aide publique à l’embauche (régime des contrats aidés), un passage à des situations d’inactivité ou d’activité réduite pour les salariés, ou en tentant d’encourager la création d’entreprises ou d’activités » (Dr. soc., 1998, 217). En réalité, des recoupements évidents, des matières qui sont communes Une différence de perspective plus que de contenu. — Vis à vis du droit du chômage Le droit de l’emploi ne couvre pas, en principe, l’indemnisation des chômeurs envisagée en elle-même. Au contraire, le thème du retour à l’emploi relève évidemment du droit de l’emploi. Le droit du chômage lui fait maintenant une place considérable. Illustrations : la convention « du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage » (Convention PARE). Encore dans l’ANI du 11 janvier 2008 (de « modernisation du marché du travail »), le II : Sécuriser les contrats et améliorer le retour à l’emploi dans la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active : une « aide personnalisée de retour à l’emploi » ; application dans le décret du 15 avril 2009). Récemment, une circulaire interministérielle du 16 décembre 2010 a précisé les conditions et modalités de prescription de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (Apre) accordée à certains bénéficiaires du RSA reprenant une activité professionnelle. Elle vise notamment à unifier des interprétations hétérogènespar les départements, susceptibles de nuire à l’égalité de traitement des personnes concernées. Bien d’autres manifestations de l’étroite interdépendance entre droit de l’emploi et droit du chômage. Ex. Une décision du Conseil constitutionnel n° 2002-459 DC - 22 août 2002, (« emploi des jeunes en entreprise »), il est jugé que l’emploi des 2 jeunes et le régime chômage des intermittents du spectacle sont suffisamment liés pour qu’on puisse introduire un texte relatif au second dans une loi portant sur le premier. — Vis à vis du Droit de la formation La récente expérience de la réforme de 2009 (ANI du 7 janvier (puis du 5 octobre) et loi du 24 novembre 2009 : on a évoqué : «L’intégration de la formation professionnelle dans le droit de l’emploi ? » (Semaine soc. Lamy, n° 1387, 16 février 2009, p. 3) « le champ de la formation ne doit plus se concevoir isolément par rapport à l’orientation et au droit de l’emploi » (Dossier spécial Semaine soc. Lamy, n° 1431, 3 février 2010). II – Les concepts du droit de l’emploi Différentes évolutions A - Les différents sens du mot emploi F. Gaudu, Les notions d’emploi en droit Dr. soc., 1996, 569 1 ) Historiquement — Article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 « Tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics ». Ici, c’est l’État qui emploie. Mais la loi du 22 mars 1841 sur « l’emploi des enfants dans les manufactures… ». — La distinction travail des ouvriers / emploi des employés (1890, loi sur les délégués mineurs : celui qui fait craindre aux électeurs « de perdre leur emploi ou d’être privés de leur travail »). — La connotation de stabilité l’article 23, al . 7 du Code du travail (i.e. article L. 122-12, al. 2 ou L. 1224-1) « destiné à procurer aux salariés des emplois plus stables » dans l’arrêt Goupy du 27 février 1934. 2 ) L’emploi et les emplois — L’emploi envisagée globalement : la situation de l’emploi, donnée macro-économique ; le plein-emploi, l’amélioration de l’emploi. — L’emploi de chacun A ce niveau, microéconomique et individuel, le concept se dédouble - Un emploi abstrait, le fait d’avoir un travail (salarié) (avec éventuellement une connotation de stabilité « un droit à la poursuite d’un contrat successif », selon la thèse de F. Gaudu). - Une situation de travail spécifiée concrètement quant à la qualification (un « emploi de technicien supérieur ») ; plus précisément encore = poste de travail. Illustrations de l’équivoque du terme utilisé, notamment dans ce deuxième sens : 1° définition de l’article L. 1233-3 du Code du travail (suppression ou transformation d’emploi). Les emplois qui ne seraient pas supprimés mais transférés. 2° Des mesures pour l’emploi définies en fonction d’une distinction : les créations d’emploi (la démarche offensive), les emplois sauvegardés (démarche défensive) 3 3° Les engagements de maintien de l’emploi. Une exigence à comprendre nombre pour nombre ou poste par poste ? B -Stabilité, mobilité, flexibilité de l’emploi 1 ) Le concept de stabilité de l’emploi Le droit du travail des années 20 aux années 30 - loi du 19 juillet 1928 : le préavis et surtout l’article 23, al. 7 du Livre I du Code du travail de l’époque — origine de l’article L. 1224-1 ; sa première application jurisprudentielle, le fameux arrêt Goupy du 27 février 1934 - cette règle légale, “ destinée à assurer aux salariés des emplois plus stables, doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle ”. la suspension du contrat (un autre arrêt de 1934, paraîtil). On peut dire aussi sécurité de l’emploi comme dans l’accord national interprofessionnel « sur la sécurité de l’emploi » du 10 février 1969 (réformé 1974, 1986, 1989). 2 ) Le concept de mobilité Le droit du travail des années 60. Pour la loi de 1963 instituant le FNE et pour l’Ordonnance de 1967 instituant l’ANPE. 3 ) Le concept de flexibilité Les débats des années 80 / 90 Avant 1981, des tentatives timides (loi de 1979 / contrat à durée déterminée ) Après 1981, les nouvelles « revendications » du patronat. La grande négociation sur la flexibilité avait échoué en déc. 1984, mais… Les lois de la première cohabitation (1986-1987) : suppression de l'autorisation administrative préalable aux licenciements économiques (lois des 3 juillet et 30 déc. 1986) ; assouplissements / contrats précaires ; les aménagements du temps de travail (lois du 28 février 1986 et du 19 juin 1987). La loi « quinquennale » du 20 décembre 1993, dont beaucoup de dispositions ne correspondaient à son objectif affiché de lutte contre le chômage qu’au titre de la flexibilisation des conditions d’emploi. C - Dans la dernière période Observer la multiplication, la succession des orientations, uploads/S4/ cours-droit-de-l-x27-emploi-2011-7.pdf
Documents similaires





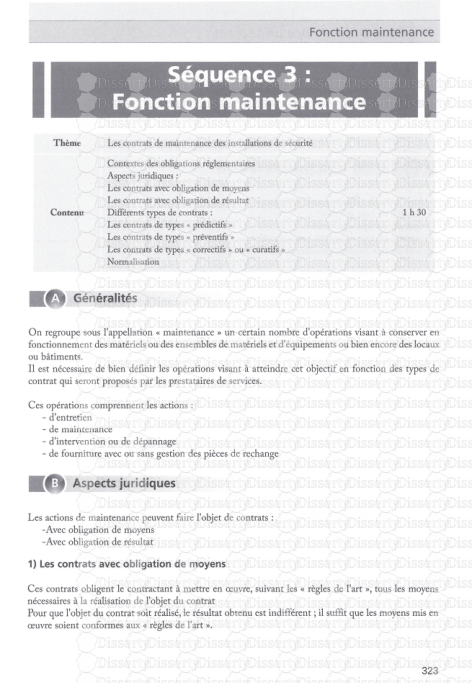




-
106
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 30, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 2.0588MB


