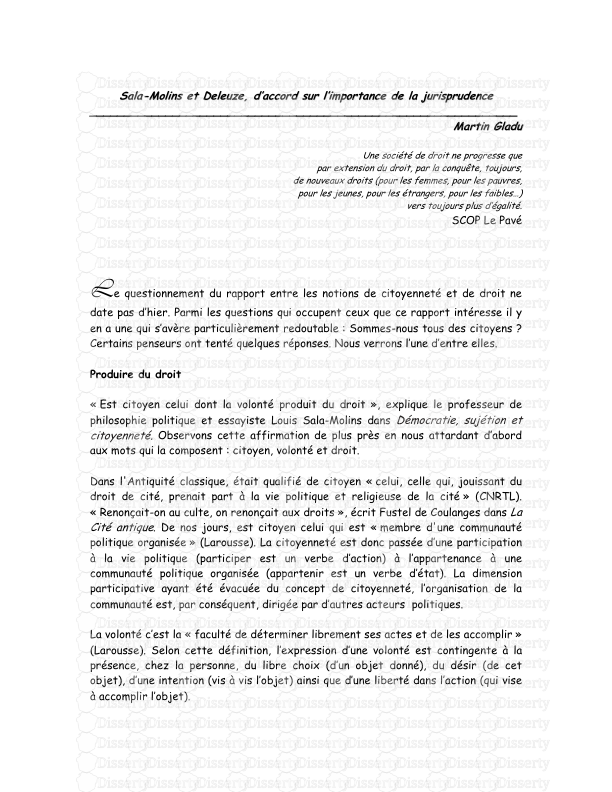S Sa al la a- -M Mo ol li in ns s e et t D De el le eu uz ze e, , d d’ ’a ac cc
S Sa al la a- -M Mo ol li in ns s e et t D De el le eu uz ze e, , d d’ ’a ac cc co or rd d s su ur r l l’ ’i im mp po or rt ta an nc ce e d de e l la a j ju ur ri is sp pr ru ud de en nc ce e _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ M Ma ar rt ti in n G Gl la ad du u Une société de droit ne progresse que par extension du droit, par la conquête, toujours, de nouveaux droits (pour les femmes, pour les pauvres, pour les jeunes, pour les étrangers, pour les faibles…) vers toujours plus d’égalité. SCOP Le Pavé Le questionnement du rapport entre les notions de citoyenneté et de droit ne date pas d’hier. Parmi les questions qui occupent ceux que ce rapport intéresse il y en a une qui s’avère particulièrement redoutable : Sommes-nous tous des citoyens ? Certains penseurs ont tenté quelques réponses. Nous verrons l’une d’entre elles. Produire du droit « Est citoyen celui dont la volonté produit du droit », explique le professeur de philosophie politique et essayiste Louis Sala-Molins dans Démocratie, sujétion et citoyenneté. Observons cette affirmation de plus près en nous attardant d’abord aux mots qui la composent : citoyen, volonté et droit. Dans l'Antiquité classique, était qualifié de citoyen « celui, celle qui, jouissant du droit de cité, prenait part à la vie politique et religieuse de la cité » (CNRTL). « Renonçait-on au culte, on renonçait aux droits », écrit Fustel de Coulanges dans La Cité antique. De nos jours, est citoyen celui qui est « membre d'une communauté politique organisée » (Larousse). La citoyenneté est donc passée d’une participation à la vie politique (participer est un verbe d’action) à l’appartenance à une communauté politique organisée (appartenir est un verbe d’état). La dimension participative ayant été évacuée du concept de citoyenneté, l’organisation de la communauté est, par conséquent, dirigée par d’autres acteurs politiques. La volonté c’est la « faculté de déterminer librement ses actes et de les accomplir » (Larousse). Selon cette définition, l’expression d’une volonté est contingente à la présence, chez la personne, du libre choix (d’un objet donné), du désir (de cet objet), d’une intention (vis à vis l’objet) ainsi que d’une liberté dans l’action (qui vise à accomplir l’objet). Le mot jurisprudence, quant à lui, désignait autrefois la science du droit. Il n'est plus guère utilisé dans ce sens que par quelques spécialistes. On l’applique actuellement à l'ensemble des arrêts et des jugements qu'ont rendu les cours et les tribunaux pour le règlement d'une situation juridique donnée. Deleuze et la primauté de la jurisprudence L’idée selon laquelle « Est citoyen celui dont la volonté produit du droit » renvoie donc davantage au premier sens (historique) du mot citoyen qu’au second. Il en est ainsi puisque la volonté qui habite le citoyen s’actualise dans l’accomplissement de son intention (accomplir est un verbe d’action), plutôt que dans une appartenance. En clair, son intention vise la production du droit (produire est un verbe d’action), ou plus précisément, de la jurisprudence. Le concept n’a rien de nouveau, comme le démontre ces deux citations du philosophe français Gilles Deleuze : Les droits de l’homme c’est du pur abstrait, c’est vide (…) c’est des discours d’intellectuels et pour intellectuels odieux et pour intellectuels qui n’ont pas d’idées. D’abord, je remarque que toutes ces déclarations des droits de l’homme ne sont jamais faites avec les gens que ça intéresse (…) Toutes les abominations que subit l’homme sont des cas (…) c’est des situations de jurisprudence (…) Agir pour la liberté, devenir révolutionnaire, c’est opérer dans la jurisprudence (…) La justice ça n’existe pas. Les droits de l’homme ça n’existe pas. Ce qui compte c’est la jurisprudence. C’est ça l’invention du droit. Alors ceux qui se contentent de rappeler les droits de l’homme et de les réciter, c’est des débiles. Il ne s’agit pas de faire appliquer les droits de l’homme; il s’agit d’inventer des jurisprudences où pour chaque cas ceci ne sera plus possible (…) Lutter pour la liberté c’est réellement faire de la jurisprudence (…) Il n’y a que ça qui existe. Donc, luttez pour la jurisprudence. C’est ça être de gauche, je crois, c’est créer le droit. Source : Abécédaire de Gilles Deleuze Ce qui m’intéresse, ce n’est pas la loi ni les lois (l’une est une notion vide, les autres, des notions complaisantes), ni même le droit ou les droits, c’est la jurisprudence. C’est la jurisprudence qui est vraiment créatrice de droit : il faudrait qu’elle ne reste pas confiée aux juges. On songe déjà à établir le droit de la biologie moderne : mais tout, dans la biologie moderne et les nouvelles situations qu’elle crée, les nouveaux événements qu’elle rend possibles, est affaire de jurisprudence. Ce n’est pas un comité des sages, moral et pseudo-compétent, dont on a besoin, mais de groupes d’usagers. C’est là qu’on passe du droit à la politique. Source : Le devenir révolutionnaire et les créations politiques (Entretien réalisé par Toni Negri) Deleuze donne raison, en quelque sorte, aux légistes qui prétendent que la Common Law est plus égalitaire que le régime civiliste, tous les cas semblables bénéficiant – en théorie – de la règle du précédent : En Common Law, la source première est la jurisprudence, alors que dans la tradition civiliste la source première est la loi (votée par le parlement). La tradition de Common Law est caractérisée par un empirisme fort et très casuistique. À l’inverse le droit civiliste est marqué par un certain degré d’abstraction, mais aussi par un certain systématisme. Source : www. cours-de-droit.net Quoiqu’il en soit, Sala-Molins et lui s’entendent sur la nécessité, pour la gauche, de créer de la jurisprudence. Créer ou produire de la jurisprudence, qu’est-ce ce que ça veut dire ? Dit simplement, cela signifie deux choses : 1) ester en justice pour obtenir des jugements qui feront avancer la cause à laquelle on adhère, et 2) étudier la jurisprudence dans le but de faire des liens entre des décisions jugées pertinentes à l’étayement de notre argumentaire. Enfin, il apparaît nécessaire, aux yeux de ces deux penseurs, pour la population de chercher à créer de la jurisprudence. Pour ce faire, chaque citoyen – surtout s’il appartient à la gauche – doit sortir de son rôle d’être de besoin (être est un verbe d’état) et de prendre pleinement part (prendre part est un verbe d’action) aux décisions qui l’impactent. Cela implique donc qu’il se pense comme partie prenante d’une communauté, laquelle a autant besoin de lui que lui d’elle. Êtes-vous des consommateurs ou des participants ? Un des slogans de mai 68 uploads/S4/ deleuze-et-sala-molins-d-x27-accord-sur-l-x27-importance-de-la-jurisprudence.pdf
Documents similaires










-
191
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 12, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0484MB