Master 1 DROIT DES AFFAIRES Cours sur le Droit des Affaires 2 P R O G R A M M E
Master 1 DROIT DES AFFAIRES Cours sur le Droit des Affaires 2 P R O G R A M M E Introduction générale Chapitre préliminaire : Définition du concept du droit commercial Chapitre 1 : Histoire du droit des affaires en Afrique Chapitre 2 : Les sources du droit commercial des affaires Chapitre 3 : Les commerçants Chapitre 4 : Les conséquences de la qualité de commerçant Chapitre 5 : Le fonds de commerce 3 B I B L I O G R A P H I E Codes - Code vert de l’OHADA, 2012 - Code béninois de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes - Code français de commerce, Dalloz 2011 ou Litec 2011 , Ouvrages - Droits des affaires, Entreprises en difficultés, redressement judiciaire, faillite, Yves Guyon, collection Droit des affaires et de l’entreprise, Economica - Droit des affaires, J-B. Blaise, L.G.D.J - Droit commercial, J. Mestre, M-E. Pancrazi, L.G.D.J. - Droit des affaires, M. Menjucq, Gualino éditeur - Droit des sociétés, M. Rebourg, Gualino éditeur - Droit commercial, B. Petit, « objectif droit », Litec - Droit commercial, J-P. Clavier et F-X. Lucas, Champs Université, Flammarion - Droit commercial, J-P. Le Gall, mémentos Dalloz : - Droit des affaires internationales, Stéphane Chatillon, Vuibert, Web - www.http://ohada.org - www.http://legifrance.fr 4 I n t r o d u c t i o n g é n é r a l e Aujourd’hui, les nécessités de l’économie moderne dépassent les capacités ou les moyens dont dispose un individu isolé. Pour faire des affaires, il est devenu indispensable de se regrouper afin d’avoir non seulement les capitaux nécessaires, mais également la confiance des prêteurs, d’où la création des entreprise ou sociétés. Mais la création de la société ne se justifie pas uniquement par le besoin de réunir des capitaux. Cela est certainement vrai pour les entreprises de grande taille. Pour les entreprises de petites ou moyennes tailles, la recherche de capitaux seule ne peut justifier leur création. D’autres raisons expliquent ce regroupement. Les plus importantes sont certainement d’ordre juridique. On peut citer par exemple la séparation du patrimoine de l’entreprise avec celui des associés ou de façon beaucoup plus générale, les opportunités d’organisation juridique ou fiscale qu’offre la société. Le droit distingue deux types de sociétés : les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Le principal critère de distinction entre les différentes sociétés consiste à se référer à l’objet de la société. Autrement dit, il faut se pencher sur l’activité de la société pour savoir si elle est civile ou si elle est commerciale. Ainsi, lorsque l’activité de la société est commerciale, on a affaire à une société commerciale. Par contre, si l’activité n’est pas commerciale, on considérera que la société est civile. Selon les dispositions des articles 2 à 12 de l’Acte Uniforme portant Droit Commercial Général (AUDCG), dans sa rédaction de 1997, le commerçant est celui qui « exerce des actes de commerce et qui en fait sa profession habituelle »1. I- Les intérêts pratiques qu’il y a à distinguer l’acte de commerce de l’acte civil Le droit civil prédomine le droit privé. Le droit commercial emprunte donc au droit civil. L’acte de commerce s’inspire fortement du modèle de l’acte civil. Il faut donc les distinguer à six niveaux : - compétence du tribunal : avec un acte civil, on doit saisir une jurisprudence civile, alors avec un acte de commerce, on doit saisir un tribunal de commerce. En ce qui concerne le régime des actes mixtes, la compétence matérielle du tribunal (juridiction commerciale ou civile) est déterminée par la qualité du défendeur à l’action. - régime de la preuve : la preuve est beaucoup plus souple en droit commercial : c'est le principe de la liberté de la preuve. En droit civil, on ne peut prouver que par un écrit. - la règle de la solidarité : en présence de plusieurs débiteurs, si la dette n'est pas payée, le créancier peut exercer son action contre l'un quelconque des débiteurs, et ce pour le montant total. En droit civil, la solidarité des codébiteurs ne se présume pas, et ne s'applique donc pas automatiquement. En droit commercial, par contre, la solidarité est présumée. - la mise en demeure : en droit civil, cette sommation ne peut se faire que par exploit d'huissier ou par citation en justice. En droit commercial, elle peut se faire par tout moyen (lettre ordinaire, lettre avec accusé de réception, etc.). - la sanction de l’inexécution du contrat : la sanction est plus rigoureuse en droit civil, puisqu'on s'expose à la résolution judiciaire du contrat. En droit commercial, chaque contrat constitue un maillon dans une chaîne d'opérations successives qu'il s'agit de ne pas rompre. Il y a donc simple réfaction du contrat : le juge peut décider d'aménager les conditions du contrat. 1 L’Acte uniforme de l’OHADA sur le Droit commercial général (AUDCG) a été adopté le 17 avril 1997 et révisé le 15 décembre 2010. Dans sa version de 2010, le contenu de l’article 2 a été modifié. 5 - la prescription : en droit civil, elle est de 30 ans, tandis qu'en droit commercial elle n'est que de 10 ans. II- Les critères de commercialité d’un acte L’article 2 nouveau de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le Droit commercial général dispose que celui qui fait « de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession » est un commerçant. Cette nouvelle formulation de l’article 2 de l’acte uniforme suppose la définition de la commercialité d’un acte à partir de trois critères : 1- Les actes de commerce par nature : un acte est commercial par nature si son objet est commercial (et consiste donc en un achat suivi d'une revente, donc s'il y a distribution). Cela peut aussi correspondre à des activités de distribution ou de services. Les actes de commerce relatifs aux activités de distribution : à partir du moment où un acte correspond à une activité de distribution, il est considéré commercial par nature. Les actes de commerce relatifs aux activités de production : tous les actes relatifs à des activités de production sont commerciaux par nature. Les actes de commerce relatifs aux activités de services : toutes les activités de services ne sont pas des activités commerciales. Le sont, les activités de services suivantes : transports, location, spectacles publics, activités financières et intermédiaires. 2- Les actes de commerce par la forme : ce sont tous les actes qui sont désignés comme commerciaux par la loi. Un acte est commercial par la forme s’il est désigné comme tel par la loi. Ex : lettres de change. 3- Les actes de commerce par accessoire : ce sont des actes de commerce qui sont par leur nature des actes civils mais on les qualifie quand même d’actes commerciaux car ils sont accomplis par un commerçant dans l’exercice de sa profession. Ex : les contrats d’assurances, de location d’immeubles passés par un commerçant, etc. III- L’exercice du commerce à titre professionnel et habituel Pour avoir la qualité de commerçant, il faut d’abord exercer le commerce à titre habituel, comme le recommandait l’ancienne version de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le droit commercial général mais il faut aussi, dans la pratique, s’immatriculer au RCCM. Quelques actes isolés même s’ils sont par nature des actes de commerce ne donnent pas à celui qui les accomplit la qualité de commerçant. Il y a un besoin de répétition, de continuité qu’on retrouve dans l’exercice professionnel. Mais pour être commerçant, il faut avoir : La capacité juridique : l’aptitude légale à avoir des droits et des obligations et le pouvoir de les exercer. Il y a dans l’AUDCG deux séries d’incapables : les mineurs, et les majeurs incapables. Ces derniers bénéficient néanmoins de la tutelle ou de la curatelle. a) Les incompatibilités 6 Par ailleurs, l’exercice du commerce est incompatible avec l’exercice d’autres professions : avocats, architectes, fonctionnaires, officiers divers, etc. Il aurait été intéressant de s’appesantir sur la création des sociétés commerciales tout en mettant l’accent sur les différentes formes de sociétés commerciales qui peuvent être créées dans l’espace OHADA, la procédure de constitution de chacune des formes de sociétés commerciales, le mode de fonctionnement de chacune des formes de sociétés commerciales, la procédure de fermeture de chacune des formes de sociétés commerciales. Mais il est tout aussi légitime et opportun d’avoir une idée des innovations apportées par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales. IV- Les tendances Le droit OHADA des sociétés offre un large éventail de structures sociétaires permettant à diverses catégories d’opérateurs économiques de fonctionner dans le secteur formel. Il met en place des sociétés commerciales plus modernes avec des modalités de constitution et un fonctionnement simplifiés. La formule du gouvernement majoritaire dans les sociétés anonymes est maintenue mais aménagée pour tenir compte des associés minoritaires. Un droit pénal des affaires désormais bien étoffé assure le respect des règles régissant la constitution des sociétés, leur gérance, leur administration et leur direction, les uploads/S4/ droit-des-affaires 24 .pdf
Documents similaires








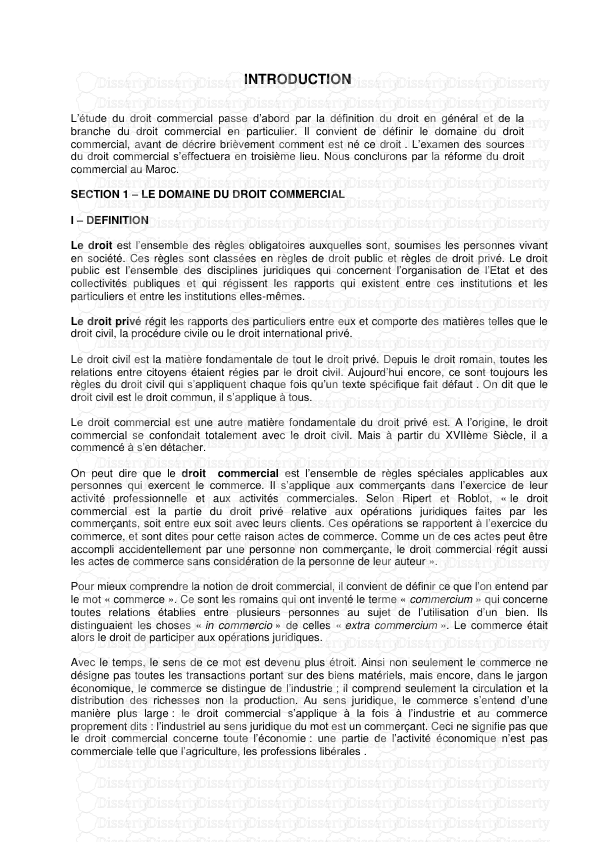

-
68
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 14, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.5670MB


