ANNEE UNIVERSITAIRE 2011-2012 DROIT des Contrats spéciaux Principaux contrats d
ANNEE UNIVERSITAIRE 2011-2012 DROIT des Contrats spéciaux Principaux contrats d’entreprise Cours de Mme Martine BARBIER Objectifs pédagogiques : Etudier le régime juridique des principaux contrats qui peuvent être conclus par une entreprise avec ses partenaires. Connaître et comprendre les principales clauses insérées dans chaque type de contrat afin de prévoir les difficultés liées à leur application. Bibliographie : - Pour une approche synthétique de la matière, on consultera notamment : Béatrice Bourdelois : Les contrats spéciaux, Mémentos Dalloz, 2ème éd.2011 C.Lisanti : Les contrats spéciaux, Hachette supérieur, 2011 G. Vermelle : Les contrats spéciaux, Mémento Dalloz, 5ème éd.2006 - Pour une approche plus complète, voir les manuels suivants : P. Puig : Contrats spéciaux, Dalloz 4ème éd. 2011 A. Benabent : Contrats spéciaux civils et commerciaux, Montchrestien coll. Précis Domat, 9ème éd. 2011 F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque : Contrats civils et commerciaux, Dalloz, Précis,9ème éd. 2011. D. Mainguy : Les contrats spéciaux,Dalloz, 7ème éd.2010 P-H Antonmattei et J.Raynard : Les contrats spéciaux, Litec, 6ème éd.2008 J.Huet : Les principaux contrats spéciaux, LGDJ 2ème éd. 2001 ANNEE UNIVERSITAIRE 2011-2012 SEANCE 1 INTRODUCTION Le cours sur les principaux contrats d’entreprise, que nous débutons aujourd’hui, pourrait plus justement s’intituler « cours sur les contrats spéciaux » : - Tout d’abord, parce que la notion de contrat d’entreprise est restrictive et ne concerne stricto sensu, que les contrats dits de louage d’ouvrage ou d’industrie, comme nous aurons l’occasion de le voir plus avant ; - Ensuite, parce que si nous voulons nous intéresser aux principaux contrats qu’une personne morale, une entreprise, est susceptible de conclure, nous devons élargir notre champ d’investigation. Alors, qu’appelle-t-on, en droit, « contrats spéciaux » ? Sont-ils des contrats particuliers, comme leur intitulé le laisse supposer, qui dérogent au droit commun des contrats ? ou présentent-ils un caractère marginal ? En réalité, les contrats spéciaux sont les contrats les plus courants. Notre univers quotidien est d’ailleurs peuplé de contrats spéciaux. En fait, le droit des contrats spéciaux n’est pas un droit à part, il s’appuie largement sur le droit commun des contrats, qu’il adapte, par des règles spécifiques, propres à chaque espèce ou catégorie. Nous allons donc tenter de cerner la notion de contrats spéciaux (§1), puis nous rechercherons les principales sources (§2) qui alimentent ces contrats. §1 Notion de contrats spéciaux La notion de contrats spéciaux peut être dégagée à partir de l’article 1107 CC, qui stipule : « Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux, et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce ». Que faut –il retenir de l’ article 1107 CC? A- Il instaure une distinction entre contrats nommés et contrats innommés 1. On appelle « contrats nommés », les contrats auquel la loi a donné un nom et qu’elle a, en conséquence, spécialement prévus et règlementés. Ils sont nombreux. On citera notamment : - le contrat de vente (Titre VI, art. 1582 à 1701 du CC), ANNEE UNIVERSITAIRE 2011-2012 - le louage ( Titre VIII du CC), qui se distingue en sous-catégories : le louage de choses régi par le code civil ( art. 1713 à 1778 et 1800 à 1831) ou réglementés spécifiquement par la loi concernant des baux spéciaux ( ex : bail commercial dont les articles sont regroupés dans le code du commerce,…), le louage d’industrie ( art. 1780 et 1781 CC) qui se prolonge par le louage d’ouvrage (art. 1782 à 1799 CC), appelé plus communément contrat d’entreprise, puis le louage de services désigné plus généralement sous l’appellation de contrat de travail ( dont l’essentiel des dispositions est regroupé dans le code du travail) La liste de ces contrats nommés est longue. Il conviendrait d’ajouter aussi le contrat d’association (Loi du 1er juillet 1901), le contrat d’assurance, les contrats de distribution ….. Même incomplète, cette liste démontre la multiplicité et la diversité des contrats nommés. Pour la plupart, ils constituent des contrats spéciaux, précisément réglementés, voire souvent de manière impérative, en particulier lorsqu’ils mettent en présence des cocontractants qui ne sont pas placés sous un plan égalitaire. 2. En revanche, parce que le principe de la liberté contractuelle suppose la possibilité de conclure n’importe quel contrat, en sus des contrats nommés, l’article 1107 CC laisse une place aux contrats innommés qui sont ceux, que la loi n’a pas réglementés, même si parfois la pratique leur donne un nom (exemples : contrat d’hôtellerie, de «parking »,…). Au demeurant, il faut souligner que les contrats innommés ont naturellement vocation à devenir des contrats nommés, en particulier du fait du juge. En effet, concernant les contrats innommés, on se réfère, en principe, aux règles que les cocontractants ont adoptées dans leur convention. Mais, des différends sont susceptibles de naître sur les règles applicables. Dans ce cas, le juge pourra être saisi et sera amené à qualifier le contrat pour déterminer la règle applicable : - soit en rapprochant le contrat litigieux d’un contrat nommé ( ex : un contrat d’entretien d’ascenseur pourra relever de la catégorie de contrat de louage d’ouvrage), - soit en recherchant le contrat nommé le mieux adapté au contexte considéré ( ex : contrat de parking pourra être soit un contrat de louage soit un contrat de dépôt). Il faut noter que le juge n’est d’ailleurs pas tenu par la qualification éventuellement donnée au contrat par les parties, notamment si celle-ci apparaît erronée ou mensongère. - Enfin, si le contrat ne peut être ramené à aucun contrat connu, il s’agira d’un contrat sui generis ( du latin « de son propre genre »). ANNEE UNIVERSITAIRE 2011-2012 B- L’article 1107 du CC précise aussi que les contrats nommés comme les contrats innommés sont soumis aux règles générales du droit des contrats, mais que des règles particulières sont applicables à certains d’entre eux. Ainsi, pour la majorité des contrats nommés, on se référera aux règles spécifiques édictées essentiellement par la loi. Ce peut être des règles supplétives, qui s’appliquent, à défaut de volonté contraire exprimée par les parties, ou des règles impératives, qui ne peuvent être écartées par la volonté des parties. On constate, depuis quelques années déjà, en raison du développement des contrats dans la pratique professionnelle et commerciale, un mouvement de nomination et de spécialisation des contrats, consacré essentiellement par la loi et la jurisprudence. D’où l’importance de connaître les principales sources du droit des contrats spéciaux . §2 Les sources des contrats spéciaux Les règles qui alimentent le droit des contrats spéciaux proviennent essentiellement des normes internes mais aussi internationales et européennes , et de la jurisprudence. Toutefois, d’autres sources existent. A- Les normes internes, internationales et européennes 1. Les normes internes Le code civil, bien entendu, est la source première. Il réglemente les contrats les plus usuels : la vente, le mandat, le prêt, le louage, le bail,…. On notera, que dans la catégorie des contrats spéciaux, il peut y avoir des sous-distinctions (exemples : dans la catégorie contrat de bail et de louage-> bail commercial, bail d’habitation ; contrat de vente -> ventes particulières). Depuis l’origine du code civil ( 1804), de nombreux contrats ont été crées par le législateur. Ils n’ont pas tous été intégrés dans le code civil. Certains ont fait l’objet de codes « compilation », comme le code des assurances, le code de la consommation, le code de commerce, … 2. Les normes internationales et européennes Les conventions internationales sont également à l’origine de certains contrats spéciaux. Ainsi, certaines conventions ont plus spécifiquement tenté de régler les conflits de lois pouvant porter sur certains contrats spéciaux (ex : Convention de La Haye du 15/06/1955 sur les ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels ; Convention de Vienne du 11/04/1980 sur la vente internationale de marchandises,…). Mais, surtout, le droit européen intervient de plus en plus, comme source de règles, en particulier concernant la vente commerciale et le contrat d’entreprise (ex : directive du 25 mai 1999 sur la vente et les garanties de biens de consommation, transposée par une ordonnance du 17/02/2005). ANNEE UNIVERSITAIRE 2011-2012 B- La jurisprudence La jurisprudence exerce ici, comme dans d’autres domaines, un rôle essentiel. La Cour de cassation exerce, outre une fonction interprétative des textes en vigueur, une fonction normative, comme par exemples, s’agissant des garanties de vices cachés, de l’obligation de sécurité, de la détermination des prix, des obligations de moyens et de résultats, ….. C- Les autres influences 1. Les autorités administratives indépendantes Certains organismes interviennent également pour donner des avis, conseils, décisions,… . Par exemples, le Conseil de la concurrence devenu l’Autorité de la Concurrence par l’intervention de la loi du 04/08/2008 de modernisation de l’économie (ex : clauses de non –concurrence, d’exclusivité, refus de vente…) ou encore, la Commission des clauses abusives, ou la Commission d’examen des pratiques commerciales ( uploads/S4/ droit-des-contrats-speciaux 5 .pdf
Documents similaires





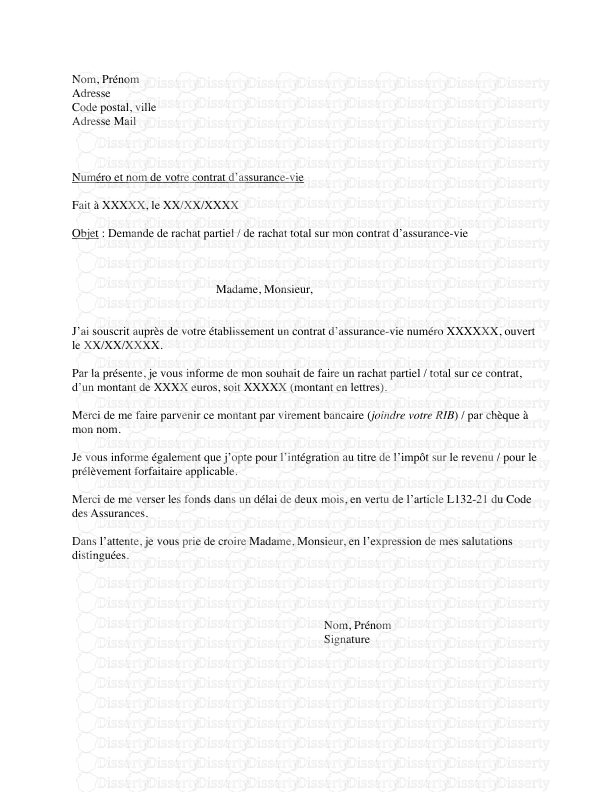




-
173
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 29, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.8600MB


