Séance 1 B1 Droit De l’Union européenne Sources et portée du droit de l’Union e
Séance 1 B1 Droit De l’Union européenne Sources et portée du droit de l’Union européenne L’Union européenne est dotée de la personnalité juridique et dispose, dès lors, d’un ordre juridique propre, distinct de l’ordre international. Par ailleurs, le droit de l’Union a un effet direct ou indirect sur la législation des États membres et fait partie intégrante du système juridique de chaque État membre. L’Union européenne constitue en soi une source de droit. L’ordre juridique se compose généralement du droit primaire (les traités et les principes juridiques généraux), du droit secondaire (fondé sur les traités) et du droit complémentaire. I- Sources du droit de l’Union et leur hiérarchie A. Droit primaire de l’Union : les traités Les effets désastreux de la deuxième guerre mondiale et la menace constante d’une confrontation Est-Ouest ont fait de la réconciliation franco-allemande une priorité essentielle. Le partage de l’industrie du charbon et de l’acier par six pays européens, mis en place par le traité de Paris de 1951, a constitué la première étape vers l’intégration européenne. Les traités de Rome de 1957 ont renforcé les bases de cette intégration ainsi que l’idée d’un avenir commun pour les six pays européens concernés. Bases juridiques Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA)[1]ou traité de Paris, signé le 18 avril 1951, est entré en vigueur le 23 juillet 1952. Pour la première fois, six États européens acceptent de s’engager dans la voie de l’intégration. Ce traité a permis de jeter les bases de l’architecture communautaire en créant un exécutif appelé «Haute autorité», une Assemblée parlementaire, un Conseil des ministres, une Cour de Justice et un Comité consultatif. Conclu pour une durée limitée à 50 années en vertu de son article 97, le traité CECA est arrivé à échéance le 23 juillet 2002. La valeur nette du patrimoine de la CECA à sa dissolution a été affectée, en vertu du protocole no 37 annexé aux traités (traité sur l’Union européenne et traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), à la recherche dans les secteurs de l’industrie du charbon et de l’acier au moyen d’un fonds et d’un programme de recherche du charbon et de l’acier. Les traités instituant la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA, «Euratom»), ou traités de Rome, signés le 25 mars 1957, sont entrés en vigueur le 1er janvier 1958. Contrairement au traité CECA, les traités de Rome ont été conclus «pour une durée illimitée» (articles 240 CEE et 208 CEEA), ce qui leur a conféré un caractère quasi-constitutionnel. Les six pays fondateurs étaient l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas. Objectifs La création de la CECA n’était, dans les intentions avouées de ses promoteurs, qu’une première étape sur la voie qui conduirait à une «fédération européenne». Le marché commun du charbon et de l’acier devait permettre d’expérimenter une formule susceptible d’être progressivement étendue à d’autres domaines économiques, pour aboutir en fin de compte à l’Europe politique. La Communauté économique européenne avait pour objectif l’établissement d’un marché commun, fondé sur les quatre libertés de circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services. L’objectif d’Euratom était de coordonner l’approvisionnement en matières fissiles et les programmes de recherche déjà lancés par les États ou qu’ils s’apprêtaient à lancer en vue de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Les préambules des trois traités révèlent l’unité d’inspiration dont procède la création des Communautés, à savoir la conviction de la nécessité d’engager les États européens dans la construction d’un destin commun qui, seul, leur permettra de maîtriser l’avenir. Principes fondamentaux Les Communautés européennes (CECA, CEE et Euratom) sont nées de la lente progression de l’idée européenne, inséparable des événements qui ont bouleversé le continent. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les industries de base, en particulier sidérurgiques, devaient être réorganisées. L’avenir de l’Europe, menacé par l’affrontement Est-Ouest, passait par une réconciliation franco-allemande. 1. L’appel lancé le 9 mai 1950 par le ministre des affaires étrangères français, Robert Schuman, peut être considéré comme le point de départ de l’Europe communautaire. Le choix du charbon et de l’acier était à l’époque hautement symbolique. En effet, au début des années 50, les charbonnages et la sidérurgie sont des industries fondamentales et les bases de la puissance d’un pays. Outre l’intérêt économique évident, la mise en commun des ressources françaises et allemandes complémentaires devait marquer la fin de l’antagonisme entre ces deux pays. Le 9 mai 1950, Robert Schuman déclarait: «L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d’abord une solidarité de fait». C’est sur ce principe que la France, l’Italie, l’Allemagne et les pays du Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) ont signé le traité de Paris, qui assure essentiellement: la liberté de circulation des produits et le libre accès aux sources de production; la surveillance permanente du marché pour éviter des dysfonctionnements qui peuvent rendre nécessaire l’instauration de quotas de production; le respect des règles de concurrence et de transparence des prix; le soutien à la modernisation du secteur et à la reconversion. 2. Au lendemain de la signature du traité, alors que la France s’oppose à la reconstitution d’une force militaire allemande dans un cadre national, René Pleven imagine un projet d’armée européenne. La Communauté européenne de défense (CED) négociée en 1952 devait être accompagnée d’une Communauté politique (CEP). Les deux projets furent abandonnés à la suite du refus par l’Assemblée nationale française d’autoriser la ratification du traité le 30 août 1954. 3. Les efforts de relance de la construction européenne après l'échec de la CED se concrétisent lors de la conférence de Messine (juin 1955) sur le double terrain de l'union douanière et de l'énergie atomique. Ils aboutissent à la signature des deux traités, CEE et CEEA. a. Parmi les dispositions du traité CEE (le traité de Rome)[2] figuraient: l’élimination des droits de douane entre les États membres; l’établissement d’un tarif douanier extérieur commun; l’instauration d’une politique commune dans l’agriculture et les transports; la création d’un Fonds social européen; l’institution d’une Banque européenne d’investissement; le développement de relations plus étroites entre les États membres. Pour réaliser ces objectifs, le traité CEE pose des principes directeurs et délimite le cadre de l’action législative des institutions communautaires. Il s’agit des politiques communes: politique agricole commune (articles 38 à 43), politique des transports (articles 74 et 75), politique commerciale commune (articles 110 à 113). Le marché commun doit permettre la libre circulation des marchandises, la mobilité des facteurs de production (libre circulation des travailleurs, des entreprises, liberté des prestations de services, libération des mouvements de capitaux). b. Le traité Euratom[3] visait des objectifs très ambitieux et notamment la «formation et la croissance rapide des industries nucléaires». Mais en fait, en raison du caractère complexe et délicat du secteur nucléaire, qui touche aux intérêts vitaux des États membres (défense et indépendance nationale), le traité a dû limiter ses ambitions. 4. La convention relative à certaines institutions communes, signée et entrée en vigueur en même temps que les traités de Rome, avait décidé que l’Assemblée parlementaire et la Cour de justice seraient communes. Cette convention est arrivée à expiration le 1er mai 1999. Il restait à fusionner les exécutifs, ce que feront le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes du 8 avril 1965, dit «traité de fusion»[4], et la convention du 9 avril 1965, venue parachever l’unification des institutions. À partir de là, on soulignera la prééminence de la CEE sur les communautés sectorielles que sont la CECA et la CEEA. C’est la victoire de la généralité du régime de la CEE sur la coexistence d’organisations à compétence sectorielle, et la mise en place de ses institutions. [1]Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/FR/TXT/?uri=legissum:xy0022 [2]Traité établissant la Communauté économique européenne, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teec/sign?locale=fr [3]Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016A%2FTXT [4]https://eur-lex.europa.eu/legal- content/FR/TXT/?qid=1558094778118&uri=CELEX:11965F Les traités et les principes généraux occupent le sommet de la hiérarchie des normes (droit primaire). Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la même valeur est reconnue à la charte des droits fondamentaux. Les accords internationaux conclus par l’Union y sont subordonnés. À un rang inférieur, on trouve le droit dérivé: celui-ci n’est valide que s’il respecte les normes de rang supérieur. B. Droit dérivé ou secondaire de l’Union : Règlements et Directives Généralités Les actes juridiques de l’Union sont énumérés à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «traité FUE»). Ces actes sont les suivants: le règlement, la directive, la décision, la recommandation et l’avis. Les institutions de l’Union ne peuvent arrêter de tels actes juridiques que si une disposition des traités leur en confère la compétence. Le principe d’attribution, régissant la délimitation des compétences de l’Union, est explicitement consacré à l’article uploads/S4/ droit-europeenne.pdf
Documents similaires



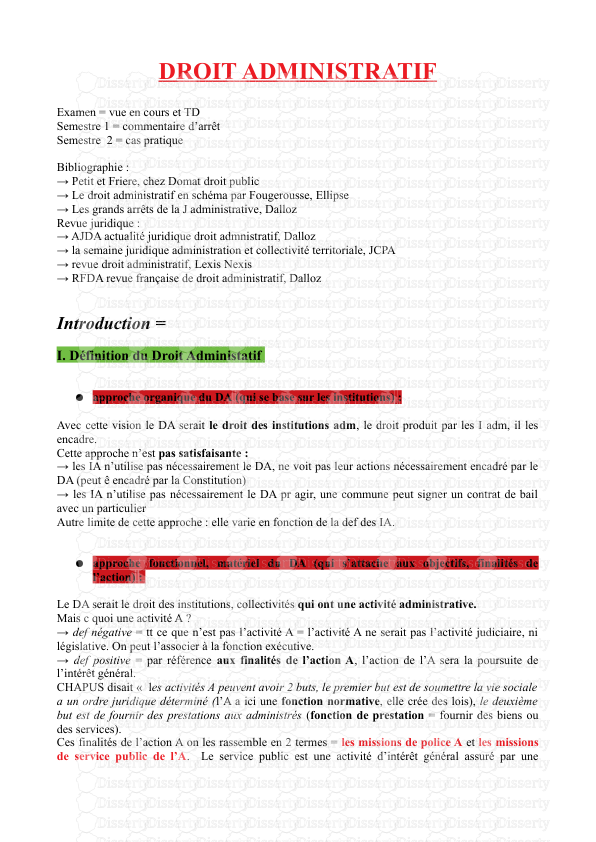






-
207
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.9511MB


