DROIT PENAL SPECIAL Support du cours : Un recueil de textes est disponible au s
DROIT PENAL SPECIAL Support du cours : Un recueil de textes est disponible au service cours. Il n’y a pas de syllabus. Examen : L’examen est écrit et est composé de questions théoriques et d’une question qui amène à réfléchir au droit pénal et à la construction des infractions. Pour cette dernière question, il faut faire référence aux textes du recueil de lecture. On peut amener les textes de loi, les textes du recueil de lecture et tout autre document que l’on estime utile. Prérequis : Notions de droit pénal général : éléments constitutifs de l’infraction, validité du droit dans l’espace et dans le temps, etc. 1 Il y a 2 types d’infractions : les infractions traditionnelles et mes infractions plus « modernes ». Les infractions traditionnelles sont celles qu’on trouve au livre II du Code pénal et dont une partie nous vient encore du Code Napoléonien (ex : infractions contre l’Etat, vol, meurtre, etc.). Leur structure n’a pas beaucoup évolué. Dans le cadre du cours, nous nous pencherons ici sur 2 infractions exemplaires : le vol et le meurtre car ces 2 infractions posent une question importante d’interaction entre elles. La création et l’évolution des infractions plus modernes sont par contre la plupart du temps influencées par l’évolution de la société (ex : modification du droit en matière de corruption lors de gros scandales, création de l’infraction de harcèlement moral dont on parle seulement depuis peu de temps, la consommation de stupéfiants, le blanchiment d’argent, les organisations criminelles, le terrorisme, etc.). La création de ces nouvelles infraction induit des modifications importantes dans le système pénal tout entier (ex : responsabilité des personnes morales). De plus, elles vont également avoir une influence importante sur la procédure pénale (ex : loi sur le témoignage anonyme et loi sur les méthodes particulières de recherche pour la lutte contre les organisations criminelles). Elles ont donc modifié le rapport entre le droit pénal matériel (infraction et culpabilité) et le droit pénal de la procédure pénale. On est en train d’inverser la relation : appliquer l’incrimination ne sera plus la finalité du système pénal. Son but est que les enquêtes pénales puissent être bien menées avec efficacité, quitte à ce qu’on n’applique pas la peine en bout de course. A. Le système pénal, composante principale des politiques criminelles : 1. Politique criminelle 2. Système pénal 3. Lois pénales (fond lois matérielles et forme lois de procédure) 4. Mise en œuvre des lois pénales 5. Pratiques informelles des institutions pénales Le système pénale n’est qu’une des composantes d’un ensemble plus large qu’est les politiques criminelles. Les politiques criminelles sont l’ensemble des moyens que le gouvernement peut mettre en œuvre pour faire face à certains comportements qui peuvent être définis comme des infractions (ex : prévention, intervention médico-psycho-sociale, intervention pénale, etc. contre l’usage de stupéfiants). Dans le système pénale, il ne faut pas oublier qu’il existe des pratiques informelles mises en œuvre par ses acteurs et dont on sait très peu. Il ne faut donc pas penser aux fonctions institutionnelles comme si elles étaient désincarnées. Il s’agit toujours de choix faits par des personnes en fonction de leurs priorités, de leur sensibilité, etc. (ex : non-action de la police devant un flagrant délit choix de la peine par le juge dans la fourchette des possibilités,…). Il 2 1 2 3 4 5 y a donc tout un fonctionnement de la justice pénale qu’on ne voit pas mais qui va avoir du poids dans la poursuite de l’infraction. Il y a également un pan du système pénal dont on traite trop peu : celui de la création de la loi pénale, des infractions (débat, processus des travaux parlementaires, motivations des différents acteurs,…). On peut alors se poser aussi la question de pourquoi le droit pénal a été choisi pour faire face à la situation problématique et pas d’autres types d’intervention qui pourraient même être plus efficaces. Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que pour qu’il y a criminalisation et décriminalisation, pour que ça change, il faut une ouverture d’esprit, il faut penser au changement et donc fonctionner dans un système ouvert. Tout comme l’économie tente de réduire la pauvreté, le droit pénal a pour but de réduire la criminalité. Mais, il n’y arrive pas. Penser autrement plutôt que de reproduire les schémas préexistants pourrait apporter une réponse à ceci. Le droit pénal est une arme dangereuse aux mais de l’Etat car il permet d’imposer des peines (avec de graves conséquences pour la vie des personnes concernées et leurs familles) et parce qu’il y a le risque de commettre des erreurs judiciaires (mal irréparable infligé). Certains juristes estiment alors que le droit pénal doit intervenir en dernier recours, après tous les autres moyens à la disposition de l’Etat (information, prévention, amendes administratives, …). Ce courant était surtout représenté dans les années ’60-’70. LANDREVILLE a dit par rapport à cela que « pour beaucoup, le droit pénal correspond à la protection de valeur et il se concrétise dans un droit qui est égal pour tous, y compris dans son application ». Cette déclaration mérite réflexion (cf. point suivant). B. Préalablement à l’étude des infractions, il y a quelques questions qu’il faut se poser : 1) Quels sont les objectifs du droit pénal ? On pourrait penser à la dissuasion, la réaction à certains comportements inacceptables, la paix sociale, etc. Pour répondre à la question, on doit commencer par faire la différence entre le droit imposé (sanction) et le droit pénal négocié (développement de procédures de médiation pénale et autre). La procédure de médiation pénale a l’avantage d’impliquer l’auteur dans le processus de réflexion sur son acte et sur sa propre vie. Il permet également d’ouvrir le dialogue avec la victime (confrontation avec les conséquences de ces actes). Si l’objectif du droit pénal est la prévention, on ne peut pas être sûr que ça marche. Par contre, si sont objectif est la rétribution, cela marche toujours : le mal est payé par le mal, une peine est infligé en réponse à l’acte posé. Mais, cette finalité seule peut-elle être retenue sans prendre d’autres valeurs en compte ? Où doit-on situer la frontière entre déviance et infraction ? La déviance est tout phénomène d’écart par rapport à une norme sociale. L’infraction sera-t- elle alors atteinte par la gravité de l’acte, par l’ampleur de l’acte, etc. ? La réponse pénale est-elle adaptée par rapport au comportement problématique qu’on veut définir en infraction ? 3 La réponse pénale n’était, par exemple, clairement pas adapté lorsque l’avortement était encore pénalisé. A cause de l’existence de la loi pénale, les femmes se faisaient avorter à leurs risques et périls dans des réseaux clandestins ou à l’étranger. La situation était dramatique. 2) Quelles sont les règles fondatrices du droit pénal ? Quelles sont les conditions de production des infractions ? Le processus de création de la loi pénale doit se faire de manière démocratique (débat dans des conditions légitimes). Ceci mène à la question suivante : Quelles sont les conditions nécessaires pour garantir que le processus et les procédures qui aboutissent à la définition d’un comportement comme infraction soient démocratiques et légitimes ? Il y a de plus en plus de processus de création d’infractions qui ne répondent pas à ces conditions (ex : loi sur le terrorisme prise en application d’une décision-cadre de l’Union européenne qui n’est pas prise par le parlement européen (droit d’avis) mais bien par le Conseil de l’Union européenne (représentants des différents Etats). Dans la prise de décision pour cette loi, il n’y a donc pas eu tout un processus d’élaboration et de décision démocratique). Les décisions se prennent de plus en plus à un niveau international et ne permettent alors plus aux parlements nationaux de jouer leur rôle. Quel est le niveau minimal de garanties juridiques qu’une société démocratique peut accepter à l’égard de la définition des infractions et de l’application des peines ? (cf. résumé de Droit et justice de FERRAYOLLI) Pour qu’un comportement se transforme en infraction pénale, il faut que toute une série de conditions soient remplies. Il faut, par exemple, qu’un véritable dommage soit porté à quelqu’un et que le droit pénal soit nécessaire (ultime recours). C. Le droit pénal et les réactions alternatives : Le droit pénal spécial va définir ce qu’est une infraction et donc fixer la différence entre l’écart aux normes sociales et l’écart aux normes pénales. Un principe très important ici est celui de la légalité : il faut qu’il y ait une loi pénale formelle pour qu’un comportement soit défini comme infraction et puni par une peine. Le principe de légalité impose que la loi précède toujours à l’acte criminel. L’« infraction » n’est alors pas un jugement de moralité (ex : meurtre et soldat qui tue en situation de guerre). Par rapport à cela, un grand juriste italien, CARRERA, a dit que : « Le crime n’est pas un acte mais bien un fait juridique. » Cette pensée est issue de l’école classique. Par rapport à une infraction, uploads/S4/ droit-penal-special.pdf
Documents similaires
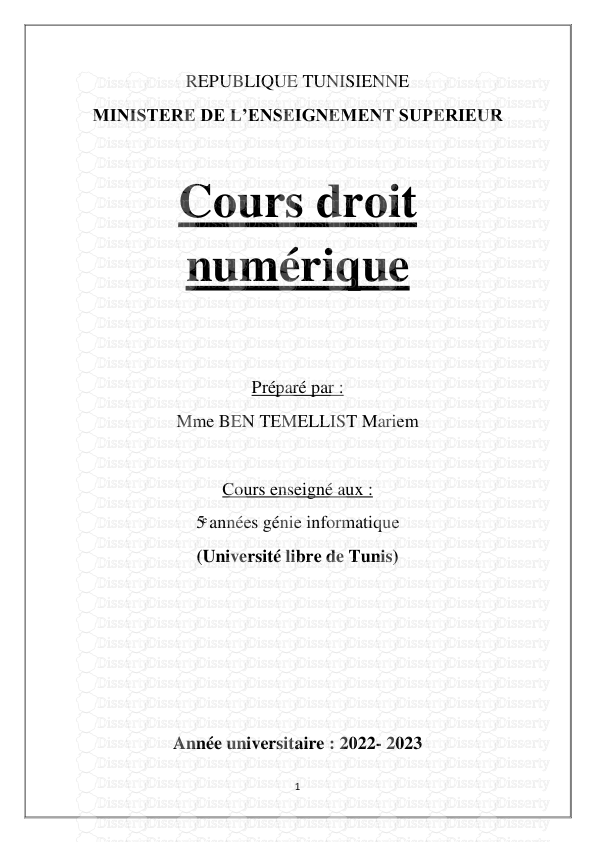

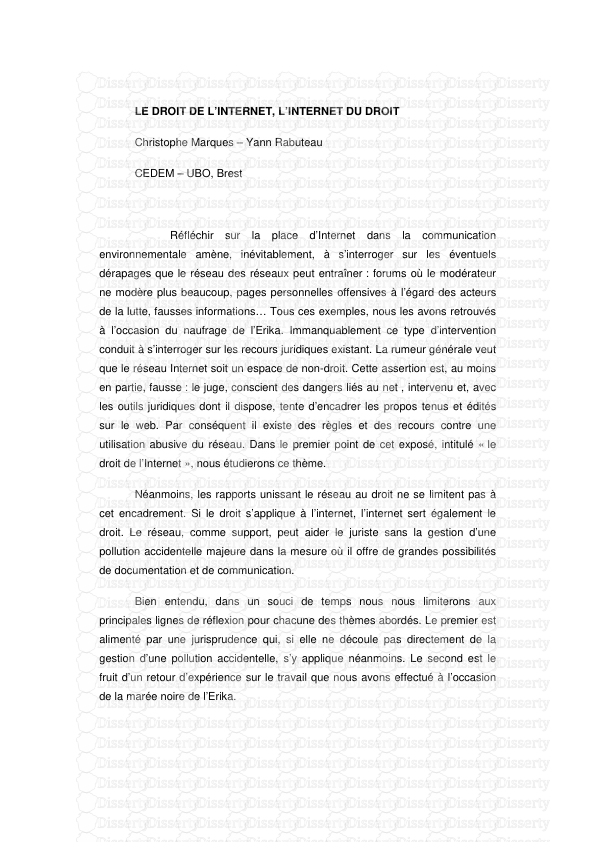







-
32
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 28, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2462MB


