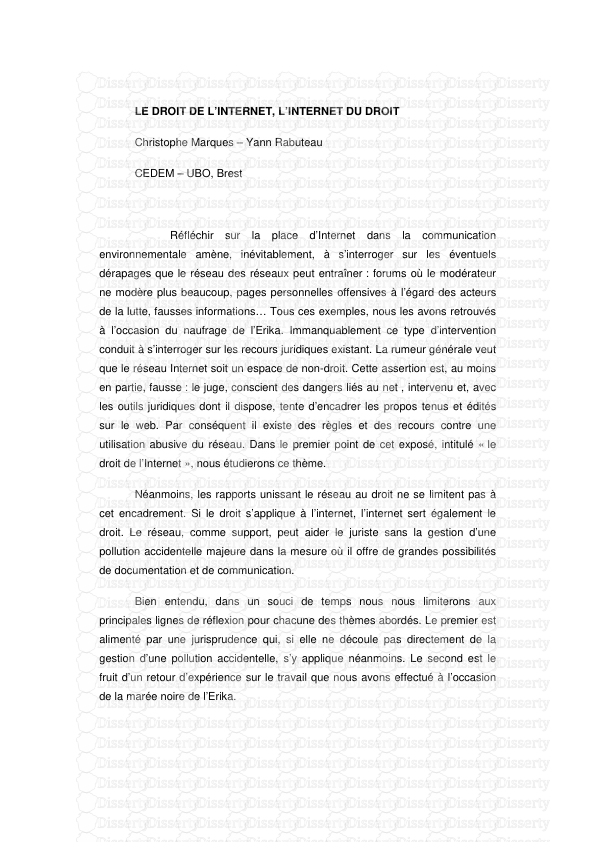LE DROIT DE L’INTERNET, L’INTERNET DU DROIT Christophe Marques – Yann Rabuteau
LE DROIT DE L’INTERNET, L’INTERNET DU DROIT Christophe Marques – Yann Rabuteau CEDEM – UBO, Brest Réfléchir sur la place d’Internet dans la communication environnementale amène, inévitablement, à s’interroger sur les éventuels dérapages que le réseau des réseaux peut entraîner : forums où le modérateur ne modère plus beaucoup, pages personnelles offensives à l’égard des acteurs de la lutte, fausses informations… Tous ces exemples, nous les avons retrouvés à l’occasion du naufrage de l’Erika. Immanquablement ce type d’intervention conduit à s’interroger sur les recours juridiques existant. La rumeur générale veut que le réseau Internet soit un espace de non-droit. Cette assertion est, au moins en partie, fausse : le juge, conscient des dangers liés au net , intervenu et, avec les outils juridiques dont il dispose, tente d’encadrer les propos tenus et édités sur le web. Par conséquent il existe des règles et des recours contre une utilisation abusive du réseau. Dans le premier point de cet exposé, intitulé « le droit de l’Internet », nous étudierons ce thème. Néanmoins, les rapports unissant le réseau au droit ne se limitent pas à cet encadrement. Si le droit s’applique à l’internet, l’internet sert également le droit. Le réseau, comme support, peut aider le juriste sans la gestion d’une pollution accidentelle majeure dans la mesure où il offre de grandes possibilités de documentation et de communication. Bien entendu, dans un souci de temps nous nous limiterons aux principales lignes de réflexion pour chacune des thèmes abordés. Le premier est alimenté par une jurisprudence qui, si elle ne découle pas directement de la gestion d’une pollution accidentelle, s’y applique néanmoins. Le second est le fruit d’un retour d’expérience sur le travail que nous avons effectué à l’occasion de la marée noire de l’Erika. 1. Le droit de l’internet 1. Peut-on tout dire, tout faire sur le net ? 2. Les voies de recours Propos introductifs : Il n’y a pas encore un droit de l’internet, en ce sens qu’il n’existe pas un corps de règles unifiées spécifiquement dédié au réseau mondial. Le phénomène est, en France, encore trop récent (tout au moins son usage par la masse des français). Face aux difficultés inévitables que pose le réseau, le juge a réagi en appliquant le droit dont il disposait. Il s’agit donc, aujourd’hui, d’une construction prétorienne s’appuyant sur un droit non spécifique à internet. Le juge applique des règles non spécifiques : le juge, confronté aux problèmes du net, les résout en recourant à trois grands corps de textes : l’application du code civil (et on voit des utilisations intéressantes de 1384 de ce code), la loi sur la presse de 1889 et la loi sur la communication du 30.09.1986. Mais cet état de fait n’est pas très satisfaisant car la toile confronte réellement le droit à des problèmes nouveaux. Dès lors, même si on ne met pas en place un droit spécifique, il faut tout au moins aménager de manière adéquate les règles existantes. Les chantiers législatifs. En France, on peut déjà citer les nouveaux articles de la loi du 30.09.1986 spécifiques à la responsabilité des acteurs de l’internet (articles d’ailleurs controversés). L’Europe elle aussi s’intéresse au domaine et on devrait voir, dans les années à venir, la mise en place d’un encadrement juridique (presque) complet du réseau mondial. Fort de ces quelques remarques, dans ce premier volet de l’exposé, nous allons donc tenter, d’abord, de répondre à cette question simple : peut-on tout dire, tout faire sur internet ? Ceci nous amènera à donner les principales règles de droit régissant, maintenant, le net. Ensuite, nous présenterons très succinctement les voies de recours ouvertes aux victimes d’une page web. Peut-on tout dire, tout faire sur le réseau ? Peut-on tout dire sur le réseau ? - On peut dire beaucoup, mais pas tout : racisme et révisionnisme ; Les propos constituant une infraction pénale sont, de la même manière que lorsqu’ils émanent de la presse écrite, réprimés sur la toile. C’est essentiellement autour de deux grands thèmes que se focalisent les débats : le racisme et le révisionnisme. Un jugement du TGI de Paris, rendu le 10 juillet 1997, va constituer notre première illustration. Cette affaire opposait l’Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) à Jean-Louis C (auteur compositeur). M. Jean-Louis C. était l’éditeur d’un site sur lequel figuraient les textes de ces chansons dont le contenu était ouvertement raciste et antisémite. Sans entrer dans les détails, nous remarquerons que le juge a choisi, dans cette affaire, d’appliquer à la page web de M. Jean-Louis C. la loi de 1881 sur la presse et non pas, comme le demandait les requérants, le droit commun de la responsabilité. Cela aboutit, concrètement, à l’absence de condamnation de M. Jean-Louis C. mais cela permet, à terme, un encadrement plus ferme des propos racistes figurant sur le net. Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris va venir affiner cette jurisprudence. L’arrêt est rendu le 15 décembre 1999 et concerne encore une page contenant des propos racistes. En première instance, les juges avaient bien appliqué la loi sur la presse de 1881 mais, conformément à cette loi, n’avait pas condamné l’éditeur de page web au motif que l’action publique était éteinte du fait de la prescription légale spéciale de trois mois en matière de presse. En effet, la page était accessible depuis bien plus de trois mois. Les juges d’appel vont tenir compte de la spécificité du réseau pour réformer cette décision. En effet, si la loi sur la presse de 1881 s’applique bien sur le réseau, il convient de tenir compte de la différence manifeste entre une publication papier, ou une diffusion d’émission télévisée, et internet. Par conséquent, les juges de la Cour d’Appel de Paris retiennent la solution suivante : considérant que sur le net, l’acte de publication est continu, l’émetteur maintient sa volonté délictueuse tant que la page est accessible, donc la prescription ne peut pas jouer, le délai de prescription est gelé. L’auteur est donc condamné. Cet arrêt conduit aussi à envisager une nouvelle responsabilité pour l’hébergeur qui, dès lors qu’il a connaissance du caractère délictueux d’une page, doit cesser de fournir les moyens techniques permettant la diffusion sous peine d’être poursuivi comme complice. Une affaire tout aussi intéressante, jugée le 13 novembre 1998, concerne les propos révisionnistes de M. Faurisson. Un site hébergé aux Etats-Unis proposait, en ligne, des pages révisionnistes signées par M. Faurisson. Même si le TGI de Paris ne conclut pas à la condamnation de M. Faurisson du fait de l’impossibilité d’acquérir la certitude qu’il est bien l’éditeur de la page1, il apporte beaucoup au droit de l’internet en décidant que l’hébergement d’un site aux Etats-Unis n’empêche pas les poursuites de l’auteur en France dès lors que ce site est accessible depuis la France puisque, recourant encore à la loi sur la presse, « le délit est réputé commis partout où l’écrit a été diffusé, l’émission a été entendue ou vue ». 1 Un doute subsistait sur le fait de savoir si c’était bien M. Faurisson qui avait directement saisi la page ou si un tiers avait mis en ligne des extraits du livre de M. Faurisson. Bien entendu, ces quelques exemples n’ont pas vocation à s’appliquer au domaine particulier de la pollution accidentelle en mer. Toutefois on ne peut les négliger car les conclusions de droit auxquelles ils aboutissent s’appliquent à tout site, quel que soit son contenu. Les exemples suivants s’appuient sur les mêmes développements juridiques mais dans un tout autre domaine, intéressant pleinement les acteurs d’une pollution accidentelle : la diffamation. La diffamation par voie de presse est un délit. Poursuivant son œuvre d’assimilation de l’édition de page web à une publication, le juge constate et punit la diffamation sur le net. - On ne peut pas accuser à la légère : la diffamation L’applicabilité des lois sur la presse et sur la communication audiovisuelle à l’édition de pages web entraîne, nécessairement, la possibilité de poursuivre les délits spécifiques à ces activités sur réseau. Il en va ainsi pour la diffamation. Dans une ordonnance de référé délivrée par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 30 avril 1997, le juge qualifie bien les propos d’une page web de diffamatoires. Toutefois, bloqué par le délai de prescription de trois mois des délits de presse, il ne peut poursuivre plus avant. Gageons que la jurisprudence évoquée plus haut sur le caractère continu du délit de presse sur le web ôtera dorénavant au juge cet obstacle. Un jugement du Tribunal d’Instance de Puteaux du 28 septembre 1999 est plus explicite quant à la qualification du contenu d’une page web en tant que diffamation. Dans cette espèce, le juge décortique le contenu d’une page à la lumière des exigences des textes relatifs à la diffamation. Nous pouvons ici reprendre les principales étapes de son raisonnement : 1° les écrits incriminés ont été diffusés par un moyen de communication audiovisuelle ; 2° ces écrits n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ; 3° les écrits sont mis à la disposition uploads/S4/ expose-team-boukii.pdf
Documents similaires

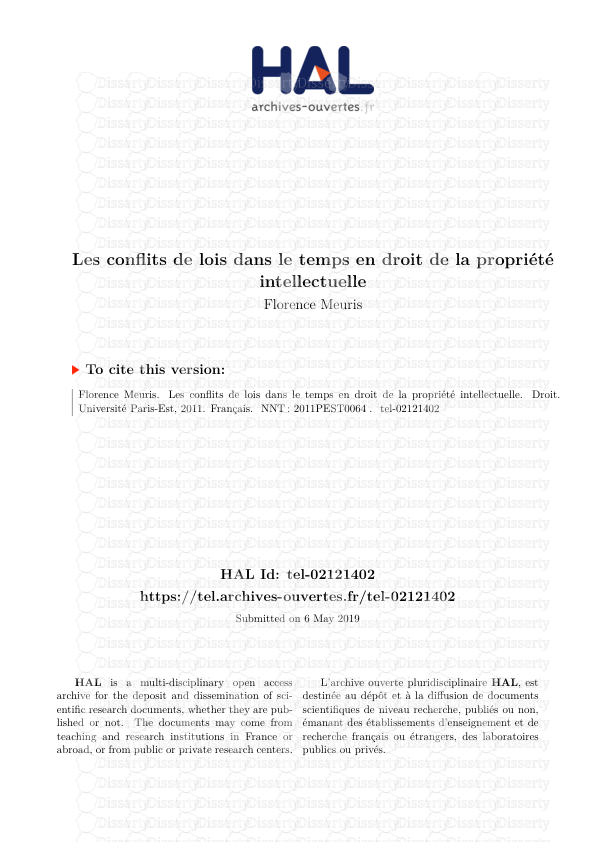








-
62
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 23, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0584MB