1 Guillaume Odinet Droit administratif Semestre d’automne 2018 C O N S T I T U
1 Guillaume Odinet Droit administratif Semestre d’automne 2018 C O N S T I T U T I O N E T J U S T I C E C O N S T I T U T I O N N E L L E Introduction Ainsi que l’énonce B. Stirn (dans Les sources constitutionnelles du droit administratif), « une société connaît un Etat de droit lorsque les rapports entre ses membres sont organisés selon des règles qui définissent les droits de chacun et assurent les garanties nécessaires au respect de ces droits ». L’existence d’un Etat de droit est donc inséparable de l’existence de normes et implique la soumission de l’Etat lui-même au droit. La structuration de l’Etat de droit suppose plusieurs niveaux de normes, de valeurs différentes : c’est l’image bien connue de la pyramide des normes théorisée par H. Kelsen. Les normes sont ainsi hiérarchisées : la norme inférieure doit respecter la norme qui lui est supérieure. Cette hiérarchie est sanctionnée par la justice : il doit, dans un Etat de droit, exister un juge susceptible d’assurer le respect, par chaque norme, des normes qui lui sont supérieures. Au sommet de la hiérarchie des normes se trouve la Constitution, dans laquelle nombre de principes d’organisation et de fonctionnement de l’administration trouvent leur source (cf. B. Stirn, Les sources constitutionnelles du droit administratif). 1. La Constitution La constitution actuellement en vigueur en France est la Constitution du 4 octobre 1958, 5ème constitution républicaine1. On ne présentera pas ici l’histoire constitutionnelle de la France, qui éclaire néanmoins sur bien des aspects l’état actuel du droit constitutionnel français. L’étude de celui-ci suppose de présenter la place de la Constitution (a) et son contenu (b et c). a. La Constitution, norme suprême 1°) La Constitution est la norme suprême dans l’ordre juridique national. La notion d’ordre juridique est parfois difficile à appréhender ; l’ordre juridique est comparable à un univers, en ce sens qu’il est un tout cohérent ; il désigne l’ensemble des normes qui gouvernent une entité. L’ordre juridique français est ainsi composé de l’ensemble des normes applicables en France, qui régissent le fonctionnement de notre société. Le caractère de norme suprême de la Constitution a fait l’objet de rappels récents, tant par le Conseil d’Etat (CE, 30 octobre 1998, Sarran et Levacher) que par la Cour de cassation (Cass, 2 juin 2000, Pauline Fraisse) et le Conseil constitutionnel (CC, 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe). Dans l’ordre juridique national, aucune norme n’a une valeur supérieure à la Constitution. 1 Constitution de l’an I (24 juin 1793) ; Constitution du 4 novembre 1848 ; Lois constitutionnelles des 24, 25 février et 16 juillet 1975 et Constitution du 27 octobre 1946. 2 Cela implique également qu’il n’existe pas de « supraconstitutionnalité », ce que le Conseil constitutionnel a énoncé explicitement à 2 reprises (CC, 22 septembre 1992, « Maastricht II » et 26 mars 2003, « Organisation décentralisée de la République ») : « Le Conseil constitutionnel ne tient ni de l’article 61, ni de l’article 892, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ». Une révision constitutionnelle, qui résulte de l’exercice du pouvoir constituant, est une norme insusceptible d’être contrôlée, car suprême. 2°) La Constitution est toutefois une norme évolutive, et ce de plus en plus. Alors qu’elle n’avait été révisée que 5 fois entre 1958 et 1992, elle l’a été 19 fois depuis, pour toucher à quatre grandes matières : - les institutions nationales (4 révisions) : champ du référendum et session unique (4 août 1995), lois de financement de la sécurité sociale (22 février 1996), quinquennat (2 octobre 2000), statut pénal du Président de la République (23 février 2007) ; et, dernière en date : modernisation des institutions (23 juillet 2008) ; - les institutions décentralisées (3) : Nouvelle Calédonie (20 juillet 1998), organisation décentralisée de la République (28 mars 2003), corps électoral de Nouvelle- Calédonie (23 février 2007) ; - les droits fondamentaux (4) : indépendance de la justice (27 juillet 1993), parité (8 juillet 1999), Charte de l’environnement (1er mars 2005), interdiction de la peine de mort (23 février 2007) ; - l’Europe et l’international (7) : le traité de Maastricht (9 avril 1992), les accords de Schengen et le droit d’asile (25 novembre 1993), le traité Amsterdam (25 janvier 1999), la Cour Pénale Internationale (8 juillet 1999), le mandat d’arrêt européen (25 mars 2003), le Traité constitutionnel (1er mars 2005), le Traité de Lisbonne (4 février 2008). Si cette évolutivité peut sembler remettre en cause la « suprématie » de la Constitution, notamment parce qu’elle traduit l’impact de plus en plus fort du droit européen et international, elle manifeste aussi la présence accrue de cette norme dans le droit appliqué quotidiennement. b. Les articles de la Constitution Il est indispensable de consulter la Constitution. Elle comporte, après le Préambule et l’article 1er, 17 titres : - Ier : De la souveraineté ; - II : Le Président de la République (élection et pouvoirs) ; - III : Le Gouvernement (nomination et pouvoirs) ; - IV : le Parlement (élection, missions et prérogatives, certaines modalités de fonctionnement) ; - V : Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement (articulation des compétences et procédure législative) ; - VI : Des traités et accords internationaux (conclusion et intégration dans l’ordre juridique national) ; - VII : Le Conseil constitutionnel (composition, missions, fonctionnement) ; - VIII : De l’Autorité judiciaire (indépendance et garanties) ; - IX : La Haute Cour (responsabilité du Président de la République) ; - X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement ; - XI : Le Conseil économique, social et environnemental (composition, missions, fonctionnement) ; 2 Cet article 89 dispose que « La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ». 3 - XI bis : Le Défenseur des droits (missions et fonctionnement) ; - XII : Des collectivités territoriales (désignation, pouvoirs) ; - XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - XIV : De la francophonie et des accords d’association ; - XV : De l’Union européenne (principe de la participation et dispositions propres à certains domaines d’action de l’UE) ; - XVI : De la révision (un seul article : art. 89). On constate en la parcourant que le texte de la Constitution est très institutionnel. Elle est en effet centrée sur les pouvoirs publics et les institutions dont elle prévoit l’existence. Nombre d’entre elles font l’objet d’un titre (Président de la République, Gouvernement, Parlement, Conseil Constitutionnel, Autorité judiciaire, CESE, Défenseur des droits, Collectivités territoriales). D’autres institutions administratives y figurent : ainsi notamment du Conseil d’Etat (dans ses deux rôles, consultatif et contentieux) et de la Cour des comptes (dans son rôle d’appui au Parlement). Et l’article 20 place l’administration sous l’autorité du Gouvernement. Les articles de la Constitution énoncent principalement des règles de compétence et de procédure : ainsi notamment de la répartition de la compétence réglementaire entre Président de la République et Premier ministre, ou encore de la répartition de la compétence normative entre le Gouvernement et le Parlement (loi et règlement, approbation des traités). On trouve également quelques principes de fond : - la plupart dans l’article 1er et les tout premiers articles relatifs à la souveraineté : égalité devant la loi, laïcité, indivisibilité de la République, caractère décentralisé de la République, pluralisme des courants de pensée, souveraineté populaire, principes relatifs au suffrage (universel, égal et secret), libre constitution des partis ; - quelques autres, « disséminés » dans le texte constitutionnel : libre administration des collectivités territoriales, indépendance de l’autorité judiciaire, autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle. c. Le Préambule de la Constitution Peu de droits fondamentaux (que l’on peut définir comme les droits d’importance majeure, protégés au niveau le plus élevé de l’ordonnancement juridique et qui s’imposent à tous, même au législateur) sont reconnus dans le texte même de la Constitution. Mais le Préambule de celle-ci énonce, en son 1er alinéa : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 ». Il renvoie ainsi à 3 textes : - La Déclaration de 1789 ; - Le Préambule de 1946 ; - La Charte de l’environnement de 2004. Par sa décision du 16 juillet 1971, « Liberté d’association », le Conseil constitutionnel a jugé que ce renvoi conférait une valeur constitutionnelle à ces trois textes, qui font ainsi pleinement partie des normes de référence au regard desquelles il exerce son contrôle. On parle communément de « bloc de constitutionnalité » pour désigner ces normes de référence, qui dépassent le strict texte constitutionnel. Ces 3 textes consacrent de nombreux droits fondamentaux. Ainsi, c’est surtout par le jeu du renvoi de son Préambule que uploads/S4/ fiches-droit-admin.pdf
Documents similaires








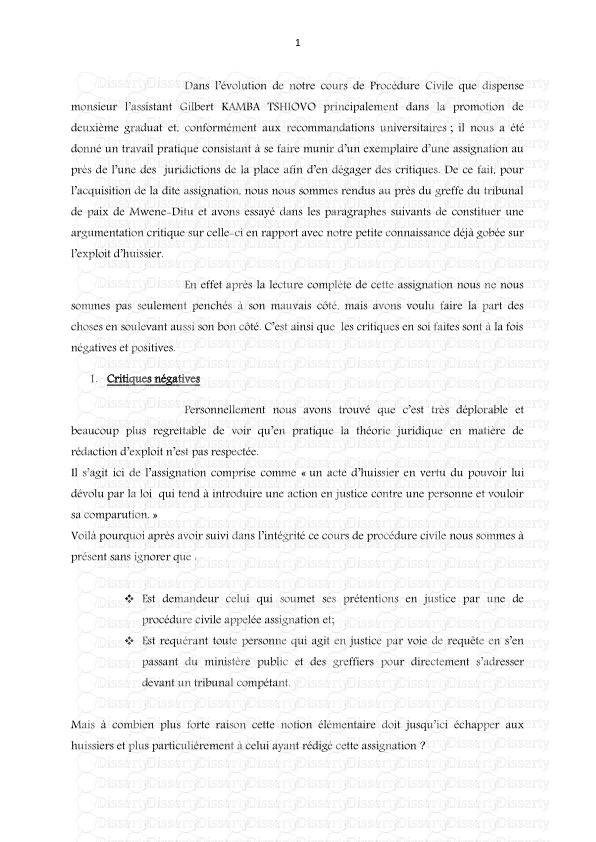

-
40
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 30, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.5404MB


