Libertés et droits fondamentaux : Adresse : nuage.parisnanterre.fr / Teams. Int
Libertés et droits fondamentaux : Adresse : nuage.parisnanterre.fr / Teams. Introduction : La crise sanitaire est inédite pour deux raisons majeures : Les limitations de libertés concernent toute une société / ces mesures de restrictions se sont généralisées pour devenir la norme. Cette crise sanitaire a tout bousculé, révolutionné ou alors n’a fait qu’accentuer ou révéler certaines failles qui exister auparavant. I- Le vocabulaire des droits et libertés A- Droit ou libertés ? 1- Les libertés Illustrer la liberté à défaut de la définir : - L’arbre de la liberté (1790) - Le génie de la liberté, Place de la Bastille, Auguste Dumont (1835) - La liberté guidant le peuple, Delacroix (1830) - La statue de la liberté, Bartholdi - La devise de la république française (Liberté, Egalité, Fraternité) … Il existe plusieurs manières de représenter la liberté. La liberté est un état, qui est descriptif mais c’est aussi et surtout un idéal. La liberté comprend deux composantes, qui marchent ensemble et non séparément : - Il y a la liberté intérieure, individuelle, c’est une absence de contrainte physique. Mais c’est aussi le pouvoir d’exercer sa volonté, d’opérer des choix, d’agir. C’est la liberté de mouvement (qui regroupe la liberté d’aller et venir…). - Il y a la liberté extérieure, socio-politique, c’est le rapport de l’homme à autrui, à la société. « La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres » : J.S Mill ; « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » : article 4 DDHC de 1789. La liberté n’est pas absolue, la liberté a vocation à être concilié avec d’autres droits et libertés, avec des impératifs sociaux (ordres publics…). La liberté s’emploie par conséquent en parlant « des libertés », dans le souci de couvrir le plus grand nombre de libertés. Bilan : Il existe plusieurs formes de libertés, autant de libertés que de contraintes dont l’Homme cherche à s’affranchir. C’est à la fois un état mais aussi un idéal (utopie). La liberté est un bien commun immatériel. 2- Les droits Pendant longtemps, droits et libertés ont été considéré comme synonyme. La doctrine a cherché à les distinguer. Certains les distinguent, d’autres pas. On peut les distinguer de deux manières : en fonction de leur contenu, en fonction de leur portée. - Contenu : Les droits et libertés ne sont pas déterminés de la même manière. Le droit est plus une autorisation de faire quelque chose. La définition de la liberté est avant tout négative. Alors que le droit lui aura un sens positif, la plupart du temps. - Portée : Exercice de la liberté pourrait être solitaire / droits va impliquer nécessairement un rapport entre deux sujets : relation intersubjective. La liberté est le pouvoir de faire, de s’opposer au pouvoir d’un autre. Alors que le droit correspond au pouvoir de faire faire. Pour conclure, la distinction est assez confuse. C’est aussi une distinction avant tout conceptuelle. B- Les dénominations des droits et libertés Le droit des libertés fondamentales est une appellation nouvelle. Même si la matière traite de questions et de problèmes ancestraux. Les appellations varient, or ce n’est pas une question de mots. C’est avant tout un choix épistémologique réfléchi : droits et libertés. Le concept de « droits fondamentaux » : cette expression vient essentiellement du droit étranger, du droit allemand plus précisément : « Grundrechte ». En Allemagne, ils ont un « catalogue » de droits. Ces droits sont tellement essentiels qu’il faut donc les mettre à l’abris du vivant. Aux Etats- Unis, ils sont appelés les « fundamental rights ». En France, ils sont arrivés tardivement. Il y aura un mouvement de constitutionnalisation. Malgré l’apparition de ces droits, il n’y a pas de définition officielle. L’article 53-1 de la constitution parle du droit d’asile. Dans la loi et la jurisprudence, cette expression est rarement utilisée. Ce concept connait davantage de succès dans les rangs de la doctrine que dans le droit positif. Il y a deux types d’approche : - L’approche formelle : un droit ou une liberté est considéré comme fondamental lorsqu’ils sont inscrits dans une norme juridique supérieur à la loi. - L’approche matérielle : c’est un droit, une liberté qui parait particulièrement essentielle dans notre société, qui est une valeur essentielle de notre société. Certains droits sont premiers car ils conditionnent les autres droits. Un droit est particulièrement essentiel mais qui dépend de plusieurs facteurs. Ces deux proches font l’objet de critiques. Pour certains, l’approche matérielle est purement subjective, aléatoire. On lui reproche aussi de se situer dans un registre prescriptif. Il y a un risque de dérive, menant à une hiérarchie des droits et libertés. Alors que l’approche formelle, on lui reproche d’être trop restrictive et de ne pas s’intéresser à la jurisprudence, donc d’être concentré sur le droit positif. Il existe bcp d’autres approches. Ces deux approches sont complémentaires. Ils correspondent à un ensemble de droit et libertés inscrits dans le droit nationale ou international et qui viennent protéger les valeurs les plus importantes de notre société. Le concept de libertés publiques a un accent positiviste très fort, ces origines remontent à la révolution française et qui connaitra son plus gros dvpt au 19ème siècle puis pendant la 3ème république. C’est au législateur de garantir les droits et libertés. Les libertés publiques sont les libertés inscrites dans la loi et aménagé par le législateur, globalement ce sont des libertés négatives qui implique l’abstention de la puissance publique. Cette notion est tombée en désuétude. C’est une appellation franco-française, c’est la première critique qui peut lui être faite, elle est restrictive. Cette expression laisse de côté un bon nombre de droits sociaux. Le concept de droits de l’homme est très connu mais fait aussi l’objet de critiques. La DDHC de 1789, la DUDH de 1948 est le premier grand texte international. La première critique est que c’est une idéologie, une utopie et non une catégorie juridique. La deuxième est que cette notion est souvent considérée comme militante. Pour finir, c’est une appellation trop abstraite, ayant une vocation universaliste. D’où la nécessité de construire une notion sur des fondements rigoureux : un contexte historique originel (mouvement de positivation des droits naturels), principales sources. Le concept de droits de la personne, c’est la moins répandue en France. Or elle est très présente au Canada, c’est la loi canadienne sur les droits de la personne de 1985. Ce concept a deux influences bien distinctes : les mouvements féministes, pensée de l’église catholique. Le concept de droits humains, c’est une question propre à la langue française avec une ambiguïté sémantique avec l’homme et l’Homme. Ce concept comporte deux influences principales : les mouvements féministes, le droit comparé, le droit international. Mettre fin à l’ambiguïté sémantique est un mouvement qui a peu de succès en France. L’objectif est de rompre avec cette conception abstraite des droits, symbolisée par la DDHC, mais aussi de prôner un autre rapport entre l’individu et l’Etat. Ces différentes appellations, assez souvent, elles se recoupent. Hormis les libertés publiques qui est une appellation plus restrictive. C- Les classifications des droits et libertés Il existe différents types de classifications : en générations de droits qui semble la plus logique ; les droits et libertés individuels/collectifs ; libertés physiques/libertés de l’esprit ; droits conditionnels/ droits intangibles… La classification en générations : on ne s’est pas contenté de les distinguer, on les a hiérarchisés par vagues, par générations successives (époques différentes). Effectivement, il y a des vagues successives qui se complètent avec des droits et libertés mais qui sont néanmoins différents. Généralement, on parle de 3 ou 4 vagues générationnelles : - Les droits de 1ère génération : droits négatifs (DDHC, CEDH, Magna Cartas, Bill of rights…) - Les droits de seconde génération : droits de créances, droits économiques, sociaux et culturels (Déclaration de 1793, Préambule de 1946, Constitution de 1848… - Les droits de troisième génération. Les droits de 1 ère génération comportent des textes nationaux (Bill of rights anglais de 1866, Bill of rights américain, DDHC de 1789) et des textes internationaux (CEDH de 1950…). Ce sont des droits des libertés qui accorde à l’individu une faculté d’agir et qui nécessite une abstention de l’Etat. Les droits de seconde génération sont les droits de créance, droits positifs, droits économiques- sociaux-culturels… qui comportent des textes nationaux (déclaration de 1793, préambule de la constitution de 1946…) mais aussi des textes internationaux (DUDH, charte sociale européenne de 1961…). Il y a une différence puisqu’on cherche à s’intéresser à l’individu économiquement situé et non à l’individu abstrait. Ils sont présentés comme impliquant une action de la part de l’Etat, soit sous forme de prestations, soit sous forme de services. Les droits de troisième génération sont les droits de la nature, droit de l’humanité, droits de solidarité. Présent surtout en droit international : déclaration de Stockholm (1972). Ex : droits des peuples à disposer d’eux-mêmes, droit de l’environnement… Ils ne sont plus centrés sur l’être humain mais une visée bcp plus large, incluant l’environnement. uploads/S4/ intro-partie-1-titre-1.pdf
Documents similaires


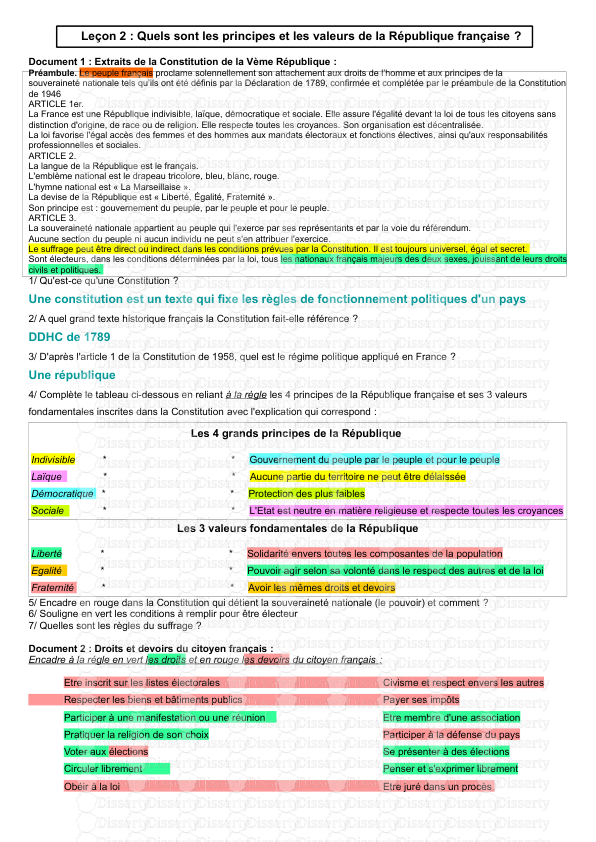







-
87
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 01, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.3633MB


