TITRE du cours : Introduction générale au droit Niveau : Licence 1 Semestre 2 V
TITRE du cours : Introduction générale au droit Niveau : Licence 1 Semestre 2 Volume horaire : 20 heures soit 4 heures par semaines pendant 5 semaines. OBJECTIFS ET DESCRIPTIONS DU COURS Objectif général Ce cours constitue une introduction au droit. Il vise à fournir aux étudiants un panorama de la discipline et l’acquisition du vocabulaire et des concepts nécessaires à l’analyse du droit. L’objectif général se subdivise en plusieurs objectifs spécifiques. Objectifs spécifiques Au bout de 20 heures du cours, les étudiants devront être en mesure : - de connaitre les caractères de la règle de droit ; - de distinguer les divisions et les sources du droit ; DESCRIPTIONS DU COURS Le cours sera divisé en deux grandes parties. -La première partie examinera ; le caractère de la règle de droit ; la division et les sources du droit. - La deuxième partie traitera de la différence entre droits patrimoniaux et droits extra patrimoniaux METHODE D’ENSEIGNEMENT L’enseignement est certes basé sur la méthode du cours magistral, mais il met l’accent sur la discussion avec les étudiants qui sont fortement encouragés à intervenir. Le cours est conceptuel et théorique. Le débat a pour but de trouver un arbitrage harmonieux entre ces dimensions fondamentales et leur traduction concrète. 1 INTRODUCTION GENERALE AU DROIT Le cours d’introduction au Droit traite des notions fondamentales régissant le droit. Il a pour but de présenter aux étudiants une idée générale du droit, ce qui leur permettra de mieux comprendre par la suite les autres matières du droit. Le droit correspond à une construction sociale et a pour objectif d’organiser la vie en société et les relations entre les personnes qui la composent de manière harmonieuse. Il apporte des solutions aux problèmes posés par la vie sociale en essayant de trouver un équilibre entre les intérêts souvent divergents des personnes. Le droit a pour finalités : - d’assurer l’ordre et l’équité ; - d’assurer la sécurité des personnes et des biens ; - de réaliser la justice entre les individus et entre les individus et la société ; - de protéger l’intérêt général. On reconnait au mot droit deux sens principaux, à la fois antinomiques et complémentaires : le droit objectif d’une part et d’autre part, les droits subjectifs. CHAPITRE I : LES DEFINITIONS DU DROIT S’agissant de définir la notion de droit, la difficulté tient au fait que dans le langage courant on utilise le mot « droit » en des sens très divers, si bien que l’on peut avoir à priori du droit, des notions fort différentes Citons un certain nombre d’exemples tirés du langage courant : Un enfant dit : « j’ai le droit d’aller au cinéma » ; Le père de cet enfant dit : « j’ai le droit de corriger mon enfant ». Un automobiliste, roulant sur la route et rencontrant un feu, lorsque le feu passe au vert pense : « j’ai le droit de passer » ; 2 Le policier qui siffle celui qui brule le feu dit : « j’ai le droit de vous dresser un procès-verbal ». Très curieusement, dans ces quatre exemples, il n’y a pas de droit ; ni pour l’enfant, ni pour le père, ni pour l’automobiliste, ni pour le représentant de la force publique. Il y a pour l’enfant une permission, pour le père et le policier un pouvoir, pour l’automobiliste un devoir. Un automobiliste ne peut dire qu’il a le droit de rouler à droite ; il a le devoir de rouler à droite. Est-ce à dire que ces situations qui n’ouvrent pas de droit ne sont pas régies par le Droit ? Ainsi, le droit peut être défini comme l’ensemble des principes reconnus et appliqués par l’État dans l’administration de la justice. On parlera alors de droit objectif, reconnu comme étant « le Droit » (au singulier). Cette définition est différente de celle qui veut que le droit soit constitué des prérogatives et pouvoirs reconnus aux sujets de droit. On est ainsi en présence de droits subjectifs, désignés sous le vocable « les droits » (au pluriel). Il importe de savoir que cesdeux notions sont liées car les droits subjectifs doivent nécessairement être reconnus et encadrés par le droit objectif pour que le sujet de droit, la personne, puisse s’en prévaloir devant une autorité publique. - LE DROIT OBJECTIF Le droit est, en premier lieu, un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. Cet ensemble est appelé Droit objectif. Ce qualificatif « objectif » est tiré du mot objet, Dans ce cas, il s'agit de délimiter la part de liberté et de contrainte de chacun. Il faut définir ce qui est permis ou pas pour que la vie sociale soit possible. La société établit des règles destinées à régir son fonctionnement, et par voie de conséquence, à organiser les relations des personnes qui la composent. 3 Ces règles sont, en principe, uniques pour les individus d’une même communauté : - Ces règles peuvent concerner un pays. On parlera de droit malien, de droit ivoirien ou français. - Ces règles peuvent concerner un système juridique. On évoquera les droits anglo-saxons ou du droit romain. - Ces règles peuvent aussi concerner une matière, tel le droit civil ou le droit administratif - LES DROITS SUBJECTIFS Le mot droit a une seconde signification. Le Droit objectif reconnaît, en effet, des prérogatives aux individus. Ces prérogatives sont des droits subjectifs dont les individuspeuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres. Il ne faut pas perdre de vue que ledroit a pour but d'organiser la vie en société, donc de régir des personnes qu'on appelle sujets de droit. Dans ce second sens, le droit est envisagé de façon plus concrète et particulière. On examine les droits dont une personne est titulaire, les prérogatives individuelles que les personnes peuvent puiser dans le corps de règles constitué par le droit objectif. - Le droit, pris dans son sens subjectif, désigne alors une prérogative accordée à telle ou telle personne. Il s'agit par exemple du droit de propriété, de droit de vote, du droit de grève,etc... CHAPITRE II. LA NOTION DE LA REGLE DE DROIT La règle de droit est une règle de conduite sociale dont la violation est sanctionnée par l’autorité publique. Il convient d’expliquer cette définition en déterminant les caractères spécifiques de la règle de droit, caractères qui permettent de la distinguer d’autres règles SECTION I : LES CARACTERES SPECIFIQUES DE LA REGLE DE DROIT La règle de droit présente trois caractères essentiels. Elle est générale et abstraite, elle comporte une sanction et elle est obligatoire. 4 PARAGRAPHE I : LE CARACTERE GENERAL ET ABSTRAIT DE LA REGLE DE DROIT Le caractère général de la règle de droit signifie qu'elle a vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment la société. C’est pourquoi elle est toujours formulée de manière générale et impersonnelle, avec souvent les formules : "Quiconque..." ; "Toute personne...". La règle de droit concerne chacun et ne vise personne en particulier. En principe, le caractère général de la règle de droit constitue une garantie contre l'arbitraire, contre la discrimination individuelle. Mais souvent la règle de droit peut êtrediscriminatoire à l'égard d'un groupe de personnes pour des motifs bien déterminés. En outre,la généralité de la règle de droit est une protection nécessaire mais insuffisante contrel'arbitraire. PARAGRAPHE II : LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA REGLE DE DROIT La règle de droit, comme toute règle, a un caractère obligatoire. Elle constitue un commandement ; elle veut être obéie et respectée. Elle exprime un ordre soit en imposant l’accomplissement d’un acte (porter secours à une personne en danger), soit en interdisant d’en accomplir un autre (voler la chose d’autrui, causer un préjudice à autrui, …). La règle de droit est un ordre adressé à tous et que ceux-ci sont tenus de respecter. Mais toute règle de droit est assortie de sanction. PARAGRAPHE III : LE CARACTERE SANCTIONNATEUR DE LA REGLE DE DROIT Pour garantir le caractère obligatoire de la règle de droit, sa violation est assortie de sanctions. La règle de droit a un caractère coercitif, elle est sanctionnée par l'Etat. C'est cette consécration par l'Etat qui fait la spécificité de la règle de droit. Lorsque l'autorité judiciaire constate la violation d'une règle de droit, elle requiert la force publique pour que celle-ci contraigne le contrevenant à 5 respecter le droit. Il est possible d'exiger l'exécution de la règle de droit, au besoin en recourant à la machine de contrainte instituée par l'Etat (ex. la police, la gendarmerie, l’armée, etc...). La sanction étatique reste souvent une menace, une contrainte potentielle, car en général, on rencontre le respect volontaire de la règle de droit. Ce n'est pas seulement la peur des forces de l’ordre qui inspire ce respect volontaire du droit. Section II : Distinction de la règle de droit d’autres règles Ces différentes règles visent toutes l’organisation de la vie en société. En revanche, elles s’opposent au niveau de la source, de la finalité et de la sanction. Paragraphe 1 : Le Droit uploads/S4/ introduction-generale-au-droit-fseg 1 .pdf
Documents similaires



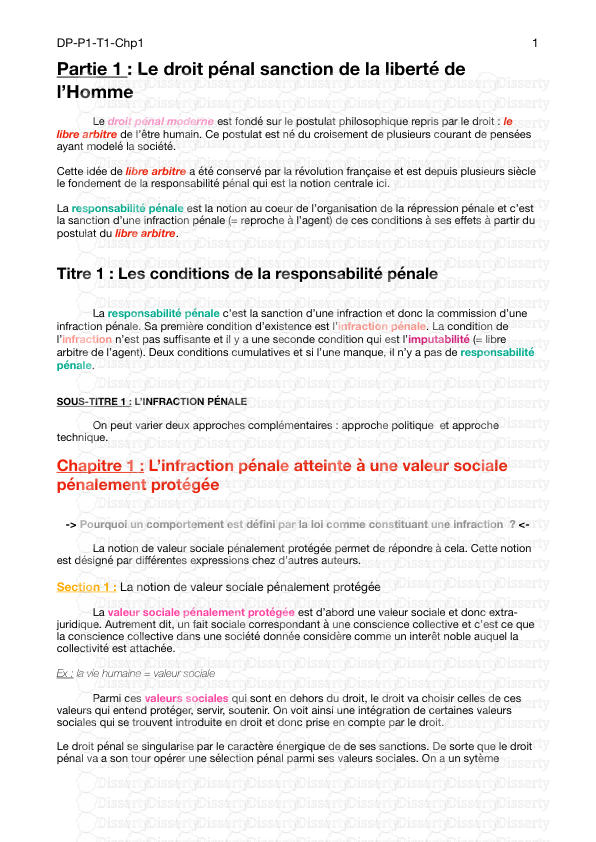






-
53
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 01, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1592MB


