08/09/2019 LA RÉPUBLIQUE DE PLATON - RÉSUMÉ ET ANALYSE rozsavolgyi.free.fr/cour
08/09/2019 LA RÉPUBLIQUE DE PLATON - RÉSUMÉ ET ANALYSE rozsavolgyi.free.fr/cours/civilisations/platon/ 1/37 LA RÉPUBLIQUE DE PLATON RÉSUMÉ ET THÈMES PREMIÈRE PARTIE : RÉSUMÉ DE LA RÉPUBLIQUE A - Méthode suivie Afin de rendre possible et surtout efficace la confrontation entre le texte de Platon et notre résumé, nous avons conservé, d'une part, la division en livres de I à X que l'Anti quité nous a transmise, d'autre part, la pagination de l'édition Estienne. Nous avons ajouté à cette pagination traditionnelle celle de l'édition Garnier-Flammarion (traduction de Robert Baccou), la plus maniable pour les étudiants. Nous renvoyons, bien entendu, également aux éditions Gallimard (t. I des œuvres de Platon dans « la Pléiade », trad. de Léon Robin), Les Belles Lettres (Budé, trad. d'Émile Chambry et introd. de Auguste Diès). Ces trois éditions sont infiniment précieuses pour la qualité de leurs notes et de leurs introductions. B - Argument La richesse extrême du contenu et de la construction de l'œuvre rendent périlleuse toute tentative de résumer en quelques lignes la problématique de La République. Quand on s'y risque, on est amené à dire que l'objectif de Platon est de démontrer qu'on ne peut traiter de la nature et de la nécessité de la Justice sans s'interroger aussi sur la nature et la nécessité d'une Cité juste et sur l'éducation que l'on doit donner aux gouvernants de cette Cité. Les divisions du dialogue sont les suivantes : - Livre I :Le problème de la justice sous l'angle individuel. - Livres II, III, IV : Le problème de la justice quand on envisage la fondation d'une Cité parfaite. - Livres V à VII : Les conditions de la réalisation de la justice par une éducation appro priée des gardiens de la Cité. - Livres VIII et IX : Pourquoi et comment la justice se dégrade dans l'individu et la Cité, et les principales formes de cette dégradation. - Livre X : Conclusions et ouverture sur la justice dans l'Au-delà. LIVRE I : ON NE PEUT BIEN POSER LE PROBLEME DE LA JUSTICE SI ON NE L'ENVISAGE QUE POUR L'INDIVIDU PROLOGUE :Au Pirée, les frères de Platon (Adimante et Glaucon) rencontrent, à l'occasion d'une fête, le sage et riche vieillard Céphale et, arrivés en sa demeure, entament une discussion sur la destinée et la justice (327-330 b, pp. 75-78). LES PERSONNAGES : Socrate, Glaucon et Adimante, Nicératos, Polémarque fils de Céphale, l'orateur Lysias, Euthydème, Charmantide, Clitophon, le sophiste Thrasymaque. La discussion entre Socrate et Céphale : - C. : avec le flétrissement des plaisirs du corps, augmentent le plaisir et le désir de la conversation. 08/09/2019 LA RÉPUBLIQUE DE PLATON - RÉSUMÉ ET ANALYSE rozsavolgyi.free.fr/cours/civilisations/platon/ 2/37 - S. : La sagesse provient de la conversation. - C. : On ne doit pas regretter la vieillesse qui calme les sens. Les regrets de certains vieillards proviennent de leur naturel qui a toujours été mauvais. - S. : Ta sérénité n'est-elle pas due à tes richesses ? - C. : Elles sont nécessaires mais non suffisantes. D'ailleurs, je les ai acquises par héritage. - S. : Quel est le plus grand bien procuré par la fortune ? - C. : Évitant la pratique de la tromperie et du mensonge, elle permet de pratiquer la justice. Al'heure de quitter ce monde, je me demande ce qu'il y a de vrai dans les mythes qui évoquent les châtiments qui attendent, dans l'Hadès, l'homme injuste. I - PREMIERE TENTATIVE DE DEFINITION DE LA JUSTICE : CONSISTE-T- ELLE À « RENDRE À CHACUN CE QU'ON LUI DOIT » (LA JUSTICE-DETTE : 331c-336d, pp. 78-84) - A - 331c-332a. - Demande de précision par Socrate : cela signifie-t-il que l'on doive toujours dire la vérité et toujours rendre ce que l'on a reçu, en particulier lorsque notre créancier est devenu fou ? Céphale ayant abandonné l'entretien, son fils Polémarque accepte la définition précédente, attribuée au vieux poète Simonide, tout en concédant qu'elle perd sa valeur quand celui à qui on doit rendre quelque chose est devenu fou. - B - 332b-336a. - Débat sur un prolongement de la définition précédente, proposé par Polémarque : « On doit faire du bien aux amis, du mal aux ennemis. » 1) [332b-337a] Préliminaires a)Socrate précise : ce qui est dû est ce qui convient : - comme la médecine qui donne aux corps les remèdes ; - comme la cuisine qui donne aux mets les assaisonnements. b)Polémarque revient à la définition : la justice procure du bien aux amis, du mal aux ennemis. 2) [333a-334b] Première objection de Socrate : être juste est-ce, seulement, être capable de faire le bien ? a)Ceux qui sont capables d'utiliser leurs talents pour le bien ont forcément la possi bilité de les mettre au service du mal. Par exemple : - le médecin est le plus capable de faire du bien ou du mal à ses malades ; - le pilote est le plus capable de faire du bien ou du mal à ses matelots et à sa cargaison. Donc habileté n'entraîne pas nécessairement justice. b)En temps de guerre, le juste (ici, le loyal) semble être utile puisqu'il s'allie à ses amis et nuit à ses ennemis. Mais, en temps de paix, la justice n'a de valeur que négative puisqu'elle ne s'identifie pas à l'habileté (le juste se contente de garder l'argent qu'on lui a confié tandis que l'habile financier s'emploie à le faire fructifier). 3) [334c-335c, pp. 82-83] Deuxième objection de Socrate : la fin de la définition de la justice proposée par Polémarque n'est pas satisfaisante car on peut confondre ami et ennemi a)On peut, en effet, être juste et/ou le paraître : - être juste et le paraître ; - être juste et ne pas le paraître ; - ne pas être juste et le paraître ; - ne pas être juste ni le paraître. b) Ils'ensuit que le juste peut, sans le vouloir, faire du mal à ses amis et du bien à ses ennemis. 4) Troisième objection de Socrate : l'extrême fin de la définition proposée par Polé marque est également critiquable : faire du mal à un cheval ou un homme ne les rend pas meilleurs mais pires : ce traitement rend injuste celui qui ne l'était pas et renforce la dureté de celui qui l'était déjà. 08/09/2019 LA RÉPUBLIQUE DE PLATON - RÉSUMÉ ET ANALYSE rozsavolgyi.free.fr/cours/civilisations/platon/ 3/37 - C - Conclusion : Ondoit donc rejeter la définition de la justice proposée par Polémarque. II - LA JUSTICE CONSISTE-T-ELLE À RECHERCHER L'AVANTAGE DU PLUS FORT (336b-354c, pp. 84-104) - Introduction [336b-338c, pp. 84-87] Thrasymaque reproche à Socrate sa manière de conduire l'entretien : interroger est plus facile que d'exposer ses propres idées. Quant à lui, Thrasymaque, il brûle d'envie de démontrer que le juste est l'avantage du plus fort. - A - 338c-347a. - Discussion sur la nouvelle définition. 1) [338cd] En quel sens, demande Socrate, entendre « plus fort » ? Physiquement ? Auquel cas tout le monde devrait suivre un régime athlétique. Politiquement alors ? 2) [338e-347b] Selon Thrasymaque, le juste est l'avantage du gouvernement constitué. a)[338c-341a] Discussion sur le terme de gouvernement : - Objection de Socrate : comme on peut se tromper en confondant ami et ennemi, les gouvernants aussi peuvent se tromper : le juste n'est donc pas plus l'avantage que le désavantage du plus fort. - Réponse de Thrasymaque : « Celui qui se trompe le fait quand sa science l'aban donne » (p. 89). Quand il parle de gouvernement, Thrasymaque entend celui qui remplit son office. De même, quand on parle de médecin en général, on parle de celui qui connaît et guérit les maladies et non de celui qui se trompe. b) [341c-347e] Discussion sur le terme « avantage » (pp.90-96). - Thèse de Socrate (341c-342e, p. 91) : les gouvernants ont en vue l'avantage des gou vernés. Si on reprend l'exemple de la médecine, on voit que le médecin recherche l'avan tage du malade. Si on prend l'exemple de la navigation, on voit que le capitaine recherche l'avantage de ses passagers et de sa cargaison. Il y a donc tout lieu de penser que le gou- vernant, quant à lui, recherche l'avantage des gouvernés. - Réponse de Thrasymaque (343a-344e, pp. 91-93). Si l'on prend l'exemple du berger, on voit qu'il recherche non l'avantage des « gouvernés » (les moutons) mais le sien propre : il élève des bêtes pour les vendre et les tuer. Nombre d'exemples montrent que la pratique de l'injustice est bien plus profitable que celle de la justice : - en affaires, le juste est souvent victime de l'injuste ; - en famille, le juste qui préfère la justice à ses proches, encourt leur haine ; - mais surtout la plus parfaite injustice - la tyrannie - est célébrée et admirée. Ceux qui blâment l'injustice sont, en fait, incapables soit de la souffrir, soit, de la faire subir. - Contre-attaque de Socrate (344c-347a, p. 93) : « Après avoir donné la définition du vrai médecin, tu n'as pas donné celle du uploads/S4/ la-republique-de-platon-resume-et-analyse.pdf
Documents similaires







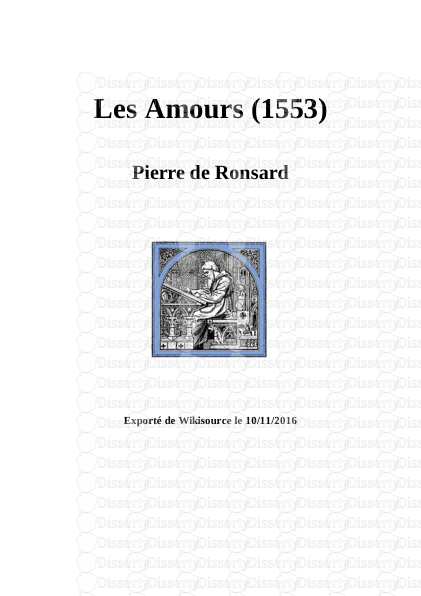


-
135
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 20, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.5148MB


