1 Le contrôle de constitutionnalité Définition : Le contrôle de constitutionn
1 Le contrôle de constitutionnalité Définition : Le contrôle de constitutionnalité est le moyen mis en place pour assurer le respect de la suprématie de la constitution et de son contenu (+ Préambule de la constitution de 1946 relatif à la DDHC1). Le 1er exemple de contrôle de constitutionnalité est l’arrêt Marbury vs Madison de 1803. Ce contrôle induit le principe de suprématie de la constitution (hiérarchie des normes, pyramide de Kelsen). L’article 4 de la DDHC : « la liberté ne peut être limitée que par la loi ». Le contrôle de constitutionnalité est un contrôle juridictionnel pour s’assurer que les normes de droit interne (loi, règlement) mais également externe (traités internationaux) respectent la constitution, qui est placée au sommet de la hiérarchie des normes. La théorie de Hans Kelsen : le rôle du juge est seulement procédural et le législateur peut passer outre en révisant la constitution (le juge aiguilleur). Par conséquent, le contrôle de constitutionnalité permet la défense des droits et des libertés : 1. Cela évite la « tyrannie de la majorité » du Parlement. 2. Cela instaure la suprématie de la constitution. 3. Cela garantit le respecte de l’Etat de droit. L’évolution du contrôle de constitutionnalité en France : - Or, qui contrôle la loi en France ? Le Conseil Constitutionnel. - Et à partir de quoi ? de la Constitution et de son préambule (dont la DDHC). La légitimité de la Constitution et de la DDHC (texte fondamental dans la protection des droits) est largement supérieure à la loi car directement issu du pouvoir constituant originaire (peuple). Par conséquent, le contrôle de constitutionnalité bénéficie d’une légitimité juridique et politique. Avant 2008 : Le contrôle de constitutionnalité n’a été introduit que tardivement en droit français (par la constitution de 1958). Les modes de saisine sont restreints puisque le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par voie d’action, dans un délai d’un mois avant la promulgation de la loi (art. 61 de la constitution). - La remise en cause de la légitimité du Conseil Constitutionnel : il a été critiqué car il n’existait qu’un seul contrôle (avant 2008) : a priori, non systématique, avec une saisine restreinte du Président de la république ou 1er ministre ou Président de l’Assemblée nationale ou Président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs. En définitive, les lois saisies par un membre de ce corps ne pouvaient être saisies par les citoyens : cela permettait la promulgation d’un grand nombre de lois qui pourraient être inconstitutionnelles. - Décision du Conseil Constitutionnel du 16 juillet 1971 : Le Conseil Constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle des normes issues du bloc de constitutionnalité qui étaient auparavant considérées comme déclaratives, ainsi le Conseil Constitutionnel s’est érigé en protecteur des droits el libertés des citoyens et en garant de l’Etat de droit. 1 DDHC : Déclaration des Droit de l’Homme et du Citoyen de 1789. 2 - Réforme de 1974 (Valérie Giscard d’Estaing) : cette réforme permet la saisine du Conseil Constitutionnel par 60 députés ou 60 sénateurs (donc ouvert à l’opposition) ce qui permet un meilleur contrôle de la constitutionnalité de la loi. Ce qui constitue une évolution du légicentrisme vers le constitutionnalisme. Le Conseil Constitutionnel joue alors un rôle dans l’élaboration de la loi. Depuis 2008 : La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 introduit la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : elle permet un contrôle par exception : entrée en vigueur par une loi organique du 1er mars 2010, cette réforme a déjà donné lieu à des décisions, notamment celle du 30 juillet 2010, concernant la garde à vue. Le nouvel article 61-1 : « lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Une loi organique va préciser les conditions de mise en œuvre de la QPC : - Si question nouvelle - Si caractère sérieux Si ces deux conditions sont remplies, le juge prononce un renvoi, si dans un délai de 3 mois, il ne s’est pas prononcé, la transmission au Conseil Constitutionnel est automatique. Si le Conseil Constitutionnel estime que la disposition est inconstitutionnelle, celle-ci est abrogée (contrairement à l’annulation qui est rétroactive, l’abrogation ne vaut que pour l’avenir). Critiques du contrôle de constitutionnalité : Le contrôle de constitutionnalité donne au juge un rôle de « co-auteur » (le juge aiguilleur) de la loi : il serait une sorte de 3e chambre (« Gouvernement des juges » ?), cela contredirait la souveraineté nationale incarnée par les élus du peuple. Nuancer cette critique : le contrôle de constitutionnalité aurait pour but de sanctionner une incompétence du législateur intervenu dans le domaine du pouvoir constituant (selon Hans Kelsen : le Conseil Constitutionnel a un rôle de « législateur négatif » : annuler l’incompétence du Législateur). uploads/S4/ le-controle-de-constitutionnalite.pdf
Documents similaires

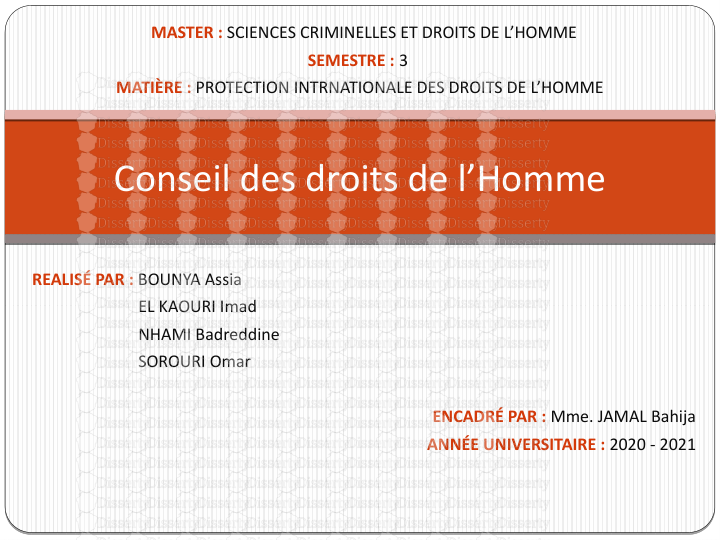








-
70
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 08, 2023
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1765MB


