LE DROIT D’ÊTRE LIBRE La collection Le Monde en soi est dirigée par Denis Lafay
LE DROIT D’ÊTRE LIBRE La collection Le Monde en soi est dirigée par Denis Lafay Dans la même collection : Laurent Berger, Au boulot ! Manifeste pour le travail Étienne Klein, Sauvons le Progrès Yves Michaud, Aux armes, citoyens ! Edgar Morin, Le temps est venu de changer de civilisation, illustrations de Pascal Lemaître Alain Touraine, Macron par Touraine Jean Ziegler, Les murs les plus puissants tombent par leurs fissures © Éditions de l’Aube, 2018 www.editionsdelaube.com ISBN 978-2-8159-2911-0 Éric Dupond-Moretti Le droit d’être libre Dialogue avec Denis Lafay éditions de l’aube DU MÊME AUTEUR Avec Stéphane Durand-Souffland, Bête noire, Michel Lafon, 2012 Avec Loïc Sécher, Le Calvaire et le Pardon, Michel Lafon, 2013 Avec Stéphane Durand-Souffland, Directs du droit, Michel Lafon, 2017 Avec Laurence Monsénégo, Le Dictionnaire de ma vie, Kero, 2018 À Maître Camille Giudicelli, avocate et résistante qui sait ce qu’est le vrai courage. Le bon et la canaille Ce lundi de printemps, nous achevons la série d’entretiens, initiée deux mois plus tôt, à partir de laquelle ce livre verra le jour. Nous dînons près de son bureau, à… L’Évasion (!), chez l’un de ses amis corses. Au menu, une salade de poulpes justement assaisonnée, puis une fondante pièce de bœuf. Nous prenons place à « sa » table, située sous un discret vasistas, Éric allume sa première cigarette. Les vociférations de l’impétrant touriste nullement gêné par l’odeur, mais offusqué par l’anormalité ou simplement la liberté du geste, sont vite réprimées par l’hôte. Une première bouteille, celle du domaine roussillonais Saint Thomas dont mon convive partage des allocations, est rapidement consommée. Suivent d’autres flacons, proposés par un restaurateur heureux de les faire découvrir et de les soumettre à deux palais avisés. Éric et moi devisons d’une passion commune : la belle chanson française. Celle de Ferrat, de Brel – Éric n’est-il pas infiniment « brélien », n’aurait-il pas pu composer Jef, Jojo, Fernand ? –, de Barbara, de Ferré, de Brassens, d’Escudero. Celle aussi de Reggiani, dont sa compagne Isabelle Boulay a revisité une quinzaine de titres. Je lui avoue ma circonspection. L’interprète de Ma fille, de L’Absence, du Petit garçon, de Quelles Amériques, celui que je suis allé admirer sur différentes scènes et dans des conditions de chant lors desquelles la fragilité, la souffrance, le déclin, irradiaient plus encore l’intensité des textes et l’émotion des spectateurs, pouvait-il échapper à l’éreintement, même à la trahison ? Je promets à Éric d’écouter et de lui dire. Sur le chemin du retour, pendant l’heure qui d’un pas lent me mène de la place des Augustins à la rue de Verneuil, dans ce Paris désormais assoupi et silencieux, je me connecte sur l’album. Je le concède : la voix, tout en retenue, de l’avenante Québécoise respecte les mots et leur musicalité, mais aussi sanctuarise la mémoire de l’interprète originel, elle honore ces mots, car elle ne les corrompt d’aucun excès ni artifice, elle ne les dénature pas de l’anecdote et du spectaculaire si communs chez les artistes qui osent la « revisitation », elle semble même avoir commandé le sens des textes aux Rivière, Dabadie et autres Moustaki qui en sont les auteurs. Éric m’avait confié « pleurer » à la voix qu’elle pose sur Si tu me payes un verre. Je me promets d’y être encore plus attentif qu’aux autres chansons, pour espérer saisir un peu plus de cette âme a priori assez limpide, en réalité d’une immense complexité, cette âme formée d’un entrelacs de convictions, de certitudes, de paradoxes, de doutes, de fois, difficilement déchiffrable, cette âme que nervurent des méandres autant abîmés que nimbés par l’accumulation de combats. Des combats dans et autour des prétoires d’assises, des combats de « vies » personnelle et professionnelle – et notamment des combats professionnels pour exorciser des combats personnels –, des combats pour les autres et pour lui-même, des combats face aux autres et face à lui-même. Des combats qui consument mais qui font la justification d’être vivant. Alors j’écoute Si tu me payes un verre. Dix fois, cent fois, parce que l’émotion qu’exhale la voix de la chanteuse dépasse même celle qu’on croyait réservée au seul timbre et au seul vécu de Serge Reggiani. Mais un seul passage aurait suffi pour comprendre ce que la chanson déclenche dans le corps d’Éric, dans le corps de l’homme et de l’avocat Dupond-Moretti, dans le corps de celui qu’ont tour à tour mutilé, réparé, enfiévré, enivré, restauré, tuméfié, exalté, démembré, tant de luttes et tant de plaidoiries. Si tu me payes un verre, je te ne demanderai pas 0ù tu vas, d’où tu viens, si tu sors de cabane […] Si tu traînes tout seul avec un cœur en panne, Je ne te dirai rien je te contemplerai […] Nous viderons nos verres et je repartirai Avec un peu de toi pour meubler mon silence Si tu me payes un verre, tu pourras si tu veux Me raconter ta vie, en faire une épopée En faire un opéra, j’entrerai dans ton jeu Je saurai sans effort me mettre à ta portée […] Si tu me payes un verre […] Je te regarderai comme on regarde un frère Un peu comme le Christ à son dernier repas Comme lui je dirai deux vérités premières Il faut savoir s’aimer malgré la gueule qu’on a Et ne jamais juger le bon ni la canaille Si tu me payes un verre, je ne t’en voudrai pas De n’être rien du tout, je ne suis rien qui vaille1 « Ne jamais juger le bon ni la canaille » : Éric sait qu’il est lui-même bon et canaille, il sait que tout individu est à la fois bon et canaille, il sait qu’en chaque accusé coexistent le bon et la canaille, il sait les facteurs exogènes stimulant la part de canaille, il sait que le bon n’est pas toujours le meilleur, ni la canaille, le pire, il sait que l’avocat a pour devoir de révéler ou d’exhumer la part de bon qu’a pu éteindre la part de canaille et que veut enterrer l’opinion publique ; voilà pourquoi dans cette exhortation à « ne jamais juger le bon ni la canaille » est concentré le sens dont il pave son existence, le sens qu’irrigue sa vocation. L’homme et l’avocat font certes naturellement congruence, et la schizophrénie n’est que fantasme. Parfois néanmoins ils se contrarient, parfois aussi ils se dissocient, parfois sans doute ils s’écharpent. Peut-être même, tel un schisme, leur est-il arrivé de se détester, de divorcer, d’entrer l’un et l’autre en dissidence le temps d’un débat intérieur incandescent. Ils ne sont pas indestructiblement indivisibles, et c’est évidemment dans l’infini nuancier des écartèlements et des interrogations, des renoncements et des esquives, des déconvenues et des répliques que s’écrivent les « leçons » de ce double parcours d’avocat et d’homme. Éric s’en défend, et d’ailleurs son irréductible concentration sur le travail de la preuve contre la pollution morale, contre les scories des institutions judiciaire et médiatique, contre l’inquisition de l’opinion publique, pourrait l’attester. Pour autant, ce qui est éthique dans sa construction d’homme ne peut pas être totalement imperméable, ne peut pas être intégralement étanche avec la nature des dossiers qu’il accepte, avec l’identité de ceux qu’il défend, avec l’objet des accusations examinées ou des crimes perpétrés, avec le « tremblement de terre » que certains actes poursuivis provoquent sur le collectif formant la société. Ce qu’entreprend l’avocat permet de mieux « lire » l’homme, de mieux cerner l’intimité d’un colosse qu’au fil du temps les épreuves ont lézardé, et les joutes, crevassé, de mieux déchiffrer ce visage tendu que les combats et des fantômes ont ridé, raviné, cabossé, mais qui brusquement peut laisser place à un large sourire – annonciateur d’une générosité copieuse, tripale –, de mieux approcher les émotions, tour à tour extatiques et funèbres, qu’a sédimentées l’accumulation des procès gagnés et des procès perdus, de ces procès qui « disent » beaucoup de l’état de la société. De l’état du monde. De l’état de l’« humanité des hommes ». Et c’est essentiellement à « donner » à mieux comprendre ce monde et cette humanité des hommes, à « donner » au lecteur raison et matière de questionner ce qu’il est, d’investiguer ce qu’il pense, de convoquer ce qu’il exige, d’explorer ce qu’il croit, que s’emploie ce dialogue. Car effectivement, la manière dont Éric examine l’exercice de son métier et ausculte l’interprétation sociale, sociétale, voire civilisationnelle, de certains procès, plus encore de certaines histoires humaines, livre beaucoup, énormément même, sur ce que nous sommes. Mais aussi ne sommes plus, ou devrions être. En premier lieu dans le rapport à la liberté qu’établissent aujourd’hui l’individu et la collectivité. En octobre 2017 se tenait le procès d’Abdelkader Merah, à la cour d’assises de Paris. Le frère de Mohamed Merah y fut condamné pour « association de malfaiteurs terroriste » et acquitté du chef de « complicité d’assassinat ». La défense la plus âpre, la plus brûlante, la plus dévorante, confie Éric, frappé à l’issue du verdict d’une déflagration intérieure, d’une descente uploads/S4/ le-droit-d-x27-etre-libre-eric-dupont.pdf
Documents similaires








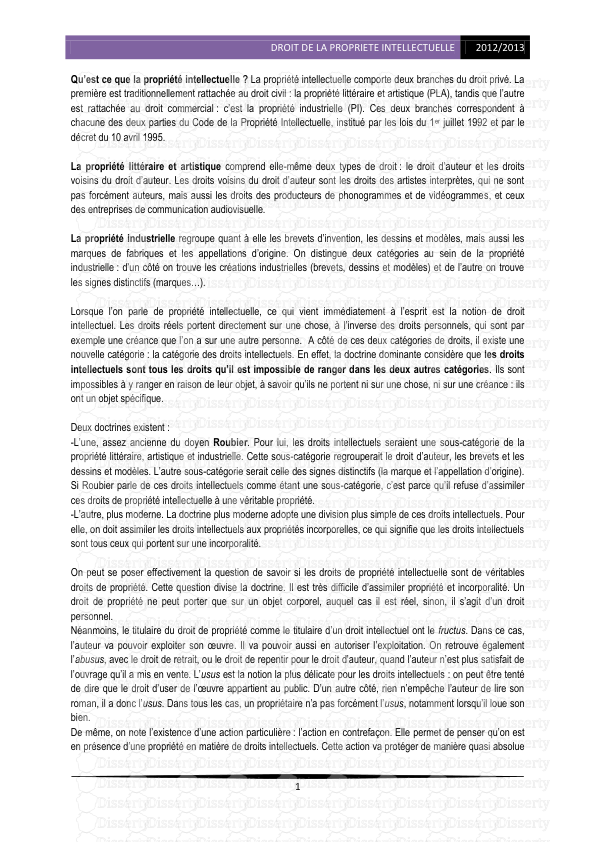

-
102
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 03, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.7629MB


