Master Droit Des Affaires FSJES MOHAMADIA Master Droit Des Affaires FSJES MOHAM
Master Droit Des Affaires FSJES MOHAMADIA Master Droit Des Affaires FSJES MOHAMADIA Exposé sous le thème Réalisé par encadré par M. Mehdi MOUINIR ADIB karima AKDIM Najat CHAHOUANI Abderrahmane EL OUARDI Abdessamad EL BAQALI Malak KOUYASSE Doha LAHMIDI IDRISSI Sofia SAFI Nabil YANIQ Outhman LE DROIT DES CONTRATS SOUS L’INFLUENCE DU LE DROIT DES CONTRATS SOUS L’INFLUENCE DU DROIT ECONOMIQUE DROIT ECONOMIQUE. SOMMAIRE INTRODUCTION : PREMIERE PARTIE : LA RELATION DU CONTRAT AVEC LES CONDITIONS ECONOMIQUES. Chapitre I : L’intervention de l’Etat pour diriger l’économie. Chapitre II : l'intervention de l'Etat pour diriger le contrat. DEUXIEME PARTIE : LE SORT DU CONTRAT EN RAISON DES CONDITIONS ECONOMIQUES. Chapitre I : le contrat : entre stabilité et l’impact économique. Chapitre II : l'effondrement du contrat et son déclin face aux conditions économiques. CONCLUSION. INTRODUCTION : Il n’est pas utile en effet d’épiloguer longuement sur l’importance et la signification économique du droit des contrats. Les principaux généraux de ce droit sont (l’autonomie de la volonté le principe de la convention et le consensualisme) sont autant d’instrument au service de la liberté contractuelle. L’économie mondiale reste marquée par les changements de nombreuses politiques. Il est nécessaire avant tout de rappeler les principes qui gouvernent le droit des contrats. L’article 230 du DOC : « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites » qui souligne l’obligation à chaque partie à un contrat de respecter des engagements et pour les tiers, notamment le juge de ne pas s’ingérer dans les affaires d’autrui. L’article 19 prévoit également « la convention n’est parfaite que par l’accord des parties sur les éléments essentiels de l’obligation, ainsi que toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles ». Néanmoins, l’article 269 du DOC prévoit une exception à ce principe le cas de force majeure. Le texte pose en effet qu’il y à force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement réuni trois conditions cumulatives : un évènement imprévisible, irrésistible, et un évènement extérieur. Dans le passé le juge ne pouvait s’ingérer dans les relations contractuelles entre les parties, actuellement le juge est de plus en plus appelé à intervenir dans le contrat. Il peut l’adapter en cas de changements de circonstances économiques. Plus qu’un lien juridique, le contrat est un facteur d’échange économique. L’influence de l’économie du contrat se fait sentir dans les conséquences des modifications que subit le contrat au cours de son exécution. Il convient de se demander si face au bouleversement économique, la force exécutoire du contrat est absolue et qu’il est la place du juge face à l’influence qui résulte de l’économie du contrat ? Afin de répondre à notre question nous proposerons le plan suivant : PREMIERE PARTIE : LA RELATION DU CONTRAT AVEC LES CONDITIONS ECONOMIQUES. Chapitre I : L’intervention de l’Etat pour diriger l’économie. Chapitre II : l'intervention de l'Etat pour diriger le contrat. DEUXIEME PARTIE : LE SORT DU CONTRAT EN RAISON DES CONDITIONS ECONOMIQUES. Chapitre I : le contrat : entre stabilité et l’impact de l’économique. Chapitre II : l'effondrement du contrat et son déclin face aux conditions économiques. CONCLUSION. PREMIERE PARTIE : LA RELATION DU PREMIERE PARTIE : LA RELATION DU CONTRAT AVEC LES CONDITIONS CONTRAT AVEC LES CONDITIONS ECONOMIQUES ECONOMIQUES CHAPITRE I : L’INTERVENTION DE L’ETAT POUR DIRIGER L’ECONOMIE. Lorsque l’État intervient régulièrement dans un grand nombre de domaines de l’activité économique et sociale, on parle d’interventionnisme étatique. L’interventionnisme est né des échecs constatés du libéralisme : inflation, chômage, inégalités sociales… Toutefois, selon l’époque ou le lieu, cet interventionnisme varie grandement. A. L’État : entre libéralisme et interventionnisme a. Le concept d’État libéral Le libéralisme est une doctrine économique qui considère que la régulation par le marché est la meilleure modalité de gestion de l’économie. Il repose sur les fondements suivants : la propriété privée des moyens de production ; l’initiative individuelle comme moteur de l’activité économique ; le libre jeu de la concurrence. À l'échelle internationale, il préconise le libre-échange. Pour les libéraux, l’État doit se limiter à ses fonctions régaliennes : la justice, la police et la défense nationale, soit un rôle d’État gendarme. Toute ingérence (intervention) de l’État dans les affaires privées doit être refusée car elle risque de perturber le libre jeu du marché et donc de créer des situations de crise. En outre, le libéralisme n’a pas permis d’éviter les crises économiques. Cela a donné naissance à une autre vision de l’État, sous l’impulsion de l’économiste J.-M. Keynes ; l’État devient garant de l’intérêt général et se donne pour objectif de mettre la population à l’abri du besoin et du risque. Il devient un État- providence. b. Le concept d’État-providence La différence entre l’État gendarme et l’État-providence tient essentiellement à l’ampleur des domaines d’intervention. L’État-providence a un rôle plus étendu : police, justice, sécurité mais aussi protection sociale, interventions économiques (stabilité des prix, équilibre du commerce extérieur, croissance) et sociales (emploi, redistribution). Il intervient directement par le biais de la politique de dépenses publiques et indirectement par ses politiques monétaires et fiscales sur les fonctions de consommation et d’investissement dans le but de soutenir ou relancer l’activité économique. Globalement, l’intervention économique et sociale de l’État-providence peut se résumer autour de trois fonctions : la fonction d’allocation : elle consiste à affecter les ressources budgétaires (recettes fiscales et non fiscales) à des dépenses d’ordre collectif, en faveur des entreprises ou de l’aménagement du territoire la fonction de redistribution : elle consiste à prélever de façon obligatoire (impôts et cotisations sociales) une partie des revenus primaires (revenus perçus en contrepartie d’une contribution à la production) pour les redistribuer sous forme de revenus de transferts (allocations familiales, RMI…) aux agents qui en ont besoin. Cette redistribution permet de réduire les inégalités (politique de solidarité) et d’accroître la consommation. la fonction de stabilisation ou de régulation : l’État a ici pour mission de permettre une croissance économique équilibrée en favorisant le plein emploi des facteurs de production (travail, capital). B. Les facteurs explicatifs de cette implication plus ou moins forte de l’État a. Les causes de la croissance du rôle de l’État Plusieurs raisons ont amené les pouvoirs publics à être plus interventionnistes dans l’économie : Les crises économiques (crise de 1929) ont rendu nécessaire l’intervention de l’État afin d’aider les chômeurs, de stimuler une économie en difficulté (grands programmes de travaux publics, renflouement d’entreprises en faillite par des fonds publics…) ; Les deux guerres mondiales ont conduit tous les gouvernements à prendre en main l’économie en réquisitionnant tous les moyens humains et matériels et en les orientant « autoritairement » vers certains secteurs afin de reconstruire les pays pour préserver les droits élémentaires des citoyens, l’État est intervenu dans les domaines de la santé de l’éducation des conditions de travail l’État s’est substitué à l’initiative privée pour la réalisation d’investissements coûteux et non rentables à court terme. C. L’action de l’État dans le cadre de la politique économique a. La nécessité d’une politique économique Aujourd’hui, le simple jeu du marché ne suffit plus à rétablir les équilibres fondamentaux des économies capitalistes, en raison notamment de la mondialisation des échanges et de l’interdépendance des économies. C’est pourquoi l’intervention de l’État devient nécessaire : on parle de régulation étatique. Cette régulation étatique (plus ou moins importante suivant l’orientation politique des États ou les situations économiques : récession ou expansion) consiste en l’intervention de l’État pour soutenir ou rétablir les équilibres économiques et améliorer le bien-être social. L’État élabore pour cela une « politique économique ». b. Qu’est-ce que la politique économique ? La politique économique désigne l’ensemble des décisions prises par les pouvoirs publics afin d’atteindre certains objectifs (relance de l’économie, diminution de chômage, stabilité des prix…) grâce à l’utilisation de divers instruments. Ces mesures doivent être cohérentes et coordonnées entre elles ; il est donc nécessaire qu’une seule et même autorité en décide : c’est le gouvernement qui est chargé d’établir les objectifs et les moyens de la politique économique. CHAPITRE 2 : L’INTERVENTION DE L’ETAT POUR DIRIGER LE CONTRAT Selon la théorie générale du contrat, un engagement accepté par des contractants consentants est intangible. Le législateur fait de la volonté une source créatrice d’obligations. Il prend des mesures pour protéger la liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat. Cette vision idéalisée du principe de l’autonomie de la volonté n’est cependant plus adaptée à la réalité économique qui évolue rapidement1. En fait, Dans ses rapports avec ses partenaires économiques, l'entreprise disposant d'un pouvoir économique tente fréquemment à utiliser sa supériorité de fait pour maximiser ses bénéfices, notamment par le développement de plusieurs techniques susceptibles d'inciter ses partenaires à passer des contrats comme elle peut exploiter sa domination pour imposer des clauses contractuelles excessivement déséquilibrées en sa faveur 2. Face à cette situation, une intervention de l’Etat semble nécessaire pour faire face à ce déséquilibre contractuel et ainsi protéger la partie la plus faible. Ainsi le législateur marocain a édicté un ensemble de règles pour régir les relations juridiques des cocontractants uploads/S4/ le-droit-des-contrats-sous-l-x27-influence-de-droit-economique-pdf.pdf
Documents similaires

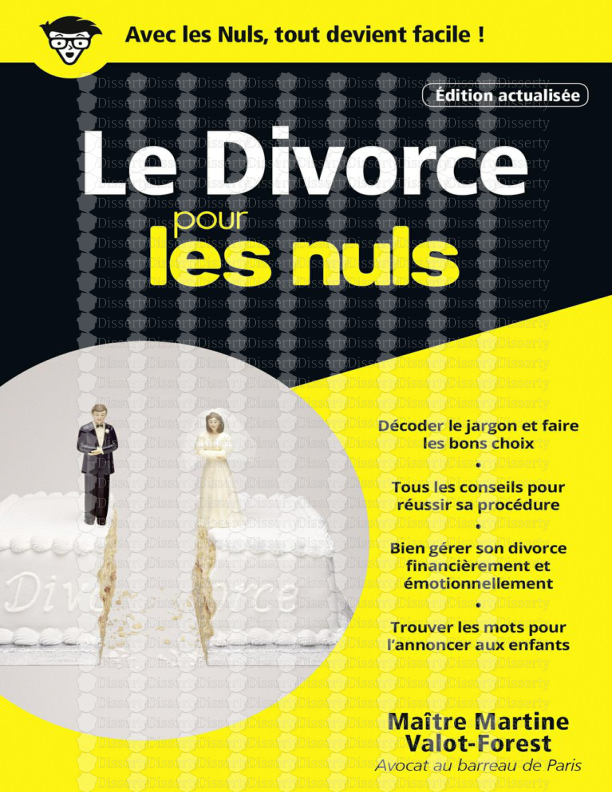








-
64
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 04, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.1964MB


