QUE SAIS-JE ? Histoire constitutionnelle de la France PIERRE BODINEAU Professeu
QUE SAIS-JE ? Histoire constitutionnelle de la France PIERRE BODINEAU Professeur des Universités (Université de Bourgogne) Enseignant à Sciences-Po MICHEL VERPEAUX Professeur agrégé des facultés de droit (Université de Paris-1 - Panthéon Sorbonne) Enseignant à Sciences-Po 10e mille Introduction lusieurs raisons légitiment l’intérêt qu’il peut y avoir à examiner l’histoire constitutionnelle française. La connaissance de l’histoire est nécessaire pour comprendre la société juridique actuelle, non seulement en droit public mais aussi en droit privé. Le droit de propriété, la place et le rôle du juge, la hiérarchie des normes ou les rapports entre traité et loi sont en effet hérités de principes fixés dans notre histoire. Il s’agit seulement de retracer ici les grandes lignes d’une évolution et les lignes de force, de montrer les constantes et les ruptures. Il ne peut être question d’étudier le détail de chacune des constitutions mais de les replacer dans leur contexte. Chaque régime politique réagit par rapport à son ou ses prédécesseurs, et le système constitutionnel actuel est le résultat de cette évolution et de cette somme de « réactions », à la fois positives par l’acceptation du passé ou l’héritage et négatives par le rejet, la modification ou l’amélioration. Pour ne citer qu’un seul exemple, le Conseil constitutionnel de 1958 a cherché à tirer les leçons des insuffisances du comité constitutionnel prévu par la Constitution de 1946. S’il faut montrer les évolutions, il est nécessaire aussi de respecter la chronologie depuis la fin de l’Ancien Régime jusqu’au 4 octobre 1958. La question du point de départ se pose tout d’abord. S’il y avait bien une société politique sous l’Ancien Régime, et s’il existait peut-être une constitution coutumière avec les lois fondamentales du royaume, il n’y avait pas de droit constitutionnel conçu comme l’ensemble des règles de droit régissant les rapports entre les gouvernés et le pouvoir. Les règles coutumières concernaient l’État et les titulaires du pouvoir, mais en rien les sujets. Il n’est pas certain qu’il y ait eu une réelle limitation du pouvoir par le droit, mais des règles relatives à l’exercice à la transmission du pouvoir. En outre, c’est sous la Révolution que sont nés les principes constitutionnels actuellement applicables tels que la séparation des pouvoirs, le principe d’une déclaration des droits, la primauté de la Constitution. De cette époque datent aussi les P réflexions sur la souveraineté et le suffrage et beaucoup de règles techniques, notamment celles intéressant le droit parlementaire. La France est un pays « consommateur de constitutions », selon l’expression de D. Turpin, à la différence des pays anglo-saxons. Il existe cependant une incertitude sur le nombre de constitutions : de 1789 à 1958 compris, il y aurait eu 14 constitutions (trois sous la Révolution, trois sous le Consulat et l’Empire, deux chartes plus la Constitution de 1815 dite des Cent-Jours, les Constitutions de 1848, 1852 et 1875, de 1946 et 1958). Mais ce chiffre prend en compte des constitutions non appliquées, comme celle de 1793, ou fort peu appliquées (1815) ou des simples modifications de la Constitution initiale (1802 et 1804). Ce chiffre ne comprend pas les périodes en dehors de toute constitution comme le gouvernement révolutionnaire en 1793-1794 ou les gouvernements provisoires de 1848 et 1870 ni les changements coutumiers à l’intérieur de l’application d’un même texte tels que la modification en faveur d’un empire libéral à partir de 1860 ou la « Constitution Grévy » à partir de 1879. Une telle instabilité peut apparaître choquante, notamment par rapport aux États-Unis qui n’ont connu qu’une seule Constitution, d’autant que presque tous les changements de texte constitutionnel se sont faits de manière non pacifique et sans respecter les formes prévues par les textes antérieurs ou en modifiant pour la circonstance le procédé de révision pour permettre une modification totale, comme en 1958 par exemple. Mais cette instabilité est peut-être plus apparente que réelle : les hommes ont pu rester en place si les institutions ont changé. Des personnages comme Sieyès ou Thiers ont pu ainsi marquer de longues périodes. En outre, des institutions politiques ou administratives ont pu survivre aux tempêtes, comme le Conseil d’État, les grandes administrations et les administrations locales, à l’image des préfets. Il est fréquent de souligner la longue continuité administrative derrière l’apparente discontinuité constitutionnelle. Envisager de traiter de l’histoire constitutionnelle de la France nécessite aussi de déterminer le point d’arrivée. La mise en place des institutions de la Ve République a été choisie, parce que le régime né en 1958 continue de vivre sous nos yeux et qu’il est impossible de le regarder avec le recul de l’histoire. Compte tenu de la diversité des textes constitutionnels français, les auteurs proposent des coupures chronologiques variées : si P. Ardant considère que 1789 et 1875 constituent deux dates charnières, parce que 1875 voit la mise en place d’éléments de la tradition constitutionnelle et que s’ouvre une expérience parlementaire, G. Burdeau, F. Hamon et M. Troper distinguent quatre phases autour de l’idéal démocratique : 1789-1814, 1814-1848, 1848- 1870, 1870-1940, tandis que 1946 appartient, pour ces auteurs, au domaine des réalités présentes. P. Pactet met à part les IIIe-IVe Républiques parce qu’elles expliquent directement la Ve République, et distingue ainsi 1789- 1870 et l’après-1870 jusqu’en 1958. C’est aussi le cas de D. Turpin qui sépare les expériences (1789-1870) et la tradition républicaine (1870-1958). J. Gicquel, fidèle à M. Hauriou, cherche à voir des cycles qui se répètent dans l’histoire constitutionnelle, entre 1789 et 1848, d’une part, et entre 1848 et 1958, d’autre part : tour à tour se succèdent la primauté de l’Assemblée, la réaction du pouvoir exécutif et la collaboration des pouvoirs par un équilibre, ce qui explique la longévité des régimes, à la fois des chartes et de la IIIe République. Toutes ces tentatives apparaissent parfois comme des reconstructions et des justifications a posteriori qui cherchent le sens caché d’une évolution qui serait ainsi parfaitement cohérente. Il existe certes une évolution, mais il est difficile de lui trouver un sens ou une logique. La France a cherché un régime de séparation des pouvoirs qui est passé par toutes les couleurs de la palette, depuis le régime d’assemblée jusqu’au présidentialisme le plus dictatorial. On constate aussi un mouvement vers la démocratie et le suffrage universel, comme dans d’autres pays et parce qu’il correspond à l’évolution des sociétés. Il y a enfin l’enracinement – fragile – de l’État de droit et la constitution d’une hiérarchie des normes qui connaît aussi des bouleversements, sous l’influence du droit comparé et de la construction européenne. Mais peut-on soutenir raisonnablement que tout était écrit au préalable ? Comment faut-il alors classer les différentes périodes ? Il est nécessaire d’aller au plus près des réalités politiques et juridiques et de distinguer quatre phases principales en n’oubliant jamais le caractère artificiel de telles coupures. « Les révolutions constitutionnelles » de 1789 à 1799 correspondent aux trois régimes qui se succèdent et ont en commun les idéaux du départ mais cherchent à les traduire différemment. « Le retour à l’ordre » de 1799 à 1815 marque à la fois la fin et la consolidation de la Révolution. Il s’agit d’un régime dominé par le pouvoir d’un individu et la confiscation des autres pouvoirs. Mais en même temps, certains des principes juridiques de la Révolution sont installés en matière d’administration et de codification. Par certains côtés, cette période peut se rattacher à la précédente. « La difficile émergence du régime parlementaire » de 1814 à 1870 recherche un gouvernement équilibré entre les différents pouvoirs. Cette période est marquée par les hésitations autour de la démocratie et de la forme du gouvernement, monarchie, république ou empire. L’Histoire est heurtée, avec des retours en arrière, la volonté de retrouver le passé et d’imiter les grands ancêtres. Mais ces « cycles » sont volontaires et conscients et n’ont rien de naturel. « La démocratie parlementaire » consacre l’association du régime parlementaire et de la démocratie entre 1870 (ou 1875) et 1958. Une grande unité caractérise cette période, malgré la coupure des gouvernements de fait, lors de la Seconde Guerre mondiale, marquée par la stabilité de la Ve République. Chapitre I Les révolutions constitutionnelles : 1789-1799 out n’a pas commencé en 1789 : quelques mots sur l’Ancien Régime sont nécessaires pour comprendre l’histoire constitutionnelle française, même si 1789 marque le début du constitutionnalisme. Le régime politique est organisé autour du pouvoir royal qui a connu une stabilité de dix siècles. Le roi est héréditaire et absolu, mais ces caractères sont en réalité apparus bien tard : l’hérédité est acquise au début du xiiie, après l’élection. La féodalité va retarder l’évolution vers l’absolutisme : tout le mérite de la monarchie capétienne sera de se servir des institutions féodales pour asseoir l’autorité royale, en se comportant comme le suzerain des suzerains. C’est au xive siècle que les légistes du roi vont développer l’idée de souveraine-té, pouvoir inconditionnel et absolu. Le peuple va se rapprocher du roi pour échapper à l’emprise des seigneurs plus proches et donc plus haïs. En cela, la monarchie anglaise se distingue de la monarchie uploads/S4/ histoire-constitutionnelle-de-la-france.pdf
Documents similaires

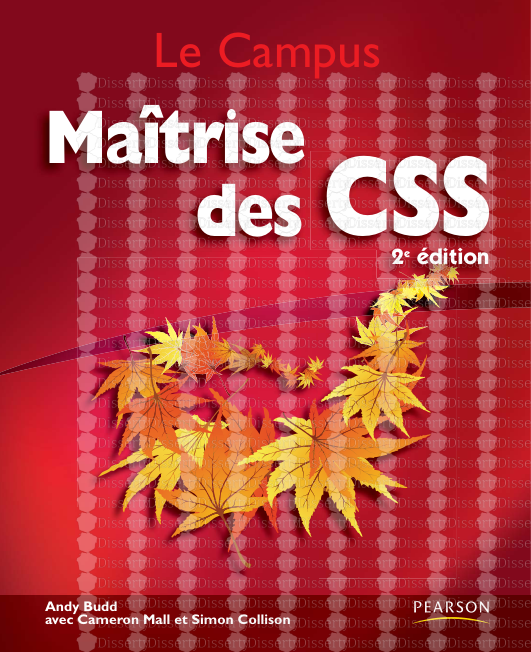








-
51
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 19, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.5618MB


