Paul Valéry : [exposition, Paris, Bibliothèque nationale, 31 janvier-31 mars] 1
Paul Valéry : [exposition, Paris, Bibliothèque nationale, 31 janvier-31 mars] 1956 / [catalogue réd. par Marcel Thomas] [...] Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Thomas, Marcel (1917-....),Bibliothèque nationale (France). Paul Valéry : [exposition, Paris, Bibliothèque nationale, 31 janvier-31 mars] 1956 / [catalogue réd. par Marcel Thomas] ; [préf. de Julien Cain]. 1956. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. BIBLIOTHÈQVE NATIONALE PAUL VALÉRY Paul Valéry dans son cabinet de travail (N° 592). PAUL VALÉRY BIBLIOTHÈQVE NATIONALE PAUL VALERY PARIS 1956 Sauf indication contraire, les pièces mentionnées au catalogue appartiennent à Madame Paul Valéry. La reproduction, totale ou partielle, des documents inédits présentés dans cette exposition est interdite sous quelque forme que ce soit. PRÉFACE Paul Valéry était entré de son vivant dans l'histoire littéraire. Rien d'étonnant donc si, dix années après sa mort, la Bibliothèque Nationale organise en son honneur une exposition comparable à celles qu'elle a consacrées au cours de ces dernières années aux plus grands parmi les écrivains français : sur son oeuvre ne s'est pas étendue cette zone d'ombre qui a suivi si souvent leur mort. Tout au contraire, il est possible de dire qu'avec le recul du temps on a mesuré davantage tout ce que Valéry apporta, non seulement à la Poésie, mais, dans ses domaines divers, à l'esprit. Ses oeuvres complètes ont été publiées de son vivant, mais la part de l'inédit demeure considérable, et cette exposition va la faire apparaître. On savait que, pendant toute sa vie, Valéry avait chaque jour poursuivi, dans les solitudes de l'aube, une méditation et que, dans cette « île intérieure » qu'il s'était faite, il n'avait cessé d'écrire sur les sujets les plus variés. On savait qu'il avait déjà tiré de ses notes des recueils comme Analecta, le Carnet B ou Chosestues, mais on ne devinait pas qu'elles pussent former une telle masse, et d'abord un monument de deux cent cinquante quatre cahiers. La publication qui s'en prépare sous la forme d'une édition photographique apportera à la connaissance de Paul Valéry des éléments nouveaux d'une valeur inestimable. On ne peut les comparer qu'aux manuscrits de Léonard de Vinci que, dès sa vingtième année, avant même d'écrire en 1895 sa célèbre Introduction, Paul Valéry interrogeait dans les fac-similés qu'en avait donnés Ravaisson-Mollien. Et c'est pourquoi il devait si bien les décrire, quarante ans plus tard, songeant certainement à l'oeuvre qu'il avait lui-même édifiée. « Ces cahiers de Léonard n'étaient absolument que pour lui seul, — son laboratoire de secrètes recherches. Il n'y consigne guère que ce qui lui puisse servir au développement de ses moyens... C'est un désordre habituel, et comme organique chez lui, de préceptes, de formules, de figures et de croquis, de recommandations à soi-même, de projets toujours repris. » VI PREFACE Il est significatif que le Centre national de la recherche scientifique ait accepté de se charger de cette immense entreprise. Il ne l'est pas moins que ce soit un grand savant, M. Louis de Broglie, qui la présente. C'est qu'il a reconnu que Valéry « a laissé une trace ineffaçable dans l'atmosphère intellectuelle de notre temps » et qu'il juge que les Cahiers ajouteront encore au « glorieux rayonnement » de son oeuvre. La variété même des problèmes que Valéry s'est posés apparaîtra dans cette publication lorsqu'on pourra établir exactement les grandes divisions dans lesquelles il se proposait de classer ses notes de travail. En disant pour un long temps adieu à la Poésie, après avoir pendant trois ou quatre années ajouté au dernier éclat du Symbolisme, Valéry s'engagea dans la voie la plus difficile, celle de la spéculation pure, celle d'une solitude relative et du renoncement à toutes les facilités que son renom naissant pouvait lui apporter. Les documents sont rares pour cette période si importante, qui ne devait pas durer moins de vingt- cinq ans. Il est possible cependant, grâce à l'abondance même des notes et des Cahiers, de rendre clair cet effort, au terme duquel devait appa- raître, tout armé, le poète de la Jeune Parque. Dès lors, et pendant toutes les années qui vont suivre, il établira son oeuvre en pleine lumière et les publications vont se succéder. Mais c'est bien artificiellement qu'on maintiendrait une séparation entre l'une et l'autre période ; dans beau- coup d'écrits qui vont voir le jour, on pourra discerner des références, toujours fragmentaires, à ce passé connu seulement de quelques-uns. L'idée même d'écrire une autobiographie lui était étrangère et lui eût paru insupportable, mais il ne s'est pas interdit, comme il le fit maintes fois au sujet de Mallarmé ou de Monsieur Teste, d'évoquer ses pre- mières années parisiennes ; lui-même, si on le lit bien, nous fournit les clefs nécessaires. Il n'avait pas changé, une fois la gloire venue. Il conti- nuait d'affirmer que l'exercice de la littérature n'avait à ses yeux qu'une valeur très relative ; que l'essentiel fut toujours pour lui de travailler à la « formation de son esprit », et il pouvait déclarer à André Gide : « Les principaux thèmes autour desquels j'ai ordonné ma pensée depuis cinquante ans demeurent pour moi inébranlables. » Tout cela était malaisé à faire apparaître par des documents, et le principe même d'une exposition consacrée à une carrière, à une oeuvre comme celles-là, aurait pu être contesté, s'il n'avait lui-même justifié à l'avance notre dessein. C'est ici le lieu de rappeler la part que Valéry prit à l'organisation de l'Exposition internationale qui se tint à Paris en 1937. Il avait accepté la présidence du groupe, assez composite, consacré à ce qu'on appelait les « Manifestations de la pensée » ; je présidais moi-même la classe des Bibliothèques et des Manifestations littéraires, à laquelle Georges Charensol, Maurice Noël et Jean Fraysse PREFACE VII voulaient bien donner leurs soins, et c'est ainsi qu'avec divers écrivains et critiques il nous fut possible de présenter l'ébauche d'un Musée de la Littérature. Paul Valéry en avait dès l'abord accepté l'idée, et il voulut bien la préciser dans une importante préface qu'il donna à l'ouvrage qui résuma quelques mois plus tard ces réalisations. L'essentiel, pour lui, c'est de « faire apparaître ce qu'on peut apercevoir ou soupçonner de la création en deçà de ce qu'elle crée. » Mais quoi de plus abstrait que l'activité littéraire ? Que faire voir ? Exposer des livres est aisé. « Mais ce n'est point l'histoire du livre qui pouvait nous embarrasser. C'était, toute mystérieuse et irréductible à des idées claires et distinctes, ce que l'on peut nommer sa préhistoire : le travail intérieur dont l'ouvrage est le terme. C'est alors que nous avons songé à remonter au plus près de la pensée et à saisir sur la table de l'écrivain le document du premier acte de son effort intellectuel, et comme le graphique de ses impulsions, de ses variations, de ses reprises, en même temps que l'enregistrement immédiat de ses rythmes personnels, qui sont la forme de son régime d'énergie vivante : Le Manuscrit virginal, le lieu de son regard uploads/S4/ paul-valery-exposition-n5839347-pdf-1-1dm.pdf
Documents similaires






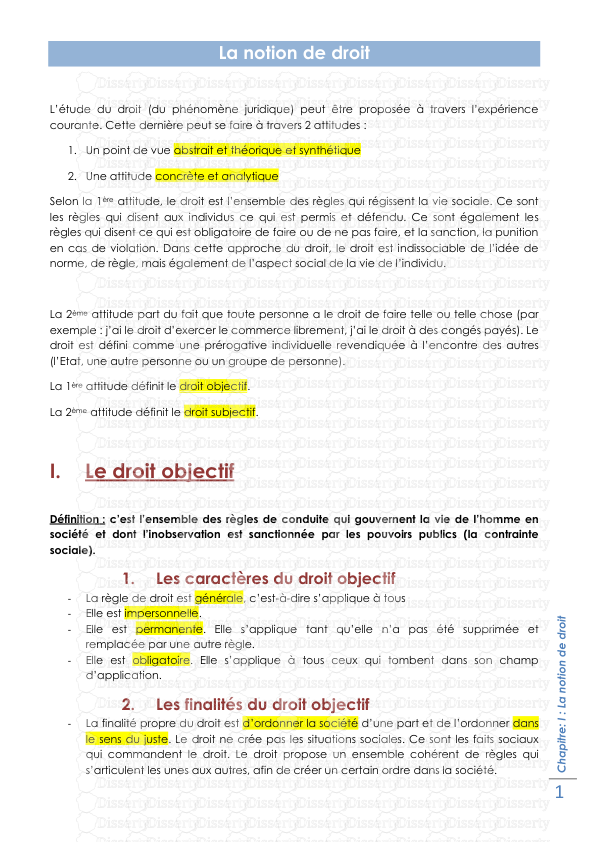



-
57
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 07, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 5.7721MB


