L'ÉTAT D'URGENCE, UN ÉTAT VIDE DE DROIT(S) Dominique Rousseau C.E.R.A.S | « Rev
L'ÉTAT D'URGENCE, UN ÉTAT VIDE DE DROIT(S) Dominique Rousseau C.E.R.A.S | « Revue Projet » 2006/2 n° 291 | pages 19 à 26 ISSN 0033-0884 DOI 10.3917/pro.291.0019 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.cairn.info/revue-projet-2006-2-page-19.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour C.E.R.A.S. © C.E.R.A.S. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) © C.E.R.A.S | Téléchargé le 20/07/2022 sur www.cairn.info (IP: 41.219.52.99) © C.E.R.A.S | Téléchargé le 20/07/2022 sur www.cairn.info (IP: 41.219.52.99) projet 291 – 2006, pp. 19-26, 4 rue de la Croix Faron 93217, La Plaine Saint-Denis Questions en débat Questions en débat—Banlieues en urgence 19 L’état d’urgence, un état vide de droit(s) D e quelque manière que l’on tourne les choses, l’état d’urgence, c’est la mise en suspension de l’État de droit : les principes constitutionnels qui le fondent et le distinguent et les méca- nismes et exigences du contrôle juridictionnel sont mis à l’écart. Si l’État de droit est, définition minimale, un équilibre entre respect des droits fondamentaux et sauvegarde de l’ordre public, l’état d’urgence, c’est le déséquilibre revendiqué au profit de la sauvegarde de l’ordre public. L’état d’urgence, c’est la violence pure de l’État qui entretient une rela- tion ambiguë avec le Droit : relève-t-il encore de l’espace du Droit puisque celui-ci le prévoit ou est-il situé hors de cet espace puisqu’il en anéantit la logique ? Pour se faire une opinion, il n’est pas inutile de citer quelques articles de la loi du 3 avril 1955. Art.5 : pouvoir donné au représentant de l’État dans le département « d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté, d’instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des L’état d’urgence, un état vide de droit(s) Dominique Rousseau Dominique Rousseau est professeur de droit à l’Université de Montpellier 1 et membre de l’Institut universitaire de France. Un droit d’exception, conçu pour faire face à un risque de séces- sion, deviendrait-il le droit commun pour gérer des conflits sociaux durs ? © C.E.R.A.S | Téléchargé le 20/07/2022 sur www.cairn.info (IP: 41.219.52.99) © C.E.R.A.S | Téléchargé le 20/07/2022 sur www.cairn.info (IP: 41.219.52.99) 20 personnes est réglementé, d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ». Art.6 : « le ministre de l’Intérieur peut prononcer l’assignation à résidence de toute per- sonne dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre public ». Art.8 : « le ministre de l’Intérieur ou le préfet peut ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, des débits de boisson et lieux de réunion de toute nature ». Art.12 : « un décret pris sur le rap- port du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Justice peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d’assises ». L’état d’urgence n’est donc pas une « chose » banale. Pour tenter de comprendre sa mise en œuvre en 2005-2006, nous nous poserons trois questions, car le texte s’explique aussi par son contexte. - D’où vient la loi du 3 avril 1955 ? Le 1er novembre 1954 débute l’insurrection algérienne. Le gouverne- ment de Pierre Mendès-France envoie Jacques Soustelle, animateur en 1936 du comité de vigilance des intellectuels antifascistes et gaulliste, pour conduire une politique « de mouvement » violemment critiquée par René Mayer, leader des députés d’Algérie ; le 5 février 1955, le gou- vernement est renversé. Edgar Faure devient président du Conseil et se donne pour programme la lutte contre la « rébellion en Algérie » par tous les moyens. Le 18 mars, son gouvernement adopte le projet de loi sur l’état d’urgence qui est voté par le Parlement le 3 avril 1955. Pourquoi voter ce texte alors que le gouvernement disposait de la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège, loi qui avait été appliquée en 1879, 1914 et 1939 ? Parce que l’état de siège ne peut être déclaré qu’en « cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrec- tion armée ». L’utiliser, c’eût été reconnaître que la France était en guerre avec l’Algérie ou que des départements français étaient en état d’insurrection. Or, pour la France qui cherche à éviter toute intrusion de l’Onu dans la gestion du dossier algérien, l’Algérie est une affaire interne et qui doit le rester, l’Algérie est un territoire français sur lequel se déroulent des « troubles », des « émeutes » mais pas une guerre. D’où © C.E.R.A.S | Téléchargé le 20/07/2022 sur www.cairn.info (IP: 41.219.52.99) © C.E.R.A.S | Téléchargé le 20/07/2022 sur www.cairn.info (IP: 41.219.52.99) Questions en débat—Banlieues en urgence 21 L’état d’urgence, un état vide de droit(s) la nécessité stratégique de voter une loi qui permet de suspendre le droit normal des libertés publiques sur une partie du territoire de la République sans provoquer d’ingérence extérieure. D’où cet article 1er de la loi du 3 avril 1955, légèrement décalé de celui de la loi sur l’état de siège, qui autorise la proclamation de l’état d’urgence « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Pour Edgar Faure, qui le reconnaîtra plus tard, aucune différence entre état de siège et état d’urgence, « la simple vérité étant que le terme état de siège évoque irrésistiblement la guerre et que toute allusion à la guerre devait être soigneusement évitée à propos des affaires d’Algérie ». Avec la loi du 3 avril 1955, la France dispose de trois régimes d’ex- ception. D’abord, celui de l’article 16 de la Constitution de 1958, per- mettant au Président de la République, en cas de menace grave et immédiate pour l’indépendance de la Nation ou l’intégrité du territoire et d’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de rassembler entre ses seules mains tous les pouvoirs, législatif, réglemen- taire et judiciaire aux fins de prendre « les mesures exigées par les cir- constances ». Cet article instaure donc ce qu’il est légitime d’appeler une dictature présidentielle où les contrôles parlementaire et juridic- tionnel sont réduits et dont la durée dépend de la volonté du Président : mis en œuvre en avril 1961 pour répondre au putsch des généraux d’Alger, il est maintenu jusqu’à la rentrée parlementaire d’oc- tobre 1961 alors que le putsch s’est effondré immédiatement. Celui de l’état de siège, prévu par la loi du 9 août 1849 : « en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée », il peut être décidé par le Président de la République pour une période de douze jours et prorogé au-delà par une loi ; il a pour effet principal de transférer aux autorités militaires les pouvoirs de police, d’accroître leur étendue et de soumettre les civils à la compétence des tribunaux militaires. Celui, enfin, de l’état d’urgence. Qui se distingue de l’état de siège seulement par le maintien des pouvoirs de police entre les mains des autorités civiles. Car, pour le reste, il est plus « grave » que l’état de siège. Du fait d’abord de ses conditions de mise en œuvre. Une « guerre © C.E.R.A.S | Téléchargé le 20/07/2022 sur www.cairn.info (IP: 41.219.52.99) © C.E.R.A.S | Téléchargé le 20/07/2022 sur www.cairn.info (IP: 41.219.52.99) 22 étrangère » ou une « insurrection armée » sont, en effet, des situations relativement aisées à circonscrire ; à la limite, des « événements présen- tant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » peuvent aussi renvoyer à des circonstances identifiables – tremblements de terre, explosion d’une centrale nucléaire,… Mais avec la formule « atteintes graves à l’ordre public », la clause appelant à l’état d’ur- gence devient fluide, inconsistante et ouvre la voie à son usage discré- tionnaire. Du fait ensuite de ses effets : atteintes aux libertés indivi- duelles – aller et venir, inviolabilité du domicile… –, aux libertés collectives – réunion, manifestation…–, aux libertés de l’esprit – presse, spectacles… Au total, parce qu’il est le plus facile à mettre en œuvre et qu’il pro- duit un espace vide de droit(s), l’état d’urgence est certainement le régime d’exception qui fait le plus directement violence à l’État de droit. - Quand l’état d’urgence a-t-il été appliqué ? Sans revenir sur son application en Algérie, il faut cependant préciser que l’état d’urgence a régné tout au uploads/S4/ pro-291-0019.pdf
Documents similaires
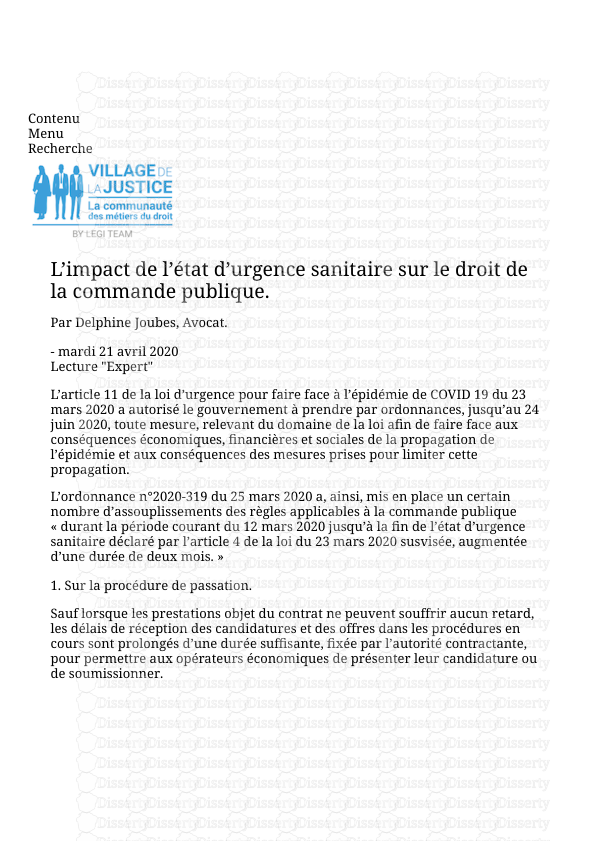









-
32
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 08, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.4561MB


