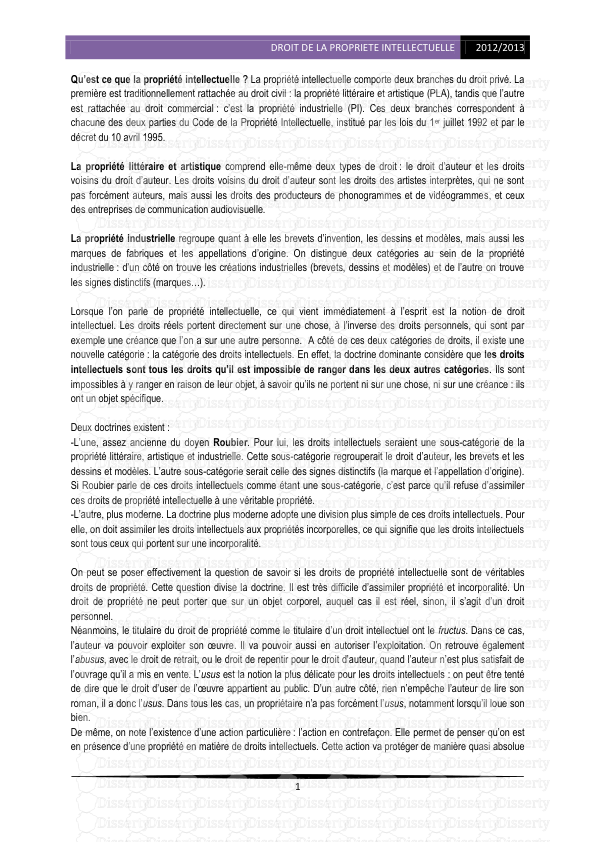DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 2012/2013 1 Qu’est ce que la propriété int
DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 2012/2013 1 Qu’est ce que la propriété intellectuelle ? La propriété intellectuelle comporte deux branches du droit privé. La première est traditionnellement rattachée au droit civil : la propriété littéraire et artistique (PLA), tandis que l’autre est rattachée au droit commercial : c’est la propriété industrielle (PI). Ces deux branches correspondent à chacune des deux parties du Code de la Propriété Intellectuelle, institué par les lois du 1er juillet 1992 et par le décret du 10 avril 1995. La propriété littéraire et artistique comprend elle-même deux types de droit : le droit d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur. Les droits voisins du droit d’auteur sont les droits des artistes interprètes, qui ne sont pas forcément auteurs, mais aussi les droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, et ceux des entreprises de communication audiovisuelle. La propriété industrielle regroupe quant à elle les brevets d’invention, les dessins et modèles, mais aussi les marques de fabriques et les appellations d’origine. On distingue deux catégories au sein de la propriété industrielle : d’un côté on trouve les créations industrielles (brevets, dessins et modèles) et de l’autre on trouve les signes distinctifs (marques…). Lorsque l’on parle de propriété intellectuelle, ce qui vient immédiatement à l’esprit est la notion de droit intellectuel. Les droits réels portent directement sur une chose, à l’inverse des droits personnels, qui sont par exemple une créance que l’on a sur une autre personne. A côté de ces deux catégories de droits, il existe une nouvelle catégorie : la catégorie des droits intellectuels. En effet, la doctrine dominante considère que les droits intellectuels sont tous les droits qu’il est impossible de ranger dans les deux autres catégories. Ils sont impossibles à y ranger en raison de leur objet, à savoir qu’ils ne portent ni sur une chose, ni sur une créance : ils ont un objet spécifique. Deux doctrines existent : -L’une, assez ancienne du doyen Roubier. Pour lui, les droits intellectuels seraient une sous-catégorie de la propriété littéraire, artistique et industrielle. Cette sous-catégorie regrouperait le droit d’auteur, les brevets et les dessins et modèles. L’autre sous-catégorie serait celle des signes distinctifs (la marque et l’appellation d’origine). Si Roubier parle de ces droits intellectuels comme étant une sous-catégorie, c’est parce qu’il refuse d’assimiler ces droits de propriété intellectuelle à une véritable propriété. -L’autre, plus moderne. La doctrine plus moderne adopte une division plus simple de ces droits intellectuels. Pour elle, on doit assimiler les droits intellectuels aux propriétés incorporelles, ce qui signifie que les droits intellectuels sont tous ceux qui portent sur une incorporalité. On peut se poser effectivement la question de savoir si les droits de propriété intellectuelle sont de véritables droits de propriété. Cette question divise la doctrine. Il est très difficile d’assimiler propriété et incorporalité. Un droit de propriété ne peut porter que sur un objet corporel, auquel cas il est réel, sinon, il s’agit d’un droit personnel. Néanmoins, le titulaire du droit de propriété comme le titulaire d’un droit intellectuel ont le fructus. Dans ce cas, l’auteur va pouvoir exploiter son œuvre. Il va pouvoir aussi en autoriser l’exploitation. On retrouve également l’abusus, avec le droit de retrait, ou le droit de repentir pour le droit d’auteur, quand l’auteur n’est plus satisfait de l’ouvrage qu’il a mis en vente. L’usus est la notion la plus délicate pour les droits intellectuels : on peut être tenté de dire que le droit d’user de l’œuvre appartient au public. D’un autre côté, rien n’empêche l’auteur de lire son roman, il a donc l’usus. Dans tous les cas, un propriétaire n’a pas forcément l’usus, notamment lorsqu’il loue son bien. De même, on note l’existence d’une action particulière : l’action en contrefaçon. Elle permet de penser qu’on est en présence d’une propriété en matière de droits intellectuels. Cette action va protéger de manière quasi absolue DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 2012/2013 2 les droits de propriété littéraire et artistiques et les droits de propriété industriels. Cette action suggère que l’on est en présence de droits opposables erga omnes. D’un autre côté, le droit de propriété est un droit en principe perpétuel. Or, tous les droits intellectuels sont des droits temporaires. Doit-on renoncer à qualifier ces droits de propriété ? Si on prend en considération ces quelques éléments, il semble qu’on puisse effectivement parler de propriété intellectuelle. D’ailleurs, l’intitulé du Code penche aussi dans ce sens. La codification dans le CPI appelle une certaine réflexion. En effet, le Code regroupe des matières assez éloignées les unes des autres. Le droit de la PI doit-il être considéré comme un droit unitaire ou finalement comme la construction de deux droits distincts ayant chacun leur propre existence ? Le droit de l’auteur nait de sa seule création, et lui confère un droit moral et un droit patrimonial sur son œuvre, tandis que l’inventeur va devoir faire un dépôt de brevet de son invention et n’aura sur ce brevet aucun droit moral. Ainsi, les conditions de naissance et d’existence de ces droits n’ont aucun point commun. Ce qui lie en réalité tous ces droits est leur caractère exclusif, et l’incorporalité de l’objet sur lequel il porte. Tous confèrent à leur titulaire un droit exclusif d’exploitation qui va être protégé par l’action en contrefaçon. Le CPI est composé de trois parties législatives. La première concerne la propriété littéraire et artistique, la deuxième la propriété industrielle, la troisième ne concerne que les DOM TOM. Le choix de la première place relève sans doute plus du hasard que d’une véritable supériorité d’une matière sur l’autre. DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 2012/2013 3 PREMIERE PARTIE : LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE La propriété littéraire et artistique est un droit récent et n’était pas connu des romains. Cela s’explique par le fait que c’est l’invention de l’imprimerie qui va être décisive en la matière. En effet, avec l’imprimerie, une œuvre va pouvoir être très largement diffusée. Elle va donc être source des bénéfices parfois substantiels. A partir de cette période, il n’est plus possible de laisser des tiers contrefacteurs s’enrichir aux dépends de l’auteur. Les droits d’auteurs vont naître grâce à la notion de privilège. Le premier privilège en la matière date de 1507. Il fut accordé par Louis 12 à un imprimeur pour la diffusion des épitres de Saint-Paul. Ces privilèges, que l’on appelle des privilèges de librairies, étaient accordés aux imprimeurs et non aux auteurs. Il faudra donc attendre le 18ème siècle pour qu’apparaisse véritablement le droit d’auteur. Un tournant décisif est pris en 1777 lorsque deux arrêts du Conseil du Roi du 30 août préfigurent une sorte de Code de la propriété littéraire en posant deux principes essentiels. L’un de ces principes accorde aux auteurs le pouvoir de revendiquer à perpétuité le privilège d’éditer et de vendre les ouvrages. L’autre veut qu’une cession à un éditeur ne puisse dépasser la durée de vie de l’auteur. Après l’abolition des privilèges, deux lois sont promulguées : la loi des 13 et 19 janvier 1791 et la loi des 19 et 24 juillet 1793. Elles consacrent respectivement le droit de représentation pour les auteurs d’œuvres dramatiques et le droit de reproduction pour les auteurs d’écrits en tout genre, pour les compositeurs de musique, pour les peintres et pour les dessinateurs. L’avancée de ces deux lois restera modeste, mais c’est avec elle que nait véritablement le droit d’auteur. Avec le temps, ces textes révolutionnaires vont être modifiés, mais de manière assez insuffisante. En effet, depuis de nombreuses inventions sont apparues, inventions qui ont un effet direct sur la diffusion d’une œuvre de l’esprit (photographie, cinéma, radio, disques, Internet…). La jurisprudence a tenté de combler les vides de ces lois, mais une loi nouvelle était nécessaire. Elle fut adoptée le 11 mars 1957. Cette loi consacre notamment le droit moral de l’auteur. Le législateur de 1957 n’avait toutefois pas prévu la multiplication des œuvres audiovisuelles, le développement du câble, ni l’ascension de l’informatique. Une loi du 3 juillet 1985 est venue moderniser cette loi de 1957 ; elle a également reconnu des droits au profit des auxiliaires de la création (artistes interprètes, producteurs de disques,…). Cette loi a également permis de rétablir un équilibre économique grâce à la rémunération des auteurs lorsque leur œuvre est diffusée dans un lieu public. Enfin, cette loi s’attaque à la contrefaçon. Le droit de la propriété littéraire et artistique sera finalement codifié dans le CPI en 1992. On y distingue le droit d’auteur et les droits voisins des droits d’auteur. DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 2012/2013 4 TITRE 1ER : LE DROIT D’AUTEUR Selon le Code, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu à l’auteur. CHAPITRE 1 Ŕ LES ŒUVRES PROTEGEES uploads/S4/ propriete-intellectuelle-cours-entier.pdf
Documents similaires










-
222
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 10, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.5337MB