Recueil Dalloz Recueil Dalloz 2008 p.2165 Le sort des règles impératives dans l
Recueil Dalloz Recueil Dalloz 2008 p.2165 Le sort des règles impératives dans le règlement Rome I (1) Louis d'Avout, Professeur à l'Université de Lyon (Lyon III, Jean-Moulin) 1 - Nul principe ne vaut juridiquement sans exception. A cette règle n'échappe pas la « pierre angulaire » (2) du règlement Rome I, au demeurant traditionnelle, qu'est pour les parties la faculté de choisir la loi applicable à leur contrat international. Juridiquement instituée comme solution des conflits de lois, l'autonomie de la volonté (3) doit s'accorder avec les objectifs étatiques contraires, qui s'expriment parfois à travers l'ordre public ou certaines règles péremptoires des ordres juridiques concernés par le contrat (4). Tout simplement parce que, pour être durablement acceptables, les libertés du commerce international ne doivent pas contredire l'agencement des commerces internes. En matière contractuelle aussi, l'intérêt des parties et celui des Etats ne sont pas nécessairement consonants. 2 - Le nouveau règlement en est conscient qui, comme la convention de Rome, veille à la conciliation de ces intérêts. L'esprit général est celui de la sécurité juridique : préserver l'efficacité de l'éventuel choix de loi ; promouvoir la prévisibilité et la cohérence des solutions, lesquelles s'opposent à de trop grandes divisions du droit applicable (qu'il soit d'ailleurs librement choisi ou bien objectivement déterminé). C'est ainsi que les exceptions à l'application de la loi par principe compétente sont rigoureusement canalisées, pour limiter au maximum la marge de manoeuvre du juge saisi. A cette fin, le règlement prévoit d'abord certains rattachements spéciaux, qui cristallisent par avance d'éventuelles règles impératives nationales : les rattachements formant un régime d'exception protecteur des parties présumées faibles (5) ; ou bien ceux qui dérogent ponctuellement à la loi applicable, par exemple quant à la validité du contrat en la forme (6). A cette fin également, le règlement laisse, à disposition du juge national, certaines réserves latentes d'impérativité ; mais il en encadre le mode d'emploi, dans la mesure où elles constituent autant de dérogations possibles à l'application de la loi normalement compétente. Le considérant liminaire n° 37 l'a rappelé en ces termes : « Des considérations d'intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des Etats membres aux mécanismes que sont l'exception d'ordre public et les lois de police. La notion de « lois de police » devrait être distinguée de celle de « disposition à laquelle il ne peut être dérogé par accord » et devrait être interprétée de façon plus restrictive ». A propos de l'exception d'ordre public, le règlement n'innove pas par rapport à la convention. Il reprend inchangée la formule restrictive selon laquelle le juge saisi ne peut évincer la loi applicable qu'en cas d'incompatibilité « manifeste » avec les conceptions fondamentales de son ordre juridique d'origine (art. 21 R). La porte ainsi entr'ouverte est très étroite ; elle ne devrait pas devenir le point principal de pénétration judiciaire des impérativités issues d'un droit non applicable au contrat. 3 - Restent alors les velléités d'application unilatérale de certaines règles extérieures à la loi du contrat. C'est à leur propos que le règlement innove principalement : il précise la terminologie - l'opposition annoncée des « lois de police » et des autres règles impératives - ; au plan opérationnel il affermit une césure nette qui tient moins à la nature abstraite des règles en question qu'à leur destination concrète. S'il s'agit de la vocation ordinaire des règles à régir les situations internes, le règlement se veut protecteur en préservant systématiquement leur autorité sur le contrat, nonobstant le choix de loi (I). S'il s'agit en revanche de la vocation exorbitante de ces règles à régir les situations transfrontières, le règlement reconnaît la super-impérativité, résistante à l'internationalité, de certaines d'entre elles ; mais il les bride par la qualification et le mode d'emploi (II). I - Préservation des règles impératives 4 - Parce qu'il ne saurait devenir un outil d'évasion du droit national, le droit international privé doit reconnaître à toute règle étatique impérative, quelle qu'elle soit, un champ minimal d'applicabilité de plein droit. Ce sont les situations purement internes à l'ordre juridique d'origine de la règle, pour lesquelles le choix d'une tierce loi ne peut nuire à la vocation des règles impératives objectivement compétentes. En ce cas, le règlement Rome I (7) reconnaît et préserve l'impérativité des règles d'origine étatique, ce qui est classique (A) ; il fait de même - c'est l'importante nouveauté - pour les règles indérogeables d'origine communautaire (B). A - Règles d'origine étatique 5 - Selon l'article 3 § 3 du règlement : « Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un autre pays que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord ». Sont ici visées, sans distinction, toutes les dispositions impératives qui ordinairement s'appliquent de plein droit aux contrats internes. Car c'est précisément l'intégrité du commerce interne que cette disposition vient protéger, à l'identique de ce qui est à l'oeuvre dans la convention de Rome. Les concepteurs de celle-ci, conscients de la difficile définition liminaire de l'internationalité des situations (8), avaient fait le choix d'une délimitation seulement formelle et apparente des conflits de lois entrant dans le champ des règles uniformes de rattachement (art. 1er § 1 repris à l'identique dans le règlement). En cas de conflit de lois factice, artificiellement créé à raison du choix par les parties d'un droit étranger applicable à une opération interne, l'article 3 § 1 autorisant ce choix devait être désactivé, et ce de manière universelle (quelle que soit la loi choisie et celle éludée), par la restauration de l'impérativité ordinaire des règles internes évincées. C'est ce que permet la disposition étudiée qui n'évacue pas la loi choisie, mais la ravale pratiquement au rang de simple stipulation contractuelle : celle-ci est comme incorporée au contrat interne, lequel se trouve par principe régi par le socle impératif de la loi de son ordre juridique d'appartenance exclusive. 6 - L'article 3 § 3 constitue bien un dispositif de protection de l'intégrité du droit étatique, dont l'autorité sur le commerce interne serait sinon généralement remise en cause par la liberté du commerce international. La reprise, à droit constant, de ce mécanisme de lutte contre les fraudes au droit interne est révélatrice d'un conservatisme prudent du législateur européen, qui ne cadre pas nécessairement avec les audaces du juge suprême de la Communauté, dans des secteurs voisins (9). Dans la codification européenne du droit international privé des obligations, la reprise d'un dispositif anti-contournement est importante parce qu'elle révèle, en creux, la vraie nature du « principe d'autonomie ». Loin d'être un but en soi, ou une réalisation de type idéologique et fondatrice d'un nouveau système - d'autorégulation des opérateurs privés, arbitres de l'efficience des droits internes -, ce principe constitue avant tout un rattachement fonctionnel, qui trouve sa justification et ses limites dans les avantages qu'il permet de gagner au cas concret. Sous un tel angle technique, la faculté de choix de la loi applicable paraît avoir ceci de vertueux qu'elle met sûrement un terme à la démultiplication des impérativités nationales, conséquence de l'internationalité de la situation. C'est là la spécificité des vrais conflits de lois : alors que le contrat interne se trouve soumis au système ordonné des règles indérogeables d'un seul ordre juridique ; la même relation, internationale car objectivement à cheval sur plusieurs ordres juridiques, est simultanément happée par divers systèmes de règles contractuelles impératives, systèmes qui sont autonomes et concurrents, partant non nécessairement conciliables au cas particulier. Par les rattachements qu'il prévoit, le droit international privé substitue l'harmonie au désordre inné des impérativités nationales ; il rend tous les ordres juridiques nationaux internationalement supplétifs, sauf un, celui de la loi du contrat, en principe seul à être alors le foyer de règles impératives. Lorsque cet ordre est rendu compétent sur désignation contractuelle, le choix exercé par les parties - en principe reconnu efficace par le droit positif - est ainsi libérateur, non pas en ce qu'il affranchirait l'opérateur de toute impérativité - le rattachement est de soumission à la loi choisie -, mais en ce qu'il permet de faire le tri des impérativités nationales par élection du système, en principe exclusif, d'enracinement de l'acte juridique volontaire. Une telle faculté, il est vrai étonnante en théorie (10), n'est reconnue qu'autant qu'elle est pratiquement rendue nécessaire par l'incertitude objective qui procède de l'internationalité de la situation. Dès lors, elle ne vaut pas lorsque le contrat ne s'enracine naturellement que dans un seul ordre juridique. Dans ce dernier cas, c'est à cet ordre juridique qu'il revient de décider, seul, de la teneur et du champ d'application ordinaire de ses règles indérogeables en matière contractuelle (11). C'est ce que reconnaît classiquement notre nouveau droit international privé à l'article 3 § 3. C'est ce que le règlement étend, par identité de motifs, aux règles d'origine communautaire pour la protection de leur intégrité. B - Règles uploads/S4/ regles-imperatives.pdf
Documents similaires

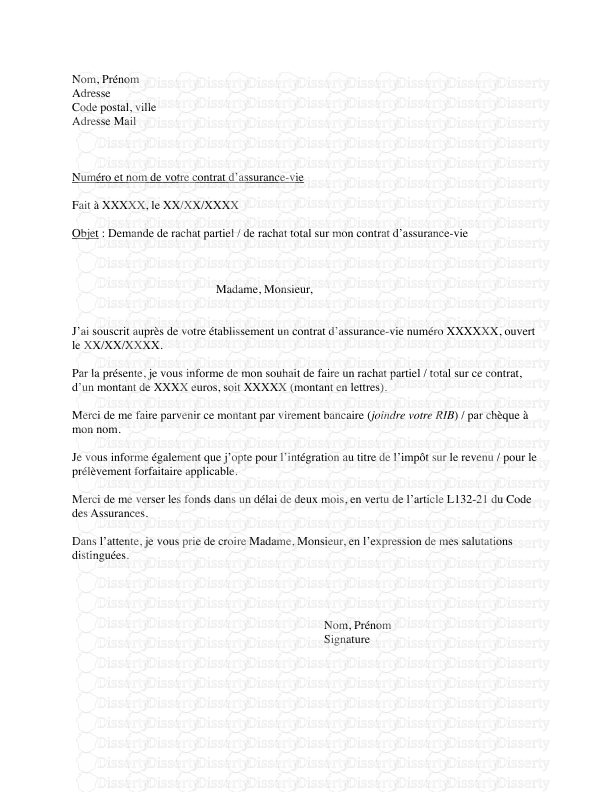


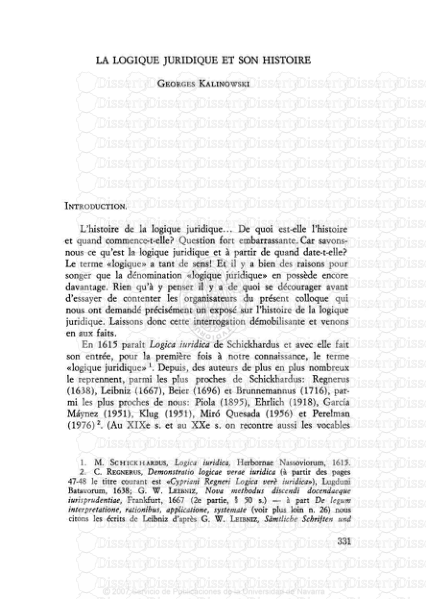
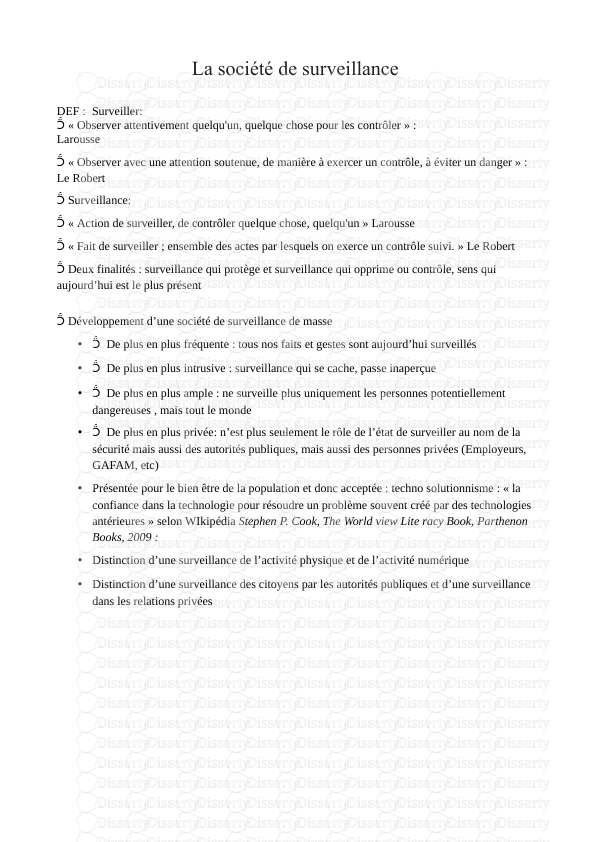




-
79
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 14, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1507MB


