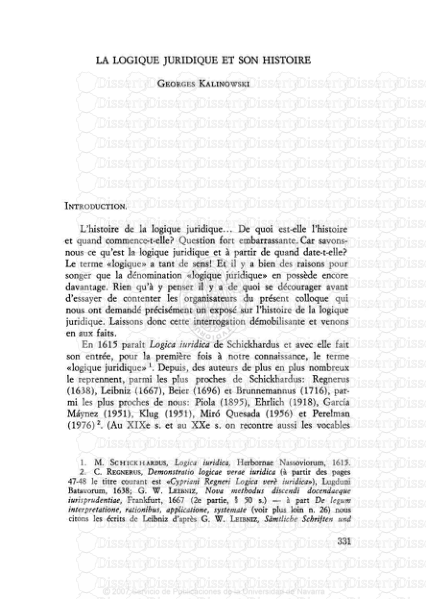LA LOGIQUE JURIDIQUE ET SON HISTOIRE GEORGES KALINOWSKI INTRODUCTION. L'histoir
LA LOGIQUE JURIDIQUE ET SON HISTOIRE GEORGES KALINOWSKI INTRODUCTION. L'histoire de la logique juridique... De quoi est-elle l'histoire et quand commence-t-elle? Question fort embarrassante. Car savons- nous ce qu'est la logique juridique et a partir de quand date-t-elle? Le terme «logique» a tant de sens! Et il y a bien des raisons pour songer que la dénomination «logique juridique» en posséde encoré davantage. Rien qu'á y penser il y a de quoi se décourager avant d'essayer de contenter les organisateurs du présent colloque qui nous ont demandé précisément un exposé sur l'histoire de la logique juridique. Laissons done cette interrogation démobilisante et venons en aux faits. En 1615 paraít Lógica iuridica de Schickhardus et avec elle fait son entrée, pour la premiére fois a notre connaissance, le terme «logique juridique» 1. Depuis, des auteurs de plus en plus nombreux le reprennent, parmi les plus proches de Schickhardus: Regnerus (1638), Leibniz (1667), Beier (1696) et Brunnemannus (1716), par- mi les plus proches de nous: Piola (1895), Ehrlich (1918), García Máynez (1951), Klug (1951), Miró Quesada (1956) et Perelman (1976)2. (Au XlXe s. et au XXe s. on recontre aussi les vocables 1. M. SCHICKHARDUS, Lógica iuridica, Herbornae Nassoviorum, 1615. 2. C. REGNERUS, Demonstratio logicae verae iuridica (a partir des pages 47-48 le titre courant est «Cypriani Regneri Lógica veré iuridica»), Lugduni Batavorum, 1638; G. W. LEIBNIZ, Nova methodus discendi docendaeque iurisprudentiae, Frankfurt, 1667 (2e partie, § 50 s.) — a part De legum interpretatione, rationibus, applicatione, systemate (voir plus loin n. 26) nous citons les écrits de Leibniz d'aprés G. W. LEIBNIZ, Sámtliche Scbriften und 331 GEORGES KALINOWSKI «logique du droit» et «logique judiciaire», voire «logique du juge», les deux derniers indiquant Pintérét porté exclusivement a l'applica- tion judiciaire du droit et l'interprétation du droit qu'elle exi- ge 2 bis) A l'époque de Schickhardus on utilisait aussi un terme voisin: «logique des juristes (jurisconsultes)». On le rencontre en 1588 chez Fraunce, en 1590 chez Freigius3. Qui plus est, en regardant le contenu des ouvrages en question des XVIe, XVI le et XVII le s., on constate que «logique juridique» était alors synonyme de «dialectique légale» ou «topique juridique». Ces vocables apparais- sent méme dans les titres des ouvrages antérieurs a celui de Schickhardus, á savoir «dialectique légale»: chez Gammarus (1524), Hegendorphinus (1531), Walther (1546), Matthias Stephani (1610); «topique juridique»: chez Everardus (1544), Cantiuncula (1545), Oldendorpinus (1551) 4. Briefe herausgegeben von der Preussischen Akademie der Wissenschaften,, Sechste Reihe, Erster Band (1663-1672), Darmstadt, Otto Reichl Verlag, 1930; A. BEIER, Lógica iuridica, Jenae, 1696; J. BRUNNEMANNUS, Enchiridium logicae iuridicae, Jenae, 1716; G. PIOLA, Elementi di lógica giuridica deduttiva e induttiva, Roma, 1895; E. E H R L I C H , Die juristische Logik, Tübingen, 1918; E. GARCÍA MÁYNEZ, Introducción a la lógica jurídica, México, 1951; F. MIRÓ QUESADA, Problemas fundamentales de la lógica jurídica, Lima, 1956; C H . PE- RELMAN, Logique juridique, Nouvelle rhétorique, Paris, Dalloz, 1976. 2 bis. Voir par exemple, d'un cóté, Lógica del diritto d'A. PESCATORE, Torino, 1863, Lógica del diritto de L. LEONE, Venecia, 1887, J. DUALDE, Una revolución en la lógica del derecho, Barcelona, 1933, Logik des Rechts de R. SCHREIBER, Berlín, 1961 ou Rechtslogik d'O. WEINBERGER, Wien-New York, 1970, et, de l'autre, les ouvrages d'H. DE SAINT-ALBÍN, de F. BERRIAT SAINT-PRIX et de P. FABREGUETTES, cites plus loin, n. 17 ainsi que les actes du Ve colloque des Instituís d'études judiciaires publiés sous le titre Logique judiciaire, Paris, PUF, 1969, — s'en approche G. CALOGERO qui titre La lógica del giudice, Padova, 1937. 3. A. FRAUNCE, The Lawiers Logike, London, 1588; reimprime, sous le titre The Lawyer's Logic, Menston, 1969; J. T H . FREIGIUS, De lógica iure- consultorum libri dúo, Basileae, 1950 (editio postrema). 4. P. A. GAMMARUS, Legalis dialéctica, Bononiae, 1524; C H . HEGEN- DORPHINUS, Libri dialecticae legalis quinqué, Lipsiae, 1531. B. WALTHER, De dialéctica ex iure, Noribergae, 1546; MATTHIAS STEPHANI, Dialéctica iuris, Heilbronnae, 1610; N. EVERARDUS, Topicorum seu locorum legalium opus, Basileae, 1544; C. CANTIUNCULA (CHANSONNETTE), Tópica legalis, Basileae» 1545; J. OLDENDORPINUS, Topicorum legalium ... traditio, Marpurgi, 1551. 332 LA LOGIQUE JURIDIQUE ET SON HISTOIRE En conséquence, il convient de conclure, compte tenu des con- statations que nous venons de faire, que la logique juridique existe, sous ce nom ou sous un nom synonyme, a partir du XVIe s. A- t-elle existe antérieurement comme logique juridique avant la lettre? Afín de repondré a cette question, il faut savoir au préalable ce qu'est la logique juridique ou plus exactement ce qui en porte le nom depuis le XVIe s. Nous avons done procede a une espéce d'enquéte en prospectant les ouvrages des principaux auteurs ayant écrit des exposés d'ensemble de la logique juridique (nous avons laissé de cóté, par souci de briéveté, les contributions partidles et les articles tellement abondants a notre époque). Parmi les anciens nous avons pris en considera tion (nous les énumérons cette fois-ci dans Pordre alphabétique): Appellus, Cantiuncula, Everardus, Frei- gius, Gammarus, Hegendorphinus, Leibniz, Oldendorpinus, Regne- rus et Schickhardus, ne consultant cependant que certains de leurs écrits5. Nous avons été naturellement plus complets pour les auteurs postérieurs, surtout ceux de notre siécle, notamment nos contempo- rains 6. Notre enquéte, sans étre exhaustive (aurait-elle pu Pétre?!...)> nous parait tout de méme suffisamment complete pour rendre possible Pesquisse d'une modeste synthése. L'analyse des ouvrages examines permet de distinguer trois orientations existant plutót en pratique qu'en théorie en ce sens que les conceptions respectives de la logique qui les caractérisent sont plutót implicites qu'explicites. Aussi différentes qu'elles soient les unes des autres, elles ont tout de méme un trait en commun: les auteurs qui les représentent étudient, d'une maniere ou d'une autre, les inférences ou, de facón genérale, les raisonnements juridi- ques (nous admettons avec K. Ajdukiewicz que toute inférence est un raisonnement, mais qu'un raisonnement peut étre constitué par plus d'une inférence, voire par quelque chose d'autre en outre)7. 5. J. APPELLUS, Methodica dialectices ratio ad iurisprudentiam adeommodata, 1533 (dans C. CANTIUNCULA, O. C, pp. 108-164); pour les autres, voir les notes precedentes 1 a 4. 6. Voir la bibliographie de G. di Bernardo et d'A. G. Conté cité plus loin n. 36. 7. K. AJDUKIEWICZ, Klasyfikacja rozumowan (Studia lógica 2 (1955), pp. 279-299). 333 GEORGES KALINOWSKI Mais tous ne les étudient pas d'un méme point de vue, ce qui améne a distinguer entre les trois orientations en question. La premiére peut étre qualifiée de traditionnelle parce qu'elle est la plus ancienne, se laisse dégager des écrits de diverses époques et trouve toujours des représentants. Elle prend en considération les inférences juridiques liées a Pinterprétation ou a Papplication du droit. Cependant le point de vue juridique Pemporte plus ou moins sur le point de vue logique. Nous disons «plus ou moins», car les choses se presentent différemment selon les auteurs, voire les écrits, ce qui conduit a déceler deux tendances. Les uns n'étudient les inférences juridiques qu'indirectement, á savoir dans la mesure oü elles sont commandées par les regles d'interprétation du droit, y compris des contrats (le contrat est la loi des contractants). lis ne sont intéressés directement que par les regles d'interprétation du droit. Certes, parmi ees regles il y a non seulement des regles de solution des conflits entre les normes juridiques, mais encoré des regles de solution des antinomies. Certes, plusieurs regles d'interprétation du droit comportent subsidiaire- ment des regles logiques d'inférence, c'est-á-dire des regles d'infé- rence garanties par des théses (lois) de la logique déductive. Mais ni les antinomies, ni les regles logiques d'inférence ne sont abordées par leur cóté logique. Les auteurs dont nous parlons ne visent que la solution des problémes juridiques d'interprétation. Les autres en revanche les étudient directement. Pourtant, méme en montrant comment on raisonne en interprétant ou en appliquant le droit, ils se contentent d'indiquer soit les prémisses particuliérement útiles, les célebres loci, T Ó - T C O I (d'ou le nom de «topique juridique»), soit les applications juridiques de certains schémes d'inférence, en principe sans expliciter le fondement de leur conclusivité. Le juridique Pemporte chez eux également sur le logique quoique a un degré inférieur que chez les auteurs du premier groupe. Néanmoins, par Pattention portee aux inférences juridiques, applications des schémes logiques d'inférence, tout en mettant Paccent plutót sur leur aspect juridique que sur leur aspect logique, ils se rapprochent quelque peu des représentants d'une autre orienta- tion en logique juridique, orientation qui a eu comme précurseurs le Leibniz de De legum interpretaüone et de Elementa inris natu- 334 LA LOGIQUE JURIDIQUE ET SON HISTOIRE ralis* (precede pour une part par des auteurs comme Regnerus) et qui trouve des adeptes a notre époque, sous Pinfluence du re- nouveau et du développement de la logique déductive intervenus a partir de la seconde moité du XlXe s. Nous en parlerons cepen- dant en dernier lieu parce que la troisiéme orientation se laissant constater dans les écrits revendiquant pour eux la qualification d'écrits de logique juridique, quoique tout a fait récente, non seule- ment plonge ses racines dans un passé tres éloigné uploads/S4/ georges-kalinowski-pari-s-la-lo-gica-juri-dica-y-su-historia.pdf
Documents similaires










-
67
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 26, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 3.2767MB