Chapitre introductif L’article 1124 du code civil de 1804 énonçait que « Les in
Chapitre introductif L’article 1124 du code civil de 1804 énonçait que « Les incapables de contracter sont, Les mineurs, Les interdits, Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi » La mort civile : Elle privait la personne de tous ses droits civils, le condamné perdait la propriété de tous ses biens, sa succession était ouverte, son mariage était dissous, il ne pouvait plus se marier (art. 25). L’incapacité des mineurs : la minorité allait jusqu’à l’âge de 21 ans. Les mineurs étaient soumis à la « puissance paternelle » qui remplaçait alors l’autorité parentale. On était très loin de l’idée actuelle d’un droit conféré aux parents dans l’intérêt de l’enfant. L’idée d’autorité était proche de celle de domination. Quelques restrictions persistaient au-delà de la majorité, ainsi, les hommes de moins de 25 ans ne pouvaient pas se marier sans l’autorisation de leurs parents (art. 148). L’incapacité des majeurs vulnérables dans le code de 1804 : elles pouvaient voir leur capacité juridique supprimée ou réduite sans véritable objectif de préservation maximum de leur autonomie. L’optique est très paternaliste. Deux mesures étaient prévues par le code civil de 1804 : l’interdiction et le conseil judiciaire. Très schématiquement, elles correspondaient à la tutelle et à la curatelle puisque l’interdiction prévoyait la représentation et le conseil conduisait à une assistance. L’interdiction : L’article 509 du code civil de 1804 énonçait ainsi : « les lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle des interdits ». Toute idée de protection de la personne n’est tout de même pas absente dans les textes puisque l’article 510 énonçait alors « Les revenus d’un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ». Ainsi, aucun objectif de préservation de l’autonomie n’apparaît mais il y a bien une volonté de protection. Le conseil judiciaire : Si le juge refusait de prononcer l’interdiction, il pouvait tout de même prévoir qu’une assistance d’un conseil serait indispensable pour certains actes, optant ainsi pour un régime de conseil judicaire, plus proche de la curatelle. En outre, le conseil judiciaire était également possible pour les prodigues. L’enfermement des aliénés : il conduisait, si la personne n’était pas déjà interdite, à une incapacité puisque la gestion des biens de l’aliéné était confiée à un administrateur. Il y avait ainsi confusion entre le soin (à travers l’hospitalisation) et la mesure civile d’incapacité. La loi de 1968 visait à réformer les régimes d’incapacité qui concernaient uniquement les mineurs et les majeurs incapables de pourvoir à leurs intérêts, de s’assumer ou d’assumer leur famille. Les lois du 3 janvier 1968 et du 5 mars 2007 La loi du 3 janvier 1968 Cette loi a mis fin au système des interdits et des aliénés et a créé le système tutélaire. Plus précisément, elle a maintenu la tutelle des mineurs et a mis en place trois possibilités pour les majeurs : la sauvegarde de justice, à vocation provisoire, et surtout la curatelle et la tutelle, qui peuvent être envisagées à plus long terme. Selon cette loi : « La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile. La sauvegarde de justice, à vocation provisoire ou tutelle : soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales ». La seule mesure qu’il était possible d’utiliser dans le cas du dernier alinéa était la curatelle, dite curatelle pour prodigalité, à l’exclusion donc de la tutelle. Il était possible de voir sa capacité juridique réduite alors même que l’on disposait de toutes ses facultés. Tel pouvait être le cas en cas de prodigalité, d’intempérance ou d’oisiveté La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs La loi vise a mettre en avant l’idée de protection et non de diminution, d’où le rejet de l’expression « majeurs incapables » et l’essor des termes « majeur protégé » (la comparaison des intitulés des lois de 1968 et de 2007 le démontre). L’idée est de protéger les intérêts de la personnes protégée (pour les mineurs, cela renvoie à l’objectif de protection de l’intérêt de l’enfant) et de préserver au maximum ses choix (là encore, pour les mineurs, l’idée est déjà connue, notamment à travers les règles imposant d’entendre les mineurs doués de discernement). On retrouve derrière cela l’essor de l’autonomie personnelle et l’idée de protection des droits fondamentaux individuels de chacun Dans les cas de difficultés sociales il faut utiliser les mesures d’accompagnement socio judiciaire La loi supprime donc la curatelle pour prodigalité qui permettait de décider d’une curatelle sans certificat médical et pour seuls motifs sociaux. Il est aujourd’hui exclu de retirer la capacité d’une personne en raison d’un surendettement ou pour éviter une dilapidation du patrimoine. Désormais, seules les personnes bénéficiant de prestations sociales sont susceptibles d’être concernées par une mesure, ce sera en priorité une mesure d’accompagnement social et, si cela s’avère nécessaire, tout au plus, la capacité de la personne pourra être réduite mais uniquement s’agissant de la perception et de la gestion de ces prestations, via une mesure d’accompagnement judiciaire. La création du mandat de protection future. Celui-ci permet à la personne d’anticiper et de prévoir elle-même la protection à mettre en place si un jour cela devient nécessaire. La création de ce mécanisme reflète aussi une idée de déjudiciarisation puisque l’intervention du juge ne sera pas indispensable. L’ordonnance du 15 octobre 2015 et la loi du 23 mars 2019 : choix de l’autonomie Une nouvelle forme de protection juridique : l’habilitation familiale. L’habilitation familiale est prioritaire par rapport aux mesures judiciaires de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle. Depuis sa création, le dispositif de l’habilitation familiale a été étendu (v. infra), ce qui a permis de renforcer la place de la famille dans la protection des majeurs. Désormais, chacun des parents exerçant l’autorité parentale est administrateur légal (art. 382 C. civ.) et peut agir seul sauf pour certains actes très importants qui nécessitent l’autorisation du juge. - La loi du 23 mars 2019 l'habilitation familiale est recomposée si bien qu'elle concurrence l'ensemble des mesures de protection judiciaire (les conditions d'ouverture et de renouvellement se rapprochent fortement du droit commun ; désormais, elle peut être aussi bien de représentation que d'assistance) ; et le juge des tutelles cède sa place, depuis le 1er janvier 2020, au juge des contentieux de la protection. L’incapacité de jouissance C’est l’incapacité d’être titulaire d’un droit. Une incapacité totale de jouissance revient à une absence de personnalité juridique. Dans le code civil actuel, les incapacités spéciales de jouissance sont inspirées d’une méfiance dans certaines situations particulièrement propices à un abus. Par exemple disposition entre corps médical ayant prodigué des soins et le malade qui décède. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité ». L’incapacité d’exercice Elle n’empêche pas d’être titulaire d’un droit, elle empêche simplement de l’exercer. Pour l’exercer il faudra alors, selon les cas, soit être représenté par un tiers, soit être assisté par un tiers. Les incapacités d’exercice peuvent être générales, c'est à dire concerner tous les droits ou être spéciales, c'est à dire ne concerner qu’un droit particulier. Au sein des mineurs, il existe de nombreuses règles qui conduisent à une gradation de l’autonomie des moins de 18 ans. Les textes renvoient parfois à des notions telles que le discernement ou la maturité. Dans d’autres cas, ils fixent des seuils d’âge. Les seuils les plus fréquents sont 13 et 16 ans. Ainsi, par exemple, le changement de prénom, la plupart des changements de noms, l’adoption ou encore l’acquisition anticipée de la nationalité française d’un mineur de 13 ans suppose son consentement (art. 60, 61-3, 61-3-1, 363, 345, 360 et 21-11 C. civ.). A partir de 16 ans, l’autonomie est encore plus importante puisque le mineur peut agir seul et sans autorisation pour acquérir ou perdre la nationalité française (art. 17-3, 20-2, 21-11, 22-3 et 26-3 C. civ.). Son autonomie grandissante atteint également les questions patrimoniales puisqu’il peut obtenir une copie des documents relatifs à la gestion de ses biens qui seraient demandés par le juge à son administrateur légal (art. 387-4 et 5 C. civ.) ou qui sont établis par son tuteur (art. 510 C. civ.). Depuis 2010, il peut même être autorisé à gérer une entreprise personnelle (art. 388-1-2 et 401 C. civ.). Il peut également disposer de la moitié de ses biens disponibles par testament (art. 904 C. civ.). Enfin, bien sûr, à partir de 16 ans, il peut être uploads/S4/ resume-droit-des-personnes-vulnerable.pdf
Documents similaires








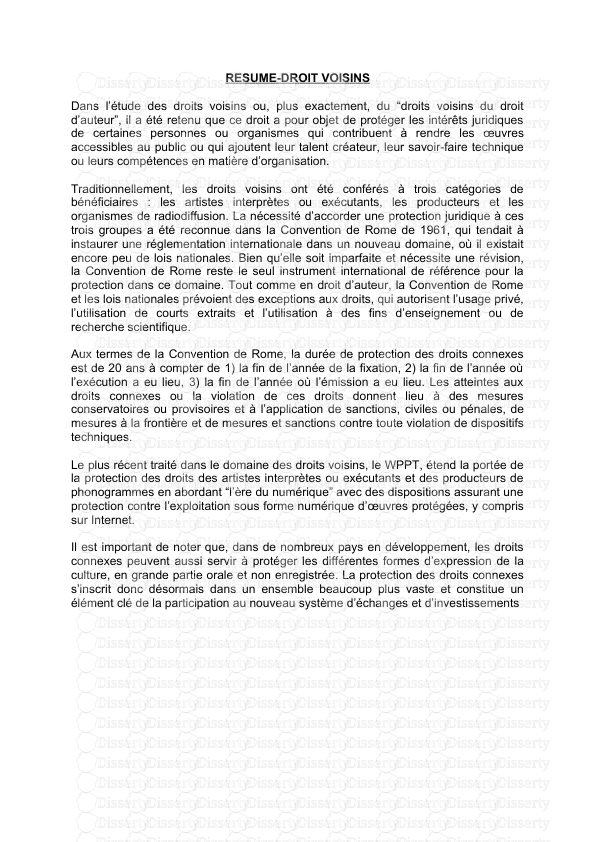

-
64
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 18, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1472MB


