La Revue des droits de l’homme Revue du Centre de recherches et d’études sur le
La Revue des droits de l’homme Revue du Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux 5 | 2014 Revue des droits de l'homme - N° 6 Les paradoxes d’une prétendue révolution sociale Carlos Gonzalez-Palacios Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/revdh/722 DOI : 10.4000/revdh.722 ISSN : 2264-119X Éditeur Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux Édition imprimée Date de publication : 1 juin 2014 Référence électronique Carlos Gonzalez-Palacios, « Les paradoxes d’une prétendue révolution sociale », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 5 | 2014, mis en ligne le 26 mai 2014, consulté le 10 décembre 2020. URL : http:// journals.openedition.org/revdh/722 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.722 Ce document a été généré automatiquement le 10 décembre 2020. Tous droits réservés Les paradoxes d’une prétendue révolution sociale Carlos Gonzalez-Palacios Tous nos remerciements vont aux Professeures Véronique Champeil-Desplats et Diane Roman, ainsi qu’à Cédric Roulhac et Nicolas Collet-Thiry pour leurs conseils et relectures constructives. De même nos remerciements s’adressent à Héloïse Weerdmeester pour ses traductions de la langue anglaise. 1 Du point de vue de la science politique, la révolution sociale peut être comprise comme une rupture du système réalisée directement par la société. Toutefois ce n’est pas cette acception de l’expression « révolution sociale » que l’on retiendra ici. Par celle-ci, il s’agira plutôt de traiter de la question des changements fondamentaux qui ont donné naissance aux droits sociaux1 en Occident. Pour ce faire, nous observerons de façon préliminaire de quoi est constituée la notion de « révolution » (1) ainsi que les fondements du « social » (2). Nous verrons que ces derniers font appel aux doctrines du solidarisme ou du socialisme républicain, qui favorisent l’apparition des droits sociaux, sans pour autant bouleverser les logiques initiales du système libéral (3). Le libéralisme semblerait alors paradoxalement renforcé (4). 1) Critères de la notion de « révolution » 2 Indépendamment de la question « sociale », de façon générale, le phénomène révolutionnaire peut être compris comme la crise d’un système donné qui provoque inexorablement son effondrement et l’adoption d’un nouveau système2. A partir de cette définition, on remarquera que rien n’indique combien de temps la crise doit durer et moins encore si sa réalisation dépend d’une quelconque manifestation de violence. Cependant, deux observations peuvent être soulevées. Premièrement, la révolution consiste dans un bouleversement des logiques initiales. Ces logiques, s’agissant des droits sociaux, impliquent une transformation du vaste ensemble systémique juridico- politique consistant dans le changement des assises économiques dudit système3. Deuxièmement, il peut être souligné que si la révolution est le résultat d’une crise du système, alors cette crise peut être de longue durée, ce qui remet en cause l’idée de célérité du mouvement révolutionnaire. Il ne pourra donc pas être déterminé, au Les paradoxes d’une prétendue révolution sociale La Revue des droits de l’homme, 5 | 2014 1 moment même d’une crise, si cette dernière est un élément constitutif d’une révolution, ou si elle n’est qu’un simple mouvement de révolte conduisant, au meilleur des cas, vers une simple évolution du système. En conséquence, si la révolution n’est pas identifiable sur le moment même de sa réalisation, il est alors nécessaire de laisser un espace temporel entre les faits a priori révolutionnaires et le moment où la science systématise ces faits, afin d’apprécier dans toute son ampleur la réalité et l’effectivité du changement de paradigme. En ce sens, pour reconnaître à un mouvement la qualification de révolution, le recours à l’élément temporel paraît indispensable car il octroierait une « extériorité » ou un recul face à l’évènement prétendument révolutionnaire. Enfin le bouleversement des logiques initiales qui constitue la révolution suppose qu’au préalable soient distingués les critères du système à renverser. A l’image d’un tyran sur le point d’être renversé, lorsque la société est hostile au statu quo, le système (politique et social) en place est toujours désigné comme le facteur de mise en péril du corps social4. C’est à ce moment que la raison d’Etat ou necessitas dispose de légitimité pour s’imposer sur l’ordre établi, considéré injuste, afin de rétablir un ordre reconnaissant l’intérêt public 5. 2) La connexité entre les fondements respectifs des droits sociaux et du socialisme républicain 3 Si les droits sociaux sont des droits, sur quoi fondent-ils leur légitimité pour accéder à ce statut de « droits »? Depuis une perspective juridique, il est certain que les droits sociaux obtiennent la qualité de droits dès lors que les « idées sociales » - pré-juridiques - sont juridicisées et a fortiori constitutionalisées. A partir de ce moment, ces idées feraient partie de l’ordre juridique et pourraient être pensées, exécutées et invoquées en faisant appel à l’instrument juridique étatique. La juridisation des « idées sociales », qui donne naissance aux droits sociaux, ne se réalisant pas de façon uniforme, ni rapide, ni même complète, elle serait le produit d’une évolution qui révélerait les différentes composantes des droits sociaux et donc la définition de ceux-ci. Comme l’affirme C.-M. Herrera, c’est dans l’histoire de leur constitutionnalisation que pourraient être déterminées les différentes strates de la signification des droits sociaux6. 4 Mais alors que le droit donne l’opportunité de définir les droits sociaux à travers une observation descriptive de ce qui existe déjà en droit positif, cela ne suffit pas à expliquer le fondement des « idées sociales » qui constituent le socle conceptuel des droits sociaux. Pour cela, force est d’observer qu’une analyse du seul droit n’est pas suffisante et qu’il est nécessaire de faire appel à une analyse iusphilosophique pour comprendre « le mobile7 », c’est-à-dire l’argumentaire essentiel, qui fonde la particularité des droits sociaux par rapport aux autres droits. 5 Dans cette entreprise, il peut être relevé trois difficultés majeures qui rendent difficile la définition des « mobiles » ou fondements des droits sociaux : premièrement il n’existe pas un fondement unique des droits sociaux ; deuxièmement, ce fondement peut ne pas leur être exclusif ; troisièmement, la définition du fondement des droits sociaux est étroitement liée à l’adhésion plus ou moins explicite à des théories politiques. 6 En premier lieu, s’agissant du fondement des droits sociaux, il existe une pluralité d’arguments ayant vocation à devenir les buts essentiels de la promotion des droits sociaux : la justice sociale, l’émancipation de la classe ouvrière, la protection sociale, la fraternité, l’égalité matérielle, etc. Cependant, les analyses de cette question mènent à Les paradoxes d’une prétendue révolution sociale La Revue des droits de l’homme, 5 | 2014 2 un résultat non définitif et, en conséquence, pourvu d’une subjectivité variable selon la psychologie du penseur et selon la sociologie des groupes sociaux dans lesquels ces idées sociales prennent forme8. Pourtant, les buts essentiels qui ont été soulevés présentant des similitudes de contenu (ils prônent tous la protection, des personnes vulnérables ; il est souvent question d’un besoin matériel), il n’est pas impossible de trouver une formule - peut-être un peu plus élaborée - capable de concilier les différents fondements affichés. 7 En deuxième lieu, le fondement des droits sociaux, s’il y en existe un, ne leur est pas forcément exclusif. En effet, si on admet que la justice sociale est l’argument essentiel des droits sociaux et que la liberté est celui des droits civils et politiques, on constate assez rapidement la possibilité d’interactions. Un droit social tel que le droit à l’éducation, par exemple, constitue une des conditions de réalisation du droit de vote qui est un droit civil et politique. Cela signifie que les droits sociaux renforcent les droits civils et politiques et donc la liberté, l’inverse étant aussi possible9. 8 Enfin, en troisième lieu, les fondements des droits sociaux peuvent être discrédités par des présupposés politiques plus ou moins assumés. Comme l’a montré V. Champeil- Desplats, il existe de multiples façons de concevoir des droits sociaux et de les définir10. Or, pour ne prendre que cet exemple, la définition qui repose sur leur fonction « est en proie à une idéologisation plus rapide que les autres modes de définition11 ». L’argument « social » perdrait alors plus facilement en légitimité scientifique qu’il aurait tendance à s’opposer au paradigme dominant du libéralisme qui est perçu comme l’unique voie scientifique du droit et de la politique. Par ailleurs, dans la mesure où une définition fonctionnelle aurait le plus souvent tendance à être ample ou générale, cela l’exposerait au risque, au moment de soumettre cette définition à une critique scientifique rigoureuse, de faire apparaître des éléments tautologiques et contradictoires, voire dogmatiques. 9 Au vu de ces difficultés, c’est sans doute l’Histoire qui donne les premières lumières nécessaires pour expliquer le fondement probable des droits sociaux. Ainsi, lorsque P. Rosanvallon aborde la question sociale, il en fait tout d’abord une analyse historique. Lors de la Révolution française, dit-il, « les constituants et conventionnels avaient considéré la question de l’assistance comme un problème philosophiquement central mais économiquement marginal [alors que] les hommes de 1830 et d’après doivent faire face à un développement du paupérisme […] cela revient en effet à poser la question de la propriété et du droit au travail dans des termes uploads/S4/ revdh-722.pdf
Documents similaires




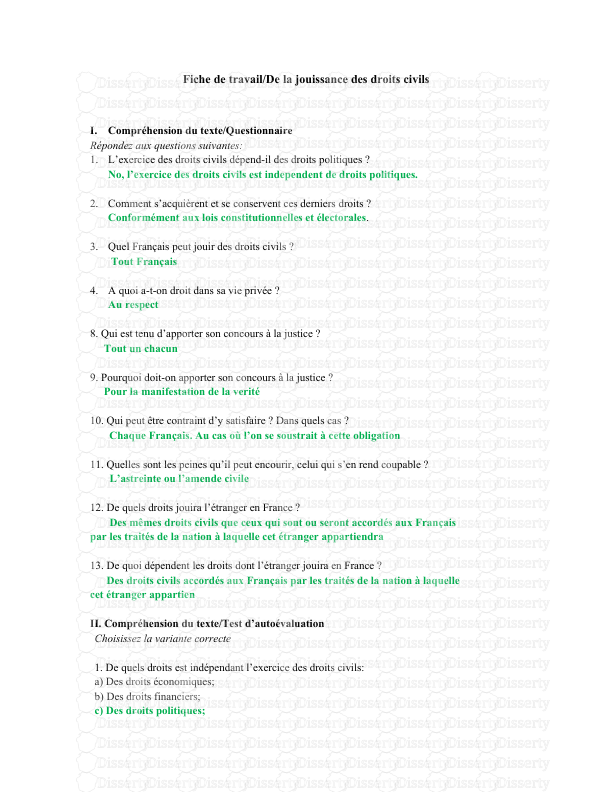





-
76
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.3404MB


