LA MÉTHODOLOGIE JURIDIQUE EN QUÊTE D'IDENTITÉ Michelle Cumyn, Mélanie Samson Un
LA MÉTHODOLOGIE JURIDIQUE EN QUÊTE D'IDENTITÉ Michelle Cumyn, Mélanie Samson Université Saint-Louis - Bruxelles | « Revue interdisciplinaire d'études juridiques » 2013/2 Volume 71 | pages 1 à 42 ISSN 0770-2310 DOI 10.3917/riej.071.0001 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes- juridiques-2013-2-page-1.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour Université Saint-Louis - Bruxelles. © Université Saint-Louis - Bruxelles. Tous droits réservés pour tous pays. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) © Université Saint-Louis - Bruxelles | Téléchargé le 25/11/2021 sur www.cairn.info (IP: 41.249.6.42) © Université Saint-Louis - Bruxelles | Téléchargé le 25/11/2021 sur www.cairn.info (IP: 41.249.6.42) R.I.E.J., 2013.71 1 ETUDE La méthodologie juridique en quête d’identité Michelle CUMYN Professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval, Québec, Canada Mélanie SAMSON Professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université Laval, Québec, Canada Dans les milieux professionnels, les juristes sont réputés pour leur rigueur. Suivant une opinion assez largement répandue, les études en droit procurent une excellente formation intellectuelle : on dit que « le droit mène à tout ». Curieusement, dans les milieux universitaires, c’est au contraire l’absence d’une méthode rigoureuse qui est souvent reprochée aux juristes. Le droit est perçu comme une filière professionnelle dont la culture de recherche est peu développée. Les cours de méthodologie du droit ont un contenu différent au premier cycle et aux cycles supérieurs, du moins dans les facultés de droit québécoises. Au premier cycle, la formation prépare surtout les étudiants à faire carrière dans l’une des professions juridiques. Aux deuxième et troisième cycles, il s’agit plutôt de les former à la recherche. Les cours aux cycles supérieurs empruntent souvent à la méthodologie des autres sciences sociales, ce qui tend à conforter l’impression suivant laquelle le droit n’aurait pas de méthode de recherche qui lui soit propre. Y aurait-il disjonction entre la pratique du droit, qui aurait développé une certaine méthode, d’une part, et la recherche en droit ou sur le droit, qui en serait dépourvue, d’autre part ? Nous ne le croyons pas. La recherche en droit ou sur le droit1 n’est pas en quête de méthodes, mais elle est en quête d’identité quant à ses méthodes. 1 Nous verrons que l’adoption du modèle herméneutique, que nous préconisons, remet en question l’existence d’une cloison étanche entre la recherche en droit (perspective interne) et la © Université Saint-Louis - Bruxelles | Téléchargé le 25/11/2021 sur www.cairn.info (IP: 41.249.6.42) © Université Saint-Louis - Bruxelles | Téléchargé le 25/11/2021 sur www.cairn.info (IP: 41.249.6.42) R.I.E.J., 2013.71 La méthodologie juridique en quête d’identité 2 Nous prenons comme point de départ un article marquant du philosophe canadien Charles Taylor publié pour la première fois en 1971, « L’interprétation et les sciences de l’homme »2. Cet article oppose deux modèles méthodologiques qui ont cours dans les recherches en sciences humaines et sociales. Le modèle empirique-logique emprunte au positivisme scientifique issu des sciences de la nature. Plusieurs sciences sociales ont développé des méthodes de recherche inspirées de ce modèle : la sociologie, la psychologie, l’économie et la science politique, par exemple. Taylor entendait remettre en question la pertinence du modèle empirique- logique, qui semblait en voie de dominer les sciences humaines. Il se portait à la défense des approches fondées sur un deuxième modèle, l’herméneutique, ce qui, dans une conception large, englobe les courants interprétativiste et constructiviste qui se sont développés dans plusieurs domaines des sciences humaines3, dont le droit. L’application des deux modèles dégagés par Taylor à la recherche en droit et sur le droit permet de rendre compte des différentes facettes de la recherche juridique et des choix méthodologiques qui s’offrent à elle. Elle permet aussi de mieux comprendre l’ambivalence des juristes et la perplexité des chercheurs des autres disciplines à l’égard du positivisme juridique. Nous croyons que la recherche en droit (perspective interne) doit s’émanciper complètement de l’influence du modèle empirique-logique issu du positivisme scientifique et véhiculé par le positivisme juridique, influence que nous jugeons néfaste et que nous critiquons. Nous reconnaissons toutefois un rôle important au positivisme scientifique dans la recherche sur le droit (perspective externe ou interdisciplinaire), car le modèle empirique- logique s’avère très efficace pour observer et critiquer le droit. Dans la première partie du présent article, nous arguons que l’empirisme logique est un leurre pour la recherche en droit, et que cette recherche sur le droit (perspective externe), même si cette distinction demeure pertinente et utile. En ce sens, notre position se rapproche de celle de Fr. OST et M. VAN DE KERCHOVE, qui considèrent que les théoriciens du droit étudient celui-ci d’un « point de vue externe modéré » : « De la scène au balcon. D'où vient la science du droit ? », in Normes juridiques et régulation sociale, F. Chazel et J. Commaille (dir.), Paris, LGDJ, 1991, p. 67-80. Voy. aussi J.-Y. CHÉROT, « La question du point de vue interne dans la science du droit », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 59, 2007, p. 17-34. 2 C. TAYLOR, « L’interprétation et les sciences de l’homme », in La liberté des modernes, Paris, PUF, 1987, c. 5. Voy. aussi T.S. KUHN, « The Natural and the Human Sciences », in The Road Since Structure. Philosophical Essays, Chicago, Chicago University Press, 2000, c. 10, où Kuhn commente l’article de Taylor et suggère que son propos est valable non seulement pour les sciences humaines, mais aussi, dans une certaine mesure, pour les sciences de la nature. 3 Voy. notamment M. GIROD-SÉVILLE et V. PERRET, « Fondements épistémologiques de la recherche », in Méthodes de recherche en management, R.-A. Thiétart et al., 3 e éd., Paris, Dunod, 2007, p. 13-33. © Université Saint-Louis - Bruxelles | Téléchargé le 25/11/2021 sur www.cairn.info (IP: 41.249.6.42) © Université Saint-Louis - Bruxelles | Téléchargé le 25/11/2021 sur www.cairn.info (IP: 41.249.6.42) Michelle Cumyn & Mélanie Samson R.I.E.J., 2013.71 3 dernière doit se tourner résolument vers l’herméneutique (I). Dans la seconde partie, nous présentons de manière plus concrète les implications d’un tel virage pour l’enseignement des principaux volets de la méthodologie juridique (II). Nous soutenons qu’en plus de son influence – déjà connue – sur les théories de l’interprétation des textes normatifs, le modèle herméneutique oblige à repenser la théorie des sources du droit et à concevoir différemment les catégories juridiques de même que le processus de qualification en droit. I. Deux modèles pour la méthodologie juridique : l’empirisme logique et l’herméneutique Dans les sciences humaines et sociales, il existe une opposition parfois vive entre les chercheurs qui adhèrent au modèle empirique-logique (A) et ceux qui se réclament plutôt de l’herméneutique (B). Les positions sont moins campées en droit : nous chercherons à bien dégager ces deux modèles et leurs implications. A. L’empirisme logique Le modèle empirique-logique est issu du positivisme scientifique. Son influence sur la méthodologie du droit est en partie due au positivisme juridique, dont les rapports avec le positivisme scientifique s’avèrent ambigus. Aussi, nous présenterons d’abord le positivisme scientifique (1) avant d’aborder le positivisme juridique (2). 1) Le positivisme scientifique Le développement fulgurant des connaissances scientifiques à partir du 17e siècle a eu une influence marquante sur les sciences humaines. La rencontre du rationalisme issu du continent européen et de l’empirisme qui s’était d’abord développé en Grande-Bretagne a permis l’éclosion d’une multitude de méthodes de recherche alliant de différentes manières ces deux modes de pensée. Comme le précise Charles Taylor, leur but commun est d’atteindre un très haut degré de certitude et d’objectivité dans l’élaboration de la connaissance, ce qui implique la « rupture » du cercle herméneutique4. Le positivisme scientifique postule que les seules connaissances valides sont celles qui ont été acquises suivant le modèle empirique-logique. Dans sa dimension empirique, ce modèle exige que les connaissances se fondent sur une observation objective du réel. Le chercheur qui observe est 4 C. TAYLOR, supra note 2, p. 142. © Université Saint-Louis - Bruxelles | Téléchargé le 25/11/2021 sur www.cairn.info (IP: 41.249.6.42) © Université Saint-Louis - Bruxelles | Téléchargé le 25/11/2021 sur www.cairn.info (IP: 41.249.6.42) R.I.E.J., 2013.71 La méthodologie juridique en quête d’identité 4 neutre, effacé. L’objet étudié existe indépendamment de lui et l’observation, si elle est valide, ne diffère pas de celle qui aurait été effectuée par d’autres. L’expérimentation rend possible l’observation indirecte de phénomènes qui ne peuvent pas être perçus directement par les sens : par exemple, elle permet de mesurer la vitesse de la lumière. L’expérimentation permet aussi de découvrir et de vérifier l’existence de corrélations entre divers phénomènes. Toute connaissance du réel est ainsi construite à partir de données brutes, où la donnée brute peut être définie comme « une unité d’information qui n’est pas l’effectuation d’un jugement, qui ne contient par définition aucun élément de lecture ou d’interprétation », et « dont la validité ne peut être mise en question en proposant une autre lecture ou une autre interprétation »5. Ainsi, « l’ambition suprême serait de construire notre connaissance à partir de ces éléments constituants, avec des jugements qui pourraient s’ancrer dans une certitude indépendante de l’intuition subjective »6. Dans sa dimension logique, le positivisme scientifique veut que l’élaboration des connaissances à partir des uploads/S4/ riej-071-0001.pdf
Documents similaires




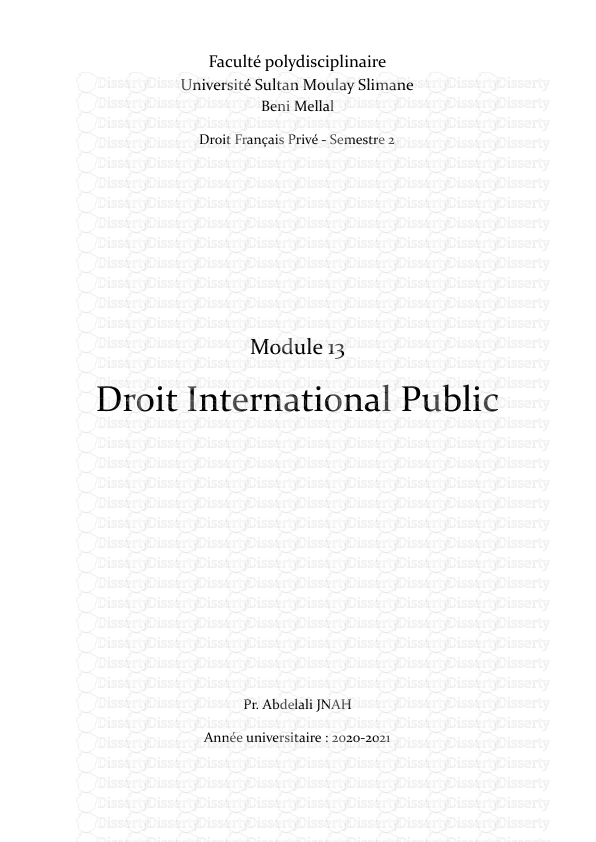





-
104
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 18, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.7004MB


