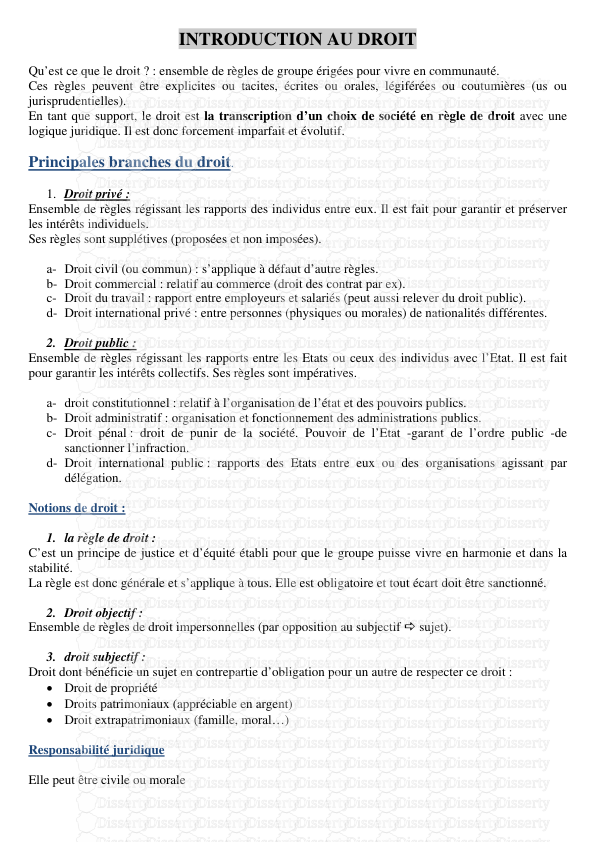INTRODUCTION AU DROIT Qu’est ce que le droit ? : ensemble de règles de groupe é
INTRODUCTION AU DROIT Qu’est ce que le droit ? : ensemble de règles de groupe érigées pour vivre en communauté. Ces règles peuvent être explicites ou tacites, écrites ou orales, légiférées ou coutumières (us ou jurisprudentielles). En tant que support, le droit est la transcription d’un choix de société en règle de droit avec une logique juridique. Il est donc forcement imparfait et évolutif. Principales branches du droit. 1. Droit privé : Ensemble de règles régissant les rapports des individus entre eux. Il est fait pour garantir et préserver les intérêts individuels. Ses règles sont supplétives (proposées et non imposées). a- Droit civil (ou commun) : s’applique à défaut d’autre règles. b- Droit commercial : relatif au commerce (droit des contrat par ex). c- Droit du travail : rapport entre employeurs et salariés (peut aussi relever du droit public). d- Droit international privé : entre personnes (physiques ou morales) de nationalités différentes. 2. Droit public : Ensemble de règles régissant les rapports entre les Etats ou ceux des individus avec l’Etat. Il est fait pour garantir les intérêts collectifs. Ses règles sont impératives. a- droit constitutionnel : relatif à l’organisation de l’état et des pouvoirs publics. b- Droit administratif : organisation et fonctionnement des administrations publics. c- Droit pénal : droit de punir de la société. Pouvoir de l’Etat -garant de l’ordre public -de sanctionner l’infraction. d- Droit international public : rapports des Etats entre eux ou des organisations agissant par délégation. Notions de droit : 1. la règle de droit : C’est un principe de justice et d’équité établi pour que le groupe puisse vivre en harmonie et dans la stabilité. La règle est donc générale et s’applique à tous. Elle est obligatoire et tout écart doit être sanctionné. 2. Droit objectif : Ensemble de règles de droit impersonnelles (par opposition au subjectif sujet). 3. droit subjectif : Droit dont bénéficie un sujet en contrepartie d’obligation pour un autre de respecter ce droit : Droit de propriété Droits patrimoniaux (appréciable en argent) Droit extrapatrimoniaux (famille, moral…) Responsabilité juridique Elle peut être civile ou morale Responsabilité civile Préjudice atteint une personne physique Il faut réparer objectivement (Indemniser sans enrichir) donne lieu à dommage et intérêts le responsable ne répare par forcement lui-même (assurance, état, …) la victime initie l’action Responsabilité pénale Préjudice atteint la société Il faut punir subjectivement (Droit de punir de la société) donne lieu à une peine le responsable répond seul de ses actes le ministre public (ou procureur) initie l’action au nom du groupe Pour que la responsabilité juridique soit engagée il y a Nécessité d’un préjudice Fait dommageable Lien de causalité entre les deux. Responsabilité civile peut être : Délictuelle : violation d’obligation légale Contractuelle : inexécution de contrat Fondements du pénal : 1. punition 2. prévention (par l’exemple) 3. protection (prison : protéger la société) 4. reclassement : réinsertion Préjudice peut être matériel, moral, physique ou mixte. Il doit être certain, direct et non encore réparé. La faute peut être prouvée par culpabilité, imputabilité ou abus de droit. Ou présumée Responsabilité pour autrui (Etats argent) Responsabilité du fait d’autrui (parent enfant) Responsabilité du fait des choses. Causalité : retrouver les causes du dommage ou faire jouer les faits exonératoires (circonstances atténuantes) si - Cause étrangère (force majeure) : imprévisible + irrésistible + extérieure - Du fait d’un tiers ou de le victime : imprévisible + inévitable. Eléments constitutifs de l’infraction 1. élément légal : a- principe de légalité : « pas de peine sans loi », application stricte et sans rétroactivité (sauf si atténuation possible). b- Sources du pénal : 1- code pénal 2- traités internationaux (droit de l’homme d l’enfant…) 3- certains actes de l’exécutif (décret, arrêté, ordonnance…) 2. élément matériel : Le juge doit prouver que l’accusé a commis l’infraction (de commission) ou omis une action qui l’a entraînée (infraction d’omission). Si l’infraction n’est pas consommée (tentative), ses éléments son punis : - commencement d’exécution. - interruption involontaire de l’exécution. 3. élément moral : L’imputabilité de la faute est fonction - des facultés intellectuelles (insuffisance (ex sénilité), altération (ex ébriété ou folie) …) - du libre arbitre : absence de contrainte physique ou morale. Peine * Manquement délibéré * Manquement * Négligence * Inattention * Imprudence * Maladresse Délits Une définition du droit aérien ? Le décret N° 2-61-161 du 10juillet 1962 portant réglementation de l’aéronautique civile définit la matière (aéronef, espace …) mais pas le droit aérien. Le droit aérien constitue l’ensemble des règles qui fixent les condition de la navigation aérienne dans l’atmosphère terrestre (par opp. au droit spatial) et ses utilisations civiles. Dans ce cadre il définit. Le milieu où se déroule la navigation : espace aérien ( non le droit spatial) Les appareils utilisés = aéronefs Personnes et biens transportés (leurs droits) Les effets juridiques des déplacements par air (bruit, bang…) C’est un droit jeune, international, transversal, il touche : Droit commercial convention Varsovie + protocole de Lahaye. Droit pénal convention de Tokyo. Droit international privé Ex IATA( association internationale de droit privé) Droit civil aérien hypothèque sur aéronefs. Droit international public accords bilatéraux. Convention de droit public : Convention de Paris (1919). Convention de Chicago (1944). Convention de droit privé : Convention de Varsovie (1929) + protocole de Lahaye (1955). Convention de Guadalajara. Protocoles additionnels de Montréal (1,2 et 4). Convention de Rome 1952. Conventions de droit pénal : Convention de Tokyo sur les infractions pénales et autres actes survenus à bord (1963). Convention de Lahaye sur la capture illicite d’aéronefs (1970). Convention de Montréal pour la répression d’actes illicites contre l’aviation civile(1971). Protocole de Montréal pour la répression d’actes illicites dans les aéroports (1988). Convention de Montréal pour le marquage d’explosifs (1991). CONVENTIONS INTERNATIONALES DE DROIT PENAL Convention de Tokyo (1963) Relatives aux infractions pénales et autres actes commis à bord L’état d’immatriculation est compétent juridiquement pour connaître des infractions commises à bord, et une autorité complémentaire est accordée : Pour états ayant subi effet sur leur territoire, Lorsque l’auteur ou la victime en a la nationalité, Lorsque l’auteur se trouve sur leur territoire, Lorsque la sécurité publique est compromise. 1. Les états doivent restituer la maîtrise de l’aéronef à son CDB légitime pour poursuivre le vol, 2. Le débarquement de l’auteur doit être facilité si le CDB l’exige, 3. La détention et la rétention de l’auteur présumé est obligatoire, 4. L’extradition de l’auteur n’est pas obligatoire, 5. La capture illicite de l’aéronef n’est pas définie, et n’est pas considérée comme un crime au sens du droit international, ART 11 6. Les motivations à caractère politique ou religieux ou racial sont exclues de la convention. POUVOIRS DU C.D.B : RESPONSABILITE : responsable de l’exécution de la mission dans les limites du règlement POUVOIR : hiérarchique sur les autres membres d’equipage général sur les passagers et le fret faculté de débarquer pax ou chargement Patrimonial CDB consignataire de l’appareil peut engager dépenses et personnel pour réussir sa mission La convention de TOKYO définit les pouvoirs du CDB "depuis la fin de l'embarquement, toutes les portes fermées, jusqu'au moment où l'1 de ces portes est ouverte en vue du débarquement, et en cas d'atterrissage forcé, jusqu'à prise en charge par les Autorités d'un Etat". - Si le C.D.B. croit qu'une personne a commis ou est sur le point de commettre une infraction pénale ou un acte visé par la convention, il peut prendre toutes les mesures (y compris la contrainte) nécessaires pour garantir la sécurité, maintenir le bon ordre et la discipline, remettre la personne aux autorités compétentes ou la débarquer. Il peut pour cela requérir ou autoriser l'assistance de l'équipage, demander (sans l'exigence) ou autoriser celle des passagers, les uns et les autres pouvant par ailleurs prendre toutes mesures préventives raisonnables pour garantir la sécurité. Le C.D.B doit informer les Autorités de l'état ou il doit atterrir de toutes les mesures prises. S'il s'agit d'un acte compromettant la sécurité, le bon ordre ou la discipline, le C.D.B peut, s'il l'estime nécessaire, débarquer l'auteur de cet acte sur le territoire de touteEtat. S'il s'agit d'1 infraction pénale grave, il peut remettre l'auteur aux autorités de toute Etat partie à la convention, avec preuves à l'appui. Les mesures de contrainte cessent au-delà de tout point d'atterrissage, sauf si les autorités d'1 Etat non partie à la convention refusent le débarquement ou si l'a/c fait 1 atterrissage forcé ou encore si la personne en cause consent à poursuivre le voyage en restant soumise aux mesures de contraintes. Le CDB le PEQ et PAX, le propriétaire de l'a/c et la compagnie exploitante ne peuvent être déclarés responsables d'un préjudice subit par la personne soumise aux mesures de contraintes prises dans de telles circonstances. Convention LAHAYE (1970) uploads/S4/ synthese-droit-aerien 1 .pdf
Documents similaires










-
85
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 01, 2023
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0876MB