382 Chapitre 8 Le tiers espace, ou la singulière éloquence du différend «La man
382 Chapitre 8 Le tiers espace, ou la singulière éloquence du différend «La manière dont se constituent ou se stabilisent les ressemblances est relative, provisoire, précaire». «[N]ous savons en commun que nous n’avons rien en commun». —Jacques Derrida1 ARTICIPANT DE L’EXPLORATION d’un protocole de recherche capital relatif à l’articulation de la connaissance dans le champ des études juridiques comparatives, ce texte s’intéresse tout particulièrement à la fabrication de l’«interface» devant permettre au comparatiste de structurer sa négociation avec le droit étranger, devenu le lieu de son désir d’altérité, après qu’il se soit convaincu (de façon d’emblée stigmatisée par les positivistes) qu’un tel droit recèle une pertinence significative pour des universitaires, avocats ou juges travaillant localement, tant sur le plan intellectuel que normatif — certes pas en tant que droit obligatoire, mais bien comme information judicieuse ou, mieux, en tant qu’autorité persuasive2. Il me paraît utile de préciser, sans plus tarder, que la configuration de l’«interface» par le comparatiste intervient alors même que celui-ci sait, quelqu’indéfectible défricheur se fasse-t-il, qu’aucun droit étranger ne saurait donner lieu à la re-présentation qu’il convoite, sauf au moyen d’une médiation par l’entremise d’une écriture toujours déjà inadéquate. Ainsi le comparatiste admet-il qu’il n’y a jamais d’adéquation entre un énoncé judicatif de sa part et le droit étranger, aucune formulation ne pouvant effectuer un transfert tel quel d’un contenu sémantique préalablement constitué. Puisqu’il tente de restituer des signifiances au moyen de mots dont il a compris qu’ils échoueront, le comparatiste élabore cette «communité» — cette «comme-une- unité», qui n’est donc pas une unité —, tout en réalisant qu’il ne saurait jamais que 1Jacques Derrida, Politique et amitié, sous la dir. de Michael Sprinker, Galilée, 2011 [1993], p. 112 [ci- après Politique]; Jacques Derrida et Maurizio Ferraris, «Il gusto del segreto», trad. de Maurizio Ferraris, Bari, Laterza, 1997, p. 52 [«sappiamo, in commune, di non avere nulla in commune»]. La citation est de Derrida. 2D’un point de vue strictement local, le droit étranger ne vaut pas, même en tant que «droit». Cf. Peter Goodrich, «Interstitium and Non-Law», dans Methods of Comparative Law, sous la dir. de Pier Giuseppe Monateri, Cheltenham, Elgar, 2012, pp. 213-29. P 383 construire ou, plus justement, inventer ce droit étranger qui l’occupe. (Que je rappelle que, dans une perspective étymologique, l’idée d’«invention» rend compte de ce que le comparatiste trouve et crée le droit étranger tout à la fois, c’est-à-dire qu’il le découvre et le façonne simultanément.) A la réflexion, ce que le comparatiste français nomme «le droit anglais» ou «le droit brésilien» dans son rapport, c’est donc ce qu’il inscrit comme tel en des mots qu’il choisit et au moyen de phrases qu’il structure lui-même, après avoir rassemblé des «données» à partir de son accumulation nécessairement sélective des informations disponibles dans la sphère publique, de son appréhension inévitablement partiale de la documentation amassée et de son entendement incontournablement différentiel des passages analysés3. Tout au long de sa démarche, le comparatiste se rend tributaire des opinions d’individus qu’il est disposé à considérer comme des experts de ce droit étranger qui le retient, même s’il n’indique guère comment il en arrive à estimer que tel auteur plutôt que tel autre doit être jugé à titre de source fiable de connaissance, alors qu’étant lui-même d’ailleurs, il n’est tout simplement pas en mesure de s’afficher à titre de garant. Une fois qu’il aura trouvé des textes qu’il juge dignes de sa confiance, il est rare que le comparatiste ira beaucoup plus loin et qu’il entreprendra, par exemple, de mettre ses sources à l’épreuve en décidant d’examiner les autorités sur lesquelles les textes rassemblés se fondent, voire d’évaluer les autorités sur lesquelles s’appuient ces autorités mêmes. L’impératif de production d’information pesant de tout son poids, le comparatiste se contentera, la plupart du temps, d’utiliser la documentation à sa portée plutôt que de l’interroger. En d’autres termes, il se satisfera de la configuration d’un régime de crédibilité a minima. Le fait que, pour des raisons participant largement d’un souci d’efficacité, peu d’énoncés donnent lieu à une vérification rigoureuse des écrits, dans un cadre où l’écriture comparative s’appuie pourtant au premier chef sur des écrits, conduit à se demander s’il ne serait pas plus juste de traiter de croyance, plutôt que de connaissance, pour marquer l’issue de la négociation du comparatiste avec le droit étranger qui le sollicite. 3Je rappelle le mot de Hans-Georg Gadamer, qui retient qu’«on comprend autrement, si jamais on comprend»: Wahrheit und Methode, 5e éd., Tübingen, J.C.B. Mohr, 1990, p. 302 [les italiques sont de l’auteur] («man [versteht] anders [...], wenn man überhaupt versteht»). Pour un examen de ces considérations d’ordre épistémologique, voir Pierre Legrand, «Foreign Law: Understanding Understanding», (2011) 6 Journal of Comparative Law 67. 384 En tout état de cause, il ne saurait faire de doute que les affirmations du comparatiste au sujet du droit étranger sont, pour une part non négligeable, le résultat d’incidents fortuits (y compris de heureux hasards) et d’accommodements, voire de manœuvres désordonnées. Il découle de ces observations une conclusion dont l’importance ne saurait être exagérée, à savoir que le comparatiste est impliqué de part en part dans la confection du texte qu’il proposera, en fin de compte, à titre de reprise loyale du droit étranger. Ainsi — alors même qu’il cherche «sa» langue dans «la» langue («son» vocabulaire, «sa» syntaxe, «sa» cadence aussi) — l’écriture du droit étranger qu’il met en avant interrompt, segmente et taille, canalise, condense. Les chemins d’écriture qu’il emprunte — qui impliquent des détours, des fausses pistes, des dérives, des égarements — passent notamment par le choix d’un registre énonciatif, c’est-à-dire d’une attitude face aux textes et au monde. Ces processus d’appropriation et d’individuation, de structuration de la singularité, renvoient à l’engagement de l’interprète: ils annoncent ainsi un positionnement éthico-discursif. A la réflexion, le droit étranger qu’énonce le comparatiste constitue «son» entendement et «sa» narration de ce droit étranger (les guillemets voulant rappeler que le comparatiste s’est incorporé de la socialisation-en-droit, un entour constitutif d’identité dont il ne saurait plus se détacher, ce qui veut notamment dire qu’il y a de l’autre en lui). Il s’agit ainsi d’un droit étranger qui aura été tamisé par le comparatiste-en-situation, soit d’un droit étranger qui sera devenu, ni plus ni moins, son droit étranger. Et ceci signifie notamment que ce droit étranger qu’écrit le comparatiste ne lui est pas si étranger qu’on le suppose habituellement, car le droit étranger du comparatiste, c’est ce qui reste de ses successives opérations de rapprochement, de soustraction, de retranchement et d’altération. Oui. L’altérité juridique est toujours déjà vouée à l’altération4. (On aura compris qu’il convient, dès 4Alors que le comparatiste se transporte loin de lui-même en direction du droit étranger, qu’il se déplace en dehors de soi, alors que le droit étranger devient le véhicule de son expansion, il crée un espace de coexistence, un intérieur, une solidarité, une sphère d’intimité englobant ce droit étranger même. Selon les mots de Peter Sloterdijk, la mission exotérique du comparatiste se résout en tant qu’«acte de constitution de sphère»: Peter Sloterdijk, Sphären, vol. I: Blasen, Francfort, Suhrkamp, 1998, p. 14 [«eine Sphärenbildung»]. Cette situation, qui n’a rien à voir avec «la disposition autoritaire que l’on a sur un sujet par le biais d’une masse objective manipulable» (id., p. 40 [«(einer) bloß herrschaftliche(n) Verfügung eines Subjekts über eine manipulierbare Objekt-Masse»]), implique que le texte 385 lors, de faire son deuil de l’idée même d’une comparaison objective, puisqu’aucune écriture comparative — aucune narration — ne saurait légitimement prétendre au statut de transcription indifférenciée en vertu duquel elle n’aurait fait que rapporter5.) Pour en revenir à l’élaboration par le comparatiste de la «communité» des droits qu’il inclut dans sa comparaison, il n’est en rien excessif de parler d’un geste comparatiste primordial. D’ailleurs, on peut estimer que le comparatiste se façonne en tant que comparatiste non seulement en rejetant l’autarcie et la fixité d’entendements locaux et (soi-disant) homogènes du droit, quoique sans pourtant nier la force singulière et l’assurance de chaque droit, mais bien en inventant un lieu sémantique croisé qui, ne dupliquant ni l’un ni l’autre des droits qu’il étudie, constitue un site énonciatif disputant ses territoires balisés à chacun d’eux, qui se fait donc l’expression d’une glocalisation par ailleurs. (Ainsi non seulement le comparatiste invente-t-il le droit étranger, mais il invente l’«interface» dans laquelle il le transporte aux fins de comparaison. Autrement dit, le comparatiste fait de l’invention au carré.) de droit étranger «s’éveille à sa destinée» de se voir attribuer un sens au moyen de l’insufflation de la vie interprétative (id., p. 35 [«zu seiner Bestimmung (…) erwach(en)»]). Il intervient ainsi un éveil du texte à la vie animée, de telle sorte qu’il peut être envisagé comme «un canal pour les insufflations prodiguées par un inspirateur»: id., p. 39 [les italiques sont de l’auteur] («[als ein] Kanal für Einblasungen durch einen Inspirator»). Mais une réciprocité est à l’œuvre, car le texte de droit étranger institue également le comparatiste. En d’autres termes, «dès qu’est accompli le déversement du souffle vital dans l’autre forme, androïde, s’établit une uploads/S4/ tiers-espace.pdf
Documents similaires
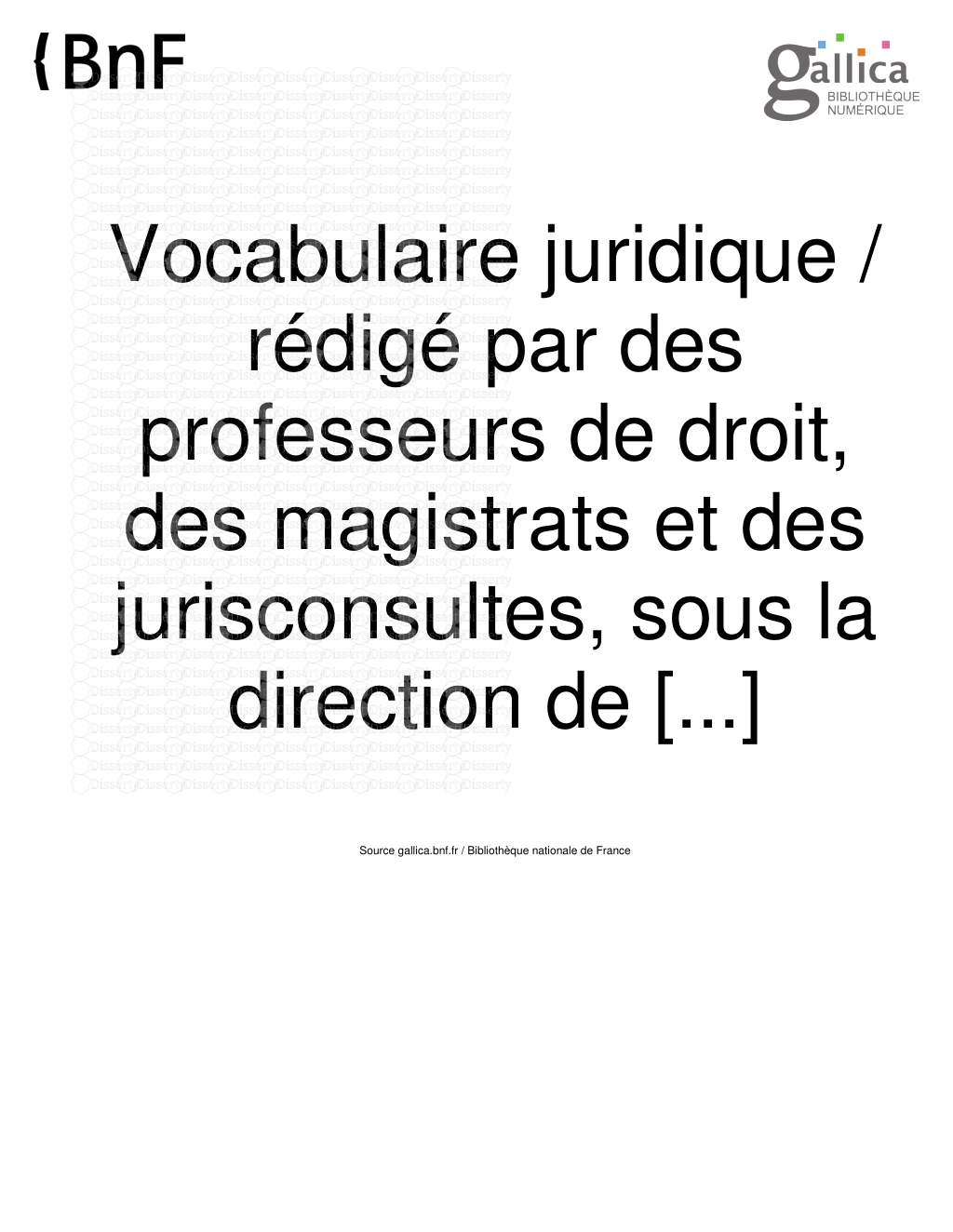









-
88
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 03, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2241MB


