1 L’INFLUENCE DU DROIT DE LA CONCURRENCE SUR LE SYSTEME ADMINISTRATIF MAROCAIN
1 L’INFLUENCE DU DROIT DE LA CONCURRENCE SUR LE SYSTEME ADMINISTRATIF MAROCAIN La réalité marocaine oscille entre deux modes de fonctionnement à la fois traditionnel et contemporain : D’une part la volonté des pouvoirs publics à mobiliser des conceptions modernes comme la transparence, l’impartialité, la bonne gouvernance, la démocratie et l’Etat de droit ; et d’autres part l’incapacité des institutions traditionnelles à incorporer le droit de la concurrence dans le cadre d’un dispositif normatif moderne au sein du corpus juridique général. Ouvert à l’économie mondiale, respectueux de la légalité Internationale et confronté à une forte demande de modernité, le Maroc s’est inscrit dans une mise à niveau générale de son économie et de son administration, qui tente de répondre aux standards de la modernité internationale. En revanche, une tradition étatique construite sur les conflits entre les influences légales rationnelles et les héritages coutumiers s’accommode mal avec la globalisation de l’économie et du droit. Même si le changement de règne a entamé des réformes dans le sens de la modernisation, notamment par le code de la famille, l’ouverture de grands chantiers d’infrastructure, l’incitation à l’investissement ou l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH), le besoin doctrinal en matière de concurrence1 reste nécessaire. Les différents acteurs institutionnels qui contribuent au développement économique et politique du Maroc n’ont toujours pas élaboré une conception de la concurrence conforme aux objectifs de modernité. Les décideurs continuent de croire que la concurrence est une question sectorielle alors que celle-ci se positionne comme un ordre juridique entier qui oriente tous les aspects de l’économie. Ainsi l’intelligibilité du paradigme concurrentiel dans l’ordre juridique marocain est confrontée à la nature du système politique et administratif : La légitimité politique de l’action publique et la légitimité technocratique de l’intervention administrative alimentent un ordre unique et complexe qui cache plusieurs lacunes et se caractérise par une opacité contraire aux fondements du droit de la concurrence. La première légitimité renvoie aux environnements démocratiques nourris par les différentes institutions représentatives et les structures de la société civile marocaine ; et la seconde renvoie à une vision rationnelle de la vie publique conforme aux standards de bonne gouvernance et 1 A l’exception du travail conduit par l’Amicale des Ponts et Chaussées et rassemblé dans un livre intitulé : «Etat, Régulation et Autorités Administratives Indépendantes», Acte du colloque international 2003, Amicale des Ingénieurs des Ponts et Chaussées du Maroc. 2 structuré sur la base du modèle administratif français. Ainsi le processus de décision démocratique et la continuité de l’administration en tant que garantie du fonctionnement de l’Etat sont deux aspects homogènes qui convergent dans le système légal-rationnel que le droit de la concurrence tente de développer. En revanche, les résistances de l’aspect coutumier de l’action politique et de la tradition administrative marocaine représentent des difficultés pour l’intégration des normes de la concurrence et la culture de transparence qui le sous tend. Il est donc nécessaire d’examiner l’évolution du droit de la concurrence par rapport au fonctionnement des institutions politiques, administratives et judiciaires marocaines (§ I). Après avoir décrit l’évolution du droit, l’évaluation du comportement de deux agences de régulation dans le cadre de la régulation sectorielle de la concurrence, l’Agence Nationale de Régulation des Télécommunications et la Haute Autorité de la Communication et de l’Audiovisuel, permettra d’élucider empiriquement la corrélation entre la réalité politique et administrative du Maroc et la nécessaire transformation du cadre légal censé réglementer le passage à une économie moderne (§ II). Cette analyse amènera à l’observation des difficultés qui accompagnent l’introduction du droit public de la concurrence2 dans le système administratif marocain (§III). Ces obstacles résident dans l’aptitude à conjuguer efficacité, transparence et autonomie avec une approche traditionnaliste concentrée, bureaucratique voire patriarcale de l’action administrative, peu rompue à l’application objective de la règle de droit. Cette démonstration essaye d’établir un lien entre la mise en œuvre du droit de la concurrence et la modernisation administrative du Maroc, à travers cette confrontation entre la mondialisation de la modernité et les spécificités des traditions administratives. § I ) – Confrontation du droit de la concurrence et du système administratif marocain : Donnant un sens à la modernité et au modèle de régulation qui l’accompagne, la globalisation du droit consacre la concurrence comme condition essentiel du développement. En tant qu’outil indispensable à cette aspiration, le droit de la concurrence a vu le jour au Maroc par la loi sur les marchés publics et la création des agences de régulation. La révision constitutionnelle du 13/09/1996, ayant introduit dans l’article 15 le concept de « liberté d’entreprendre », a voulu affirmer juridiquement la volonté des réformes économiques par le jeu de la concurrence. Cette affirmation s’est accompagné de l’établissement de Zones de Libre Echange avec l’Union 2 Jean Marie Rainaud : « Le droit public de la concurrence » ; Economica, 1987 3 Européenne et les USA et différents partenariats bilatérales, d’engagements souscrits auprès de l’Organisation Mondiale du Commerce et de la mise en œuvre de la concurrence dans les secteurs des télécommunications, de l’audiovisuel ou des valeurs mobilières. Ce sont autant d’indices qui consacrent cette volonté de s’inscrire dans l’économie concurrentielle internationale. C’est sur la base de la « liberté d’entreprendre », reprise dans la constitution marocaine, que fut adoptée la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, entrée en vigueur le 06/07/2001. Dans son préambule, la loi 06/99 a pour objet « de définir les dispositions régissant la liberté des prix et d’organiser la libre concurrence. Elle définit les règles de protection de la concurrence afin de stimuler l’efficience économique et d’améliorer le bien être des consommateurs. Elle vise également à assurer la transparence et la loyauté dans les relations commerciales ». Cette loi a voulu affirmer un fonctionnement transparent de l’économie appelant à la mise en oeuvre de mesures assurant une concurrence loyale. Aussi le dahir n°1-97 du 7 août 1997 portant loi n° 24-96, ainsi que les décrets promulgués le 25 février 1998 et le 2 août 1999, sont des textes fondamentaux pour le droit de la concurrence marocain à travers la constitution d’une véritable charte pour les télécommunications. Les principes de «transparence» que véhicule le système concurrentiel auront de l’influence sur l’évolution de l’Etat, par l’immersion de la notion de «régulation» dans sa vision de l’intervention publique. Ayant pour principale référence le modèle juridique et administratif français, notamment l’ordonnance de 1986 sur la concurrence et les prix ou la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques de 2001, la dimension moderne de l’administration marocaine a pris l’entière responsabilité dans l’absorption du droit de la concurrence au sein de l’ordonnancement traditionnel. Par conséquent la transposition du droit français marque une étape dans la réforme visant à mettre à niveau le droit marocain : Avec l’entrée en vigueur de la loi sur la concurrence, ce sont de nouvelles valeurs que le pouvoir marocain veut promouvoir dans l’environnement juridique et la culture économique. Dans sa définition, une politique de la concurrence se résume à un principe simple : Protéger le fonctionnement de la concurrence par un système de coercition, même si la notion de compétition et les sanctions qui la protégent prennent des nuances variées. Par exemple, les sanctions qui accompagnent le droit de la concurrence peuvent être d’ordre administratif ou pénal3. Aussi des interrogations peuvent appuyer le caractère nuancé de l’ordre concurrentiel : Quels types de sanctions, administratives ou pénales, pour quelles pratiques anticoncurrentielles? 3 Par exemple le « délit de favoritisme » dans le droit pénal des marchés publics. 4 Pour répondre à ces questions, la loi ne suffit pas, car d’une part la réalité administrative est déterminante et dépend de l’avis de l’un des départements chargés d’appliquer la loi, et d’autres part la justice marocaine est peu rompue au droit de la concurrence. Ainsi les effets de la nouvelle loi sur la concurrence et les différents textes qui développent le droit concurrentiel au Maroc dépendront du degré d’implication de l’administration et de la justice. Des notions juridiques fondamentales retenues par une politique concurrentielle claire devront être délimitées. Ainsi doivent être précisées les prérogatives de puissance publique et le degrés de sévérité et de souplesse dans l’application du droit public de la concurrence ou de la réglementation du marché de manière générale : Savoir si le renforcement du droit pénal pour la relation de la sphère publique avec la concurrence est nécessaire (entreprises publiques, Etat, collectivités territoriales) ou si l’option des sanctions administratives pour les opérateurs économiques privés est efficace (petites et moyennes entreprises, entreprises nationales ou multinationales). Ainsi l’application efficiente de la loi 06/99 et des différentes références qui construisent le droit de la concurrence marocain dépendra de la capacité d’organisation et de création des juristes et administrateurs marocains ainsi que l’élaboration d’une culture nouvelle dans les environnements économiques et politiques. La création d’un Conseil de la Concurrence de direction, à vocation horizontale, était censé résoudre implicitement les conflits de compétence qui caractérisent la nature opaque de l’action administrative marocaine (par exemple la problématique de la responsabilité administrative et délimitation des prérogatives au sein de la haute fonction uploads/S4/bendjelloun-concurrence-maroc.pdf
Documents similaires









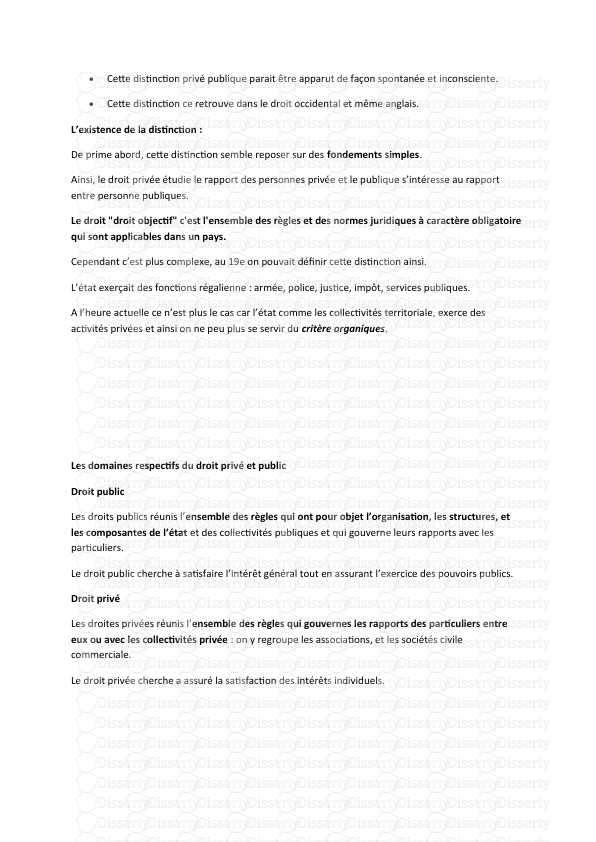
-
238
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 08, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0860MB


