souffles revue maghrébine littéraire culturelle trimestrielle directeur abdella
souffles revue maghrébine littéraire culturelle trimestrielle directeur abdellatif laâbi s i è g e social 4, a v e n u e pasteur rabat m a r o c c e p 989.79 - tél. 235-92 Comité d'action : A. bouanani ; B. jakobiak ; E. M. nissaboury ; A. stouky. M. alloula ( A l g é r i e ) ; A. laude ( E u r o p e ) . sommaire situations abdellatif laâbi . abdallah stouky réalités et dilemmes de la culture nationale l'intellectuel du tiers-monde et l'édification nationale textes ahmed bouanani abdelaziz mansouri karl - heinz wiessner bernard jakobiak positions el mostafa nissaboury entre universalisme et au pays de la mémoire étape 2 cauchemar 1 déchaîné l'enchaîné (extrait) f. belkahia; m. chebaa; m. melehi abdellatif laâbi folklorité des peintres protestent la presse nationale entre le business et le dogme chroniques jeanne-paule fabre réflexions sur une abdellatif laâbi bibliographie de la femme maghrébine à propos du « polygone étoile » de kateb yacine d'un séminaire l'autre extraits de correspondance n u m é r o 4 q u a t r i è m e t r i m e s t r e 1966 B U L L E T I N I r A B O N N KM E N T N O M P R E N O M A D R E S S E V I L L E P A Y S Veuillez m'inserire pour abonnemcnt(s) à la revue S O U F F L E S . T A R I F S D ' A B O N N E M E N T Abonnement simple Abonnement de soutien Afrique du N o r d 10 DH à partir de 50 DH Etranger 20 DH à partir de 50 DH Somme que je verse à voire C.C.H. : Souffles. Rabat. 989-79, ou que je vous adresse par mandat-poste ou chèque bancaire à l'ordre de « SOUFFLES » — 4, Avenue Pasteur — RABAT — Maroc. A N O S L E C T E U R S V o u s avez assisté a v e c nous à la création de « S O U F F L E S ». à son évolution. V o u s l'avez soutenue. La première année de la revue se termine a v e c ce quatrième numéro. Les abonnements sont une condition primordiale pour assurer à S O U F F L E S une stabilité matérielle indispensable pour sa continuité, pour la poursuite des buts qu'elle s'est iixés. Abonnements, diffusion directe autour de vous, nouveaux sou- tiens nous aideront à pousser encore plus loin notre action, à étoffer la revue. S O U F F L E S a permis de regrouper plusieurs cellules de jeunes écrivains et d'artistes. Elle a été le centre de débat d'un certain n o m b r e de remises en question et de revendications. La matière ne nous m a n q u e pas. Elle est souvent excédentaire. M a i s les con- ditions matérielles d a n s lesquelles nous travaillons, les rigueurs de notre petit budget ne nous permettent p a s pour l'instant de franchir le c a p d'un nombre de p a g e s restreint. N o u s vous faisons a p p e l pour q u e vous dépassiez une attitude de sympathie ou de lecture curieuse. N o u s a v o n s besoin de votre participation militante pour a b o r d e r la seconde année, afin q u e notre expérience n'avorte p a s uniquement pour u n e question d'ar- gent. N o s responsabilités sont partagées d a n s la mesure où nous sommes tous concernés par la matière et l'action amorcée d a n s cette revue. N o u s sommes convaincus q u e vous répondrez à notre a p p e L S O U F F L E S réalités et dilemmes de la culture nationale par abdellatif laàbi LA CULTURE NATIONALE. DONNEE ET EXIGENCE HISTORIQUE Concept polémique, revendication totalitaire, superstructure racialisée d'un nationalisme étiiqué. la notion de culture nationale a véhiculé depuis quelques années à la faveur de diverses prises de position et de multiples terminologies un certain nombre d'altérations et de méprises. A cet égard, l'héritage de l'œuvre fanonienne qui n'avait laissé planer aucune ambiguïté sur les fondements du problème n'aura servi effectivement que d'une manière fragmentaire. C'est surtout la partie d'analyse psycho-affective et la partie de contestation de l'ordre colonial qui fut repris*. Les intuitions de Fanon n'ont pas eu de post-face, ils n'auront pas eu une continuation normale qui aurait consisté à compléter les schémas fano- niens, à les contester pour certains et surtout à les exhaustiver dans les nouveaux contextes des indépendances et des décolonisations. L'œuvre de Fanon a eu des admirateurs ébahis et élogieux (encore un qui a tout dit) ou des détracteurs mus par une rancune de complexés, ceux qui n'auront pas . digéré • la consc-mmation d'un système qui leur assurait sécurité morale et privilège matériel. Entre temps des mutations spectacu- laires ont affecté les réalités économiques, sociales, politiques et cultu- relles des pays du Tiers-Monde. La décolonisation réelle, partielle ou épidermique a provoqué l'avorte- ment d'un homme nouveau, hébété par les prises de pouvoir et les respon- sabilités nouvelles. Des micro-castes et micro-classes se sont agglutinées dans l'improvisation. Dans le chœur des supercheries de libération et des . nouveaux > rupports avec les anciennes hégémonies, les intellectuels pris de cours ont accordé des interviews (généralement aux journalistes étrangers • spécia- listes . du Tiers-Monde), ont écrit des articles natifs. De partout s'est élevée une rengaine : l'obsession de la définition donnant lieu à la mise au point de formules-types, fatras syncrétique de terminologies de tous bords. Pour nous cantonner uniquement à l'Afrique du Nord, et si nous met- tons de côté certains écrits lucides de M. Lâcherai, (1) aucune pensée construite n'est venue cerner le problème et le situer dans son cadre actuel, éclairé par les nouveaux rapports. On s'est tenu à des points de vue de spécialistes, à des polémiques sectaires, à des convictions confessionnales ou tout simplement au mot d'ordre de son parti (2). A chacun sa révolution. Pendant ce temps, des sec'eurs culturels entiers, traditionnels ou modernes, sont en train d'être abâtardis ou utilisés par une politique incons- ciente du brûlis. A la base de toutes ces inflations, des méprises graves auxquelles la notion de culture nationale risque de donner lieu encore si nous ne rendons pas compte au départ du contexte où elle a été formulée. Originellement, cette formule fut avancée depuis la fin de la seconde guerre mondiale par des écrivains et penseurs du Tiers-Monde ainsi que par des intellectuels occidentaux d'avant-garde, qui avaient déclenché un vaste mouvement de recherche et d'analyse sur les problèmes humains et culturels des pays africains et autres aux prises avec la colonisation. Le terme de culture nationale faisait partie d'une terminologie d'ensemble élaborée selon ces nouvelles exigences. Nous l'appellerons : terminologie de la décolonisation. Le phénomène colonial a été comme l'on sait, l'aboutissement logique d'un processus d'évolution du capitalisme européen. Fondé au départ sur l'expansion territoriale, l'exploitation économique qui en est la profonde motivation, le colonialisme sentira plus tard la nécessité de justifier cette politique d'oppression en lui conférant des assises humanitaires et culturelles. L'Europe des Lumières, par la suite l'Europe scientiste, positiviste, en pleine possession d'un humanisme triomphant va avoir l'illusion d'être détentrice de vérités, de valeurs universelles, applicables à tous les peuples. L'anthropocentrisme européen trouvera selon la logique du système des théoriciens, des idéologues et fera donc appel à la rigueur scientifique pour acquérir le droit de ln légitimité. Ainsi l'exploitation matérielle, l'exploitation du moteur humain seront imbriquées dans une politique manichéiste avec l'impérialisme culturel. Après la suprématie militaire et la technique, la science occidentale nous colonisa à son tour. Aussi et à ce niveau, il me semble que toute démarche de décoIonUation culturelle doit passer par une remise en question du statut des sciences humaines dans le contexte colonial. Tenons-nous en pour l'instant aux mutations spécifiquement culturelles que le système a pu opérer au sein des sociétés colonisées. L'héritage fanonien se révèle là d'une grande profondeur â expliciter. On sait que l'impérialisme culturel va se traduire par la tentative du colonisateur de greffer sur le colonisé les éléments importés de sa culture, éléments étrangers aux habitudes mentales et au psychisme de ce dernier. Cette violente greffe visait la provocation d'un abime échafaudé entre l'individualité du colonisé et tout ce qui pouvait le rattacher à une culture propre, à une mémoire propre. Cette politique présentée comme une salva- tion ne portait d'ailleurs pas sur toute une population Le colonisateur, en créant des écoles modernes a voulu avant tout former quelques cadres autochtones subalternes. Pour l'immense majorité des populations, ce luxe (1) Article publié dans un numéro «'Esprit, repris par l'auteur uploads/Finance/ souffles-04.pdf
Documents similaires








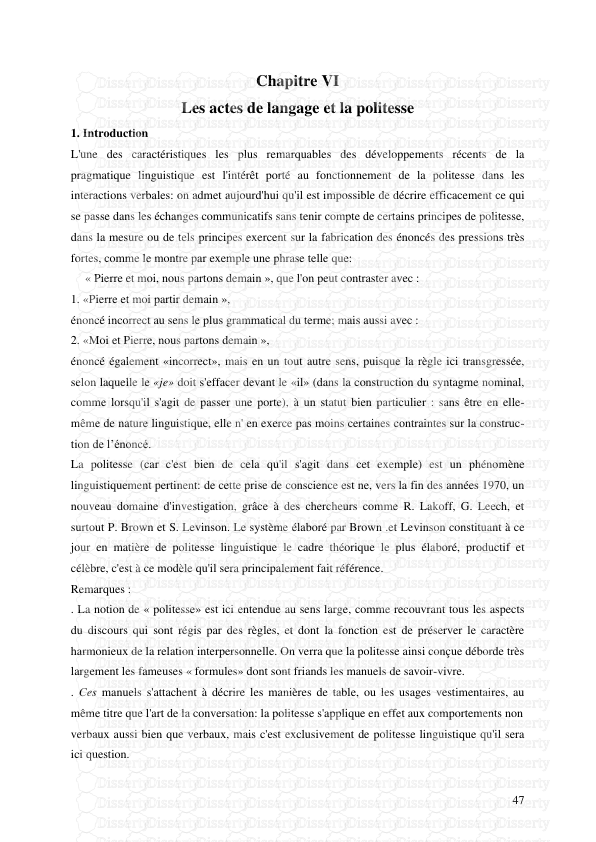
-
50
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 13, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.5397MB


