138 Le programme « Villes sans bidonvilles » sous le prisme de la durabilité so
138 Le programme « Villes sans bidonvilles » sous le prisme de la durabilité sociale : Lectures et analyses Imane Bkiri, Architecte-géographe, enseignante chercheure à l’Ecole Nationale d’Architecture de Fès, chercheure associée au Centre Jacques Berque. Sanae Aljem, Architecte-urbaniste, enseignante chercheure à l’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat. Résumé Le Programme « Villes Sans Bidonvilles » (PVSB) manifeste d’une considération de l’Etat des bidonvilles en faisant de la question du logement une préoccupation majeure. Ce programme d’envergure répond à la déclaration du Millénaire des Nations unies ainsi qu’aux objectifs du développement durable par l’assurance d’environnements durables pour les populations. Cet article questionne la composante procédurale du PVSB et ce, à travers l’analyse de sa mise en œuvre sous le prisme des critères de durabilité sociale. Mots clefs : Bidonvilles, durabilité, sociale, procédure, capacités, acteurs, relogement, Maroc. Introduction Depuis la publication en 1987 du rapport de la Commission mondiale des Nations Unies sur l'environnement et le développement (la Commission Brundtland), le concept de "développement durable" est au centre des préoccupations majeures à l’échelle planétaire. Le rapport Brundtland définit trois « piliers » du développement durable qui sont la croissance économique, la cohésion sociale et la préservation de l’environnement naturel. Cependant, les débats autour du développement durable ont tendance à être orientés vers les aspects environnementaux et économiques. Le « bien-être » social étant souvent implicitement considéré comme une conséquence du bien-être économique et/ou écologique (Levy, 2001). La prise de conscience de la problématique sociale a démarré au Maroc dans les années 2000 (Catusse, 2005), manifestée par un redéploiement de l’action de l’État (Hibou, 1998) par lequel « le “social” devient le sujet d’un problème public, énoncé par des acteurs pluriels, en articulation avec la définition d’un intérêt collectif » [Catusse, op. cit.]. C’est ainsi qu’un « compromis social » est né (Essahel, 2011), marqué par de nouveaux rapports entre les structures institutionnalisées et les « citadins ordinaires » (Signoles, 1999) et matérialisé par l’encouragement d’actions pionnières en faveur de la lutte contre la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie. Dans cette nouvelle philosophie du développement, ont été lancés deux programmes phares : le Programme Villes Sans Bidonvilles (PVSB) en 2004, et l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en 2005, qui ont pour finalité l’amélioration des conditions de vie des populations, la réduction des inégalités et la lutte contre l’exclusion. Cette prise en considération du facteur social dans un programme ambitieux tel que celui du PVSB peut-elle être qualifiée de durable ? 139 Selon le dictionnaire du développement, « la durabilité sociale implique de remplir les besoins sociaux, économiques et culturels des communautés affectées par une initiative de conservation et d'assurer les conditions (par exemple finances, technologie, autorité politique et organisation, et consensus sociaux) pour maintenir les pratiques de conservation » [Brodhag et al., 2004]. La démarche de durabilité sociale ouvre ainsi une large palette de débats non seulement sur la territorialisation des politiques publiques dédiées à l’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées, mais également sur les modes de gouvernance entrepris à l’échelle locale ainsi que les nouvelles configurations sociales qui en résultent. Nous estimons que la composante procédurale est essentielle pour ces programmes visant le développement urbain et humain. Cet article a donc pour objectif d’examiner la mise en œuvre du programme VSB à travers des opérations de relogement de bidonvillois sous le prisme des critères de durabilité sociale. Il relève les apports et les contraintes de la mise en œuvre et pose la question – paradoxale – de sa durabilité sociale. Il se base sur des études empiriques qui ont été menées entre 2012 et 2016 sur des cas de projets phares dans les deux villes de Rabat et Casablanca1. Afin de préciser notre problématique, nous nous basons sur trois constats et définitions : - Le PVSB, s’inscrit dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement des Nations- Unies2 - et fait partie du programme mondial Cities Without Slums ayant pour but l’éradication de tous les bidonvilles du Maroc. - Le développement durable, selon le PNUD, ne peut se faire sans transformer radicalement la façon par laquelle sont construits et gérés les espaces urbains3. - Les débats, relativement nouveaux, portant sur la réduction des inégalités et sur la dimension sociale du développement durable exigent des critères, jugés nécessaires, portant essentiellement sur l’accessibilité aux biens et services, la constitution des capacités et la construction des potentialités 4(Sen, 1992), et ce, selon des principes d’équité (Dubois et Mathieu, 2002). 1. Programme Villes Sans Bidonvilles : un processus formel à effet performatif Le programme Villes Sans Bidonvilles a pour but d’éradiquer les bidonvilles et d’offrir de meilleures conditions de vie aux populations précaires et ce, par de nouveaux modes d’intervention : le relogement (transfert vers des immeubles), le recasement (production de lots destinés à la construction) et par le biais d’actions d’électrification, de viabilisation, et d’assainissement sur le site même. Ce programme se base sur une démarche nouvelle en son genre, à travers la désignation de nouveaux modes de conduite par la mise en œuvre de dispositifs originaux: structures ad-hoc, nouveaux partenariats publics-privés, régis par de nouvelles conventions à l’échelle centrale et de 1 Ces deux cas d’étude qui concernent deux bidonvilles : Douar El Kora à Rabat et Douar Shneider à Casablanca sont respectivement tirés des travaux de thèse de Imane Bkiri et de Sanae Aljem dont la première porte sur la Politique de la ville et la deuxième sur la gouvernance des projets urbains. 2 Il s’inscrit plus précisément dans l’Objectif n°7 « assurer un environnement durable », cible 11 « améliorer sensiblement d’ici 2020, la vie d’au moins 100 millions d’habitants de taudis ». 3 Il s’inscrit plus précisément dans l’Objectif n°11 « villes et communautés durables », Programme des Nations Unies pour le Développement. 4 Nous nous réfèrerons à la vision alternative du développement d’Amartya Sen qui prône l’approche par les capacités et les potentiels. Cette approche conçue par Sen déplace le centre d’intérêt des utilités vers celui des potentialités individuelles. 140 « contrats-villes » entre différents partenaires à l’échelle locale. Cette approche singulière vient associer départements ministériels, autorités locales, institutions publiques, mais aussi le secteur privé. Chaque projet est ainsi régi par une convention spécifique qui définit les modalités d’exécution, de financement, les rôles et les attributions de chaque intervenant. La mise en œuvre de ce programme se base essentiellement sur le renforcement de partenariats institutionnels5 et le travail de proximité et l’engagement avec la population. 2. Système d’action dans le cadre du recasement des Douars El Kora et Schneider Douar El Kora est le plus grand et ancien bidonville de Rabat qui se situe dans l’aire d’aménagement de la corniche de la capitale au niveau de l’arrondissement Yaacoub El Mansour. Ce projet pilote se présente sous forme d’une opération de relogement in situ devant donner l’exemple à suivre pour le restant des projets à l’échelle nationale. El Kora est le premier projet lancé à titre « expérimental » dans le cadre du programme « Villes Sans Bidonvilles ». Il est matérialisé par un nouveau quartier doté de grandes superficies d’espaces verts et d’équipements de proximité. Il vise l’amélioration des conditions de vie de plus de 2200 ménages bidonvillois souffrant en majorité d’un grand déficit social (ADS, 2006), ainsi que le transfert des 665 commerçants bidonvillois vers une structure marchande nouvellement construite. Ce projet a fait l’objet d’une convention de relogement entre la Caisse de Dépôt et de Gestion (maitre d’ouvrage du projet) à travers sa filière, la société de développement El Kora SDEK - ultérieurement élargie et renommée Dyar Al Mansour -, la Wilaya de Rabat, le Fonds Hassan II pour le développement économique et social, le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et la commune de Rabat. La convention El Kora réunit les différents acteurs publics et privés autour d’un comité de suivi, présidé par le wali-gouverneur6, ainsi que d’un comité local7. Ce bidonville-quartier devient ainsi un territoire de l’action publique matérialisant le passage vers une logique de projet local (Béhar, 2000), alors qu’il a longtemps été gouverné, comme tant d’autres bidonvilles, « à distance » (Zaki, op.cit.). Lors de sa création, la SDEK a été chargée de démolir les baraques et d’aménager le nouveau quartier en tranches et de transférer la population vers ce dernier. Un guichet unique a été créé à ce titre, jouant le rôle d’interface entre le comité local et la population. Il est destiné à l’accueil et à la facilitation des procédures administratives liées à la démolition, à l’attribution et au transfert. Il est constitué d’agents d’autorité locale, de partenaires signataires et de prestataires de services (eau électricité, organismes de crédit). Dyar Al Mansour est représentée au quotidien par quatre membres qui assurent l’accueil de la population et le traitement quotidien des dossiers8. Les agents d’autorité locale s’occupent avec les autres partenaires du recensement, de l’accueil de la population, de l’élaboration des listes d’attribution et de la délivrance de certificat de démolition. 5 Le lancement du PVSB a enclenché de nouvelles formes de partenariats ainsi que l’implication de uploads/Geographie/ 1-pb 5 .pdf
Documents similaires
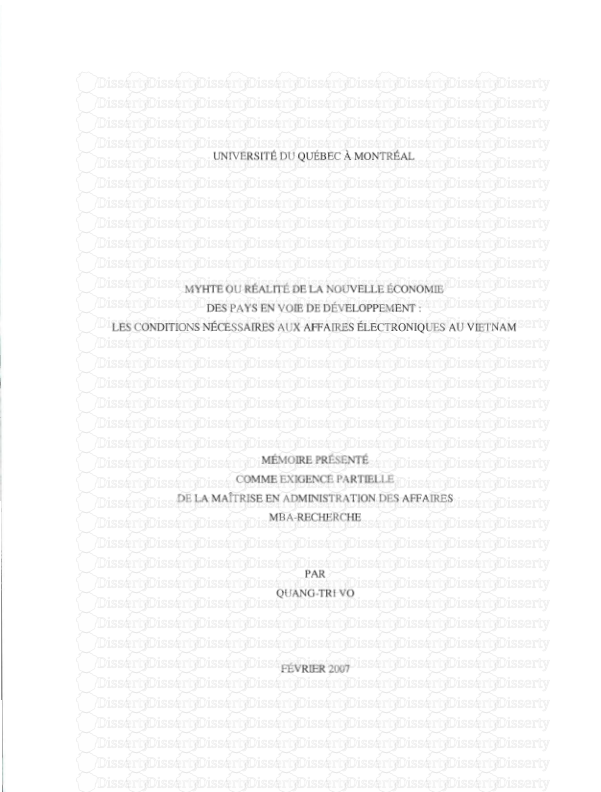









-
89
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 05, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5348MB


