Penser la littérature médiévale TD de Sophie Albert et Corinne Cooper Les cinq
Penser la littérature médiévale TD de Sophie Albert et Corinne Cooper Les cinq sens Fascicule 2 Les cinq sens entre terre et ciel (9 novembre) 1. Saint Augustin, Les Confessions (entre 397 et 401) p. 3 2. Guillaume de Saint-Thierry, De natura et dignitate amoris (12e siècle) p. 5 3. Les échelles des sens p. 7 4. Marguerite d’Oingt, Lettres IV et IV (fin du 13e siècle) p. 8 5. Rupert de Deutz, Commentaire sur le Cantique (la main et le frisson) p. 10 6. Richalm de Schöntal, Livre des révélations (début du 13e siècle) p. 11 Sens et essence de la rose : voir, sentir, toucher, goûter, entendre la rose (16 novembre) 1. Le Roman de la Rose de Guillaume de Lorris et Jean de Meung 1.1 La rose de Guillaume de Lorris p.13 1.2 La rose de Jean de Meung p.19 2. Sub rosa… La rose dans Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole de Jean Renart p.23 3. Motet du codex de Turin J.II.9 p.25 4- La fleur cachée de L’Annonciation de Francesco del Cossa p.27 5. Les fleurs de chair de Philippe Cognée p.28 Genre, pièges et attraits des sens dans la capture des bêtes et de Merlin (23 novembre) En guise d’introduction Notices du Livre du trésor de Brunetto Latini (ca. 1270) et du Bestiaire de Pierre de Beauvais (début du 13e siècle) p.29 1. Rapports de genre, pièges et attraits des sens dans les bestiaires Notices du Bestiaires de Pierre de Beauvais (début du 13e siècle) p.30 2. Un je amoureux et sa dame : parcours des sens et allégorisation courtoise (ou anti-courtoise) du bestiaire Richard de Fournival, Bestiaire d’amour (ca. 1245) p. 31 Nicole de Margival, Dit de la Panthère (fin 13e-début 14e siècle) p.33 3. Merlin en avatar de l'unicorne : appétits du mage et vertus des femmes L’enserrement de Merlin dans la Suite Merlin (vers 1225) p.37 La capture de Merlin dans le Roman de Silence (milieu du 13e siècle) p.39 Atelier d’écriture 2 (30 novembre et 7 décembre) Des documents d’appui vous seront communiqués lors de l’atelier. 15 décembre : présentation des florilèges 1 2 Les cinq sens entre terre et ciel 1. Saint Augustin, Les Confessions (entre 397 et 401) Saint Augustin naît en Afrique du Nord en 354 d’une famille romaine aisée. Formé à Carthage dans la langue et la culture latines, il se consacre à la philosophie et devient manichéen, avant de se convertir au christianisme en 386. Devenu évêque d’Hippone en 395, il commence peu après à rédiger ses Confessions. Cet ouvrage comprend treize livres au cours desquels Augustin entremêle, à l’évocation de sa conversion et de son parcours spirituel, des réflexions philosophiques et théologiques. Le Livre X est célèbre pour son développement sur la mémoire, étroitement articulé, du moins en son commencement, à la question des sens. Saint Augustin, Les Aveux, Extraits du Livre X, nouvelle traduction par Frédéric Boyer, Paris, P.O.L., 2013 (la traduction de Frédéric Boyer cherche à restituer l’expressivité du texte originel). Seigneur, je t’aime. Ta parole a transpercé mon cœur. Je t’ai aimé. Le ciel, la terre, avec tout ce qui est en eux, me disent partout de t’aimer. Ils n’arrêtent pas de dire à tous de t’aimer pour que nous soyons inexcusables de ne pas t’aimer. Plus fort encore : tu auras pitié de ceux que tu prendras en pitié, tu manifesteras ton amour à ceux que tu aimeras. Sinon le ciel et la terre parleraient de toi à des sourds. Qu’est-ce que j’aime quand je t’aime ? Ni la beauté d’un corps ni le charme d’un temps ni l’éclat de la lumière, amie de mon regard, ni les douces mélodies des cantilènes sur un mode ou un autre, ni le parfum des fleurs, des essences et des aromates, ni la manne ou le miel, ni les membres enlacés dans les étreintes physiques – ce n’est pas ce que j’aime quand j’aime mon Dieu. Et pourtant j’aime une lumière, une voix, une odeur, un aliment, une étreinte, quand j’aime mon Dieu. Lumière, voix, odeur, aliment, étreinte, sont dans mon humanité profonde où il y a pour moi un éclair que ne retient pas l’espace, une sonorité qui échappe au temps, une exhalaison sortie d’aucun souffle, une saveur que n’affaiblit pas la voracité, un accouplement au-delà de la jouissance. C’est ce que j’aime quand j’aime mon Dieu. Mais qu’est-ce que c’est ? J’ai interrogé la terre. Elle a dit : ce n’est pas moi. Et tout ce qui est sur la terre a fait le même aveu. J’ai interrogé la la mer et les abysses, les êtres vivants rampants. Ils ont répondu : nous ne sommes pas ton Dieu. Cherche au-dessus de nous. J’ai interrogé les vents qui soufflent. Et l’air tout entier, avec ses habitants, m’a dit : Anaximène se trompe. Je ne suis pas Dieu. J’ai interrogé le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Nous ne sommes pas le Dieu que tu cherches, disent-ils. Alors, j’ai dit à tout ce qui se tient aux portes de mes sens : dites-moi quelque chose sur mon Dieu, puisque ce n’est pas vous, dites-moi sur lui quelque chose. Une puissante exclamation m’a répondu : c’est lui-même qui nous a faits. Ce que je voulais prouver était dans mon interrogation. Et leur réponse était dans leur beauté. Je me suis alors tourné vers moi et j’ai dit à moi-même : et toi, qui es-tu ? J’ai répondu : un homme. Avec en moi, à ma disposition, un corps et une âme. L’un à l’extérieur, l’une à l’intérieur. Auprès duquel aurais-je dû chercher mon Dieu ? Je l’avais déjà cherché physiquement sur la terre jusqu’au ciel, aussi loin que j’avais pu envoyer les rayons messagers de mes yeux. L’intériorité est meilleure. C’est à elle que s’adressent tous les messagers du corps, pour surveiller et juger toutes les réponses du ciel et de la terre, et de tout ce qu’ils contiennent. 3 Nous ne sommes pas Dieu, disent-ils. C’est lui-même qui nous a faits. L’intériorité humaine les connaît par la connaissance externe que l’homme en a. Moi, je les connais. Moi, moi, esprit, par les sens du corps. (Livre X, 8-9, p. 330-332) Augustin entame une ascension au-dedans de lui-même pour trouver « ce qu’il aime quand il aime son Dieu ». Après être passé par la puissance sensible naturelle commune aux hommes et aux bêtes, il parvient dans les régions de la mémoire. Je poursuis ma lente ascension vers celui qui m’a fait. J’atteins les immenses prairies, les vastes palais de la mémoire où se trouvent les trésors des images innombrables importées par la perception de toutes sortes d’objets. Est entreposé là tout ce que notre intelligence développe, réduit ou modifie de quelque façon, à partir de la perception sensible. Et d’autres choses encore déposées là, conservées, que l’oubli n’a toujours pas absorbées et englouties. [...] Il y a là, distinctes et classées par catégories, toutes les choses qui se sont imposées chacune par une voie particulière. Par les yeux : la lumière, toutes les couleurs et les formes des corps ; par les oreilles : les sons en tous genres ; par le nez : toutes les odeurs ; par la bouche : toutes les saveurs. Et par la sensibilité du corps : ce qui est dur, mou, chaud ou froid, moelleux ou rugueux, lourd ou léger. Que ce soit extérieur ou intérieur au corps. [...] On voit clairement quels sens les ont captées et remisées au-dedans de nous. Dans le noir et le silence, si je veux, je peux faire apparaître de mémoire des couleurs. Je distingue, si je veux, le blanc du noir, et d’autres couleurs. Aucun son n’interfère avec l’examen de mes représentations visuelles. Pourtant les sons aussi sont là. Séparément, déposés quelque part. S’il me plaît de les réclamer, ils viennent immédiatement. Ma langue se repose, ma gorge est muette mais je chante autant que je veux ! Les images des couleurs ont beau être là, elles n’interfèrent pas et ne m’interrompent pas quand je reprends cet autre trésor qui s’est introduit par mes oreilles. Même phénomène pour ce que d’autres sens ont imposé et amassé. Je m’en souviens librement. Je distingue le parfum du lys de celui des violettes sans rien sentir, le miel et le vin cuit, le poli du rugueux, sans rien goûter ni toucher, mais uniquement par réminiscence. (Livre X, 12-14, p. 334-336) Augustin poursuit. La mémoire contient l’évocation du passé comme de l’avenir. Elle renferme des objets de savoir qui ne dépendent pas des sens : des notions, des modes de raisonnement, des techniques argumentatives ; ceux-ci relèvent de l’apprentissage intellectuel. Elle contient aussi les calculs et les nombres, les affects... Augustin réfléchit encore au lien entre les mots et les images qu’ils suscitent ou éveillent, et s’attarde sur le cas contradictoire du mot « oubli ». Il conclut à la puissance infinie de la mémoire. Il reprend ensuite sa question : où chercher et où trouver son Dieu uploads/Geographie/ albertcooper-fascicule2-1-2022.pdf
Documents similaires








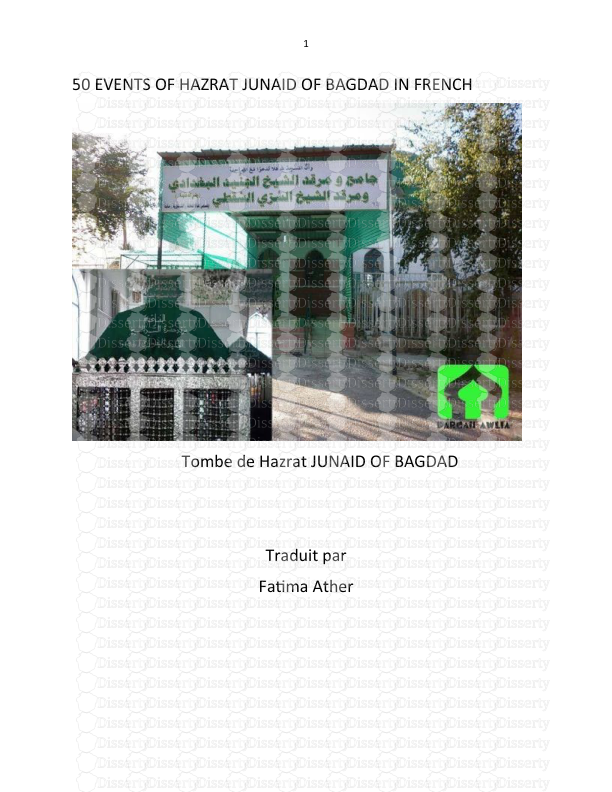

-
125
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 11, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 2.0767MB


