1895, revue d'histoire du cinéma Les débuts du cinéma à Angoulême Pierre Bernea
1895, revue d'histoire du cinéma Les débuts du cinéma à Angoulême Pierre Berneau Citer ce document / Cite this document : Berneau Pierre. Les débuts du cinéma à Angoulême . In: 1895, revue d'histoire du cinéma, n°1, 1986. pp. 28-31; doi : https://doi.org/10.3406/1895.1986.1450 https://www.persee.fr/doc/1895_0769-0959_1986_num_1_1_1450 Fichier pdf généré le 07/11/2019 Le cinéma des origines Pierre Berneau Les débuts du cinéma à Angoulême * 1 — La tournée de la Maison Lumière (août- octobre 1896) Ce fut le samedi 8 août 1896 que la première séance de cinéma eut lieu à Angoulême, en pré¬ sence du préfet de la Charente et des notables, dans un local situé place de l'Hôtel de Ville, pro¬ bablement là où se trouve aujourd'hui le hall de la Banque nationale de Paris. Ce jour-là, une nou¬ velle activité commerciale se manifesta pour la première fois dans l'histoire de la ville : l'exploi¬ tation des spectacles cinématographiques. MM. Auguste et Louis Lumière, dont les opérateurs venaient de s'installer à Angoulême, étaient en effet des entrepreneurs de spectacles. Ces indus¬ triels exploitaient commercialement l'appareil qu'ils venaient d'inventer : le cinématographe. On paya d'abord un franc, comme à Paris, jusqu'à la fin du mois, puis cinquante centimes jusqu'à la dernière représentation : le lundi 19 octobre de la même année. Cet abandon assez rapide de ce qu'on appellerait aujourd'hui le tarif d'exclusivité semble indiquer que l'enthousiasme des Charen- tais, gens de sens rassis, ne tarda pas à se refroi¬ dir quelque peu. Les séances, qui duraient envi¬ ron une demi-heure, se succédaient de deux heu¬ res à six heures en matinée, et de huit heures à onze heures en soirée. La Charente du 10 août 1896 nous donne une idée de ce que furent les premiers programmes de cinéma à Angoulême : Citons entre autres une manœuvre de cyclis¬ tes militaires à Madrid, la garde descendante au palais royal, une manœuvre d'artillerie, une scène champêtre, mauvaises herbes, une danse dans la rue à Londres, la place des Cordeliers à Lyon, avec toute sa grande animation : piétons, tramways, charrettes, la démolition d'un mur, la scène comi¬ que de l'arrosage que représentent les affiches posées sur nos murs, une querelle enfantine, deux bébés dont les jeux de physionomie sont admi¬ rablement rendus, enfin, l'arrivée d'un train en gare, avec le mouvement des voyageurs arrivant et partant reproduit avec une merveilleuse fidélité. On retrouve là les images popularisées par tou¬ tes les histoires du cinéma, comme cet arroseur arrosé ou ce train qui n'en finit pas d'arriver en gare. Mais tout le charme de cette évocation réside dans la fraîcheur et l'émerveillement des premiers jours. C'est encore cette même fraîcheur qui nous frappe dans Le Matin Charentais du 3 septembre 1896: Considérez un sujet simple, la querelle des deux bébés ou la démolition d'un mur, par exemple, et prévenus comme vous l'êtes maintenant, vous découvrirez des finesses de détail d'un effet sai¬ sissant. Passez ensuite à une scène plus com¬ plexe : la parade de cavalerie ou l'arrivée du train, et vous serez frappés d'une subtilité d'effets qui échappe à toute compréhension. Cette dernière reproduction surtout est renversante et on peut dire qu'elle résume toutes les autres. Cette machine qui s'avance en laissant échapper ses der¬ niers jets de vapeur, puis qui s'arrête, la station un instant calme et vide qui s'anime et se rem¬ plit de voyageurs sortant des salles d'attente ou des wagons dont les portières s'ouvrent avec pré¬ cipitation, ces employés qui courent le long du train, cet homme qui se fouille pour chercher son billet, c'est d'une intensité d'impression telle que, n'était le silence, on se croirait transporté pour une minute dans une gare. Ces quelques lignes écrites d'une plume alerte décrivent avec bonheur l'arrivée du premier train de l'histoire du cinéma, le premier d'une innom¬ brable lignée et probablement le plus célèbre, bien que son apparition ne durât pas plus d'une minute, comme nous le rappelle incidemment cet article que l'on pourrait bien tenir pour l'un des tout premiers articles de critique cinématographique. "Cet article s'inscrit dans le cadre de l'enquête lan¬ cée par l'AFRHC sur les débuts du spectacle cinémato¬ graphique en France et qui s'était déjà traduite dans le numéro zéro du bulletin de l'association par une con¬ tribution sur les débuts du cinéma à Nantes. 28 Le Matin Charentais du 13 septembre 1896 nous apporte d'autres précisions sur la program¬ mation du cinématographe Lumière, en rendant compte d'un événement local qui reflète bien cette ambiance de la fin du XIXe siècle. Soirée des plus select hier soir au cinématogra¬ phe qui est devenu le rendez-vous du tout Angou- lêrne, mais aussi du monde militaire internatio¬ nal. Nous avons assisté à une séance spécialement offerte par MM. Lumière au corps des officiers étrangers représentant toutes les puissances aux grandes manœuvres, ainsi qu'à MM. les officiers français délégués auprès d'eux. Le programme, composé de scènes militaires de diverses puissan¬ ces, était on ne peut plus attrayant et tout à fait de circonstance. Très applaudis les tableaux du sacre du Tsar à Moscou, ainsi que le tir de l'artil¬ lerie et la danse espagnole au bivouac. Après les défilés des fêtes du millénaire à Budapest, l'armée française ferma la marche par le défilé d'un régi¬ ment d'infanterie aux manoeuvres, des dragons traversant la Saône à la nage, avec leurs chevaux et enfin une belle charge de cuirassiers. Les applaudissements n'ont pas manqué et tout le monde, en sortant, ne tarissait pas d'éloges sur cette invention bien française qui, en quelques mois, a fait le tour de l'Europe. Relevons la pointe de chauvinisme proba¬ blement inspirée par les circonstances (cette invention bien française). Relevons également la référence aux six « tableaux » filmés à Moscou, le 14 mai 1896, lors du couronnement du tsar Nicolas II, par Moisson, le premier opérateur envoyé en Russie par les frères Lumière. La danse au bivouac et les cyclistes militaires avaient été filmés en Espagne, à peu près à la même époque, par Promio, autre opérateur célèbre de la maison lyonnaise. Le journal du 30 août mentionne éga¬ lement : une rixe, une rue de Londres, une bai¬ gnade en mer, une séance d'escrime, les forge¬ rons, un concours hippique. On peut donc dire que les opérateurs de la Maison Lumière montrè¬ rent aux Angoumoisins la plupart des films pro¬ duits par celle-ci en 1895 et en 1896, et que les spectateurs charentais n'eurent rien à envier à ceux du Grand Café du boulevard des Capucines. Le 7 octobre 1896, Le Matin Charentais publie l'annonce suivante : A l'occasion de la rentrée des écoles et pour permettre aux élèves de connaître la merveilleuse attraction scientifique qui est assurément appe¬ lée à prendre place dans leur programme d'ins¬ truction, le cinématographe de MM. Lumière, place de l'Hôtel de Ville à Angoulême, sera ouvert toute la journée à partir d'aujourd'hui mercredi. Quelques jours plus tard, les opérateurs du cinématographe pliaient bagage : ils ne devaient plus revenir car les frères Lumière allaient bien¬ tôt cesser de produire des films et d'exploiter eux- mêmes leur invention. 2 — Les débuts de l'exploitation foraine sur la place du Champ-de-Mars (1898-1900) Ce n'est que six mois plus tard que Le Matin Charentais mentionne à nouveau le cinémato¬ graphe. En effet, le 21 avril 1897, on put lire l'arti¬ cle suivant : LE SCÉNIMATOGRAPHE (sic) Mardi soir, a eu lieu la première séance du scé- nimatographe installé dans l'immeuble récem¬ ment construit rue des Halles Centrales. Par suite d'une insuffisance du courant électrique et d'une installation inachevée, cette première séance n'a pas donné le résultat attendu et nombre de spec¬ tateurs ont été un peu désappointés. La direction a pris des mesures pour remédier à cet état de cho¬ ses. A partir de ce jour, il y aura des représenta¬ tions quotidiennes de 3 heures à 6 heures de l'après-midi, et de 8 heures à 1 1 heures du soir. On alla de Charybde en Scylla, comme le prouve l'annonce parue le surlendemain : Pendant que le personnel du scénimatographe, rue des Halles Centrales, était occupé mercredi soir à rectifier l'installation de l'appareil, un incen¬ die occasionné par les fils électriques a détruit dix bandes photographiques. Les séances se trouvent de ce fait suspendues et ne reprendront que samedi soir. Phénomène prémonitoire, semble-t-il, car ce fut au début du mois suivant qu'éclata le catastro¬ phique incendie du Bazar de la Charité à Paris. Il y eut 140 morts, dont la duchesse d'Alençon. Le journal ne manqua pas l'occasion de faire remarquer à ses lecteurs que les Charentais s'illus¬ trent en toutes circonstances, même désastreuses : Un de nos confrères annonce, à propos de la catastrophe du Bazar de la Charité à Paris, que le propriétaire du cinématographe qui y était installé et l'employé qui était chargé de le faire fonc¬ tionner seraient deux Charentais. M. Bellac, qui est âgé de vingt-six ans, serait un des fils de M. Bellac, autrefois chef de gare à Saintes. Ce jeune homme aurait même appartenu à l'admi¬ nistration des Chemins de fer uploads/Geographie/ berneau-pierre-les-debuts-du-cinema-a-angouleme-in-1895-revue-d-x27-histoire-du-cinema-n01-1986-pp-28-31.pdf
Documents similaires





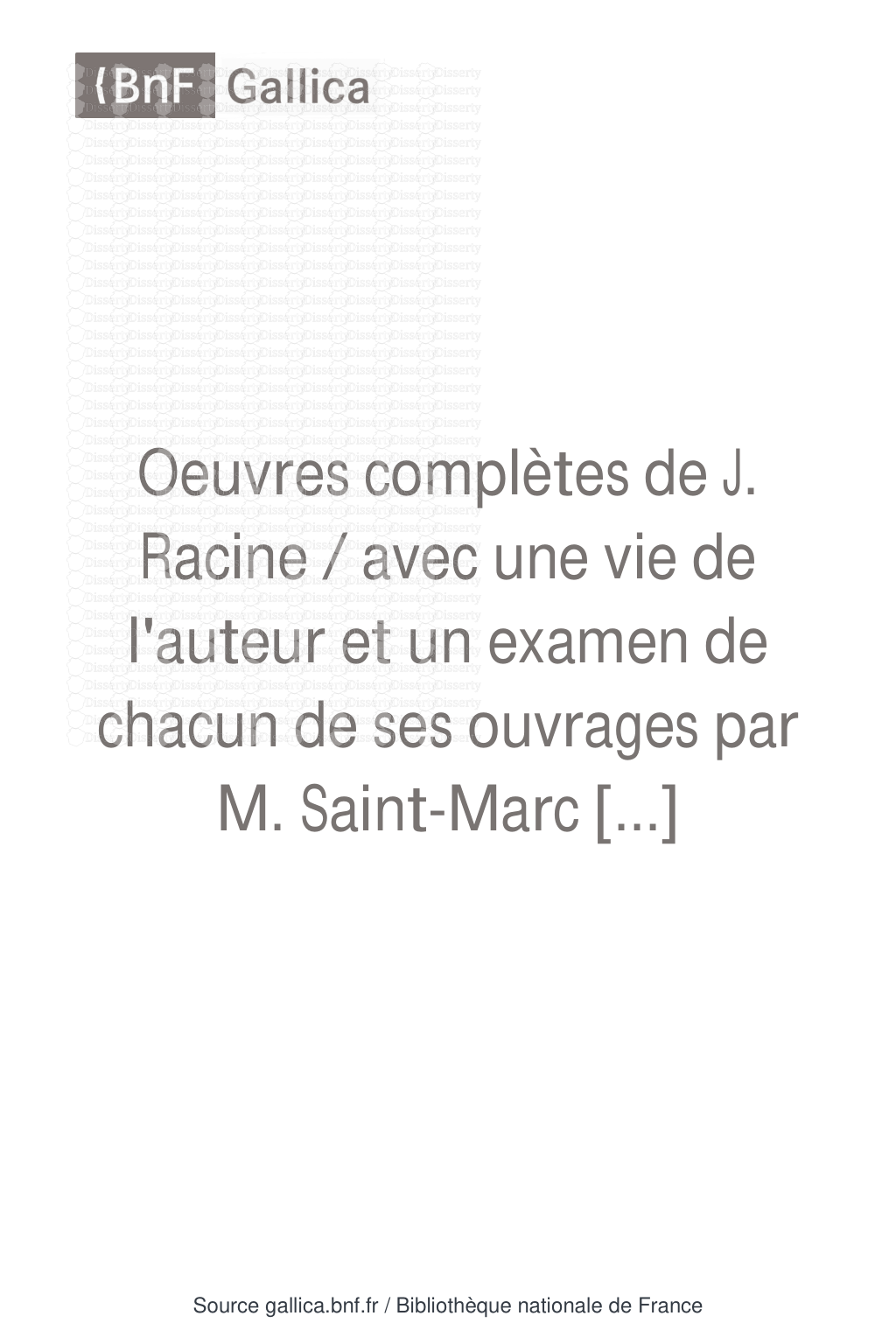




-
48
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 04, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5161MB


