1 CHAPITRE DEUXIEME : LA MIGRATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Il est d
1 CHAPITRE DEUXIEME : LA MIGRATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Il est difficile de distinguer la migration internationale des Congolais en général, et celle des Kinois en particulier. En effet, des nombreuses stratégies migratoires et le plus souvent concernant l’immigration irrégulière ont pris naissance à Kinshasa. Kinshasa en tant que métropole de la République Démocratique du Congo, est le miroir du pays ; de ce fait, comprendre la stratégie migratoire des Kinois équivaudrait à maitriser celle de l’ensemble du pays. Sur ce, nous abordons ce chapitre par la première section qui donne un aperçu général sur la migration en RDC, ensuite nous passerons à la deuxième section pour parler des facteurs d’émigration des Kinois, et enfin à la dernière section nous traiterons de la DV loterie. II.1 BREF APERÇU DE LA MIGRATION EN RDC Du point de vue historique, il convient de noter que la mobilité des Congolais en général a été modeste durant la période coloniale, aussi bien pour les migrations internes qu’internationales, hormis la migration des étudiants zaïrois boursiers des années 1970 et 1980 “Belgicains” ainsi que quelques, autre migrants de travail. Pour expliquer les processus migratoires, les économistes distinguent traditionnellement deux types de facteur à savoir les facteurs qui poussent les individus hors de leurs papys et les facteurs d’attraction qui attirent les individus dans un autre pays. Dans le premier cas, c’est la situation dans le pays de départ qui est déterminante pour comprendre les mécanismes migratoires. Dans le second cas, c’est la situation dans le pays de destination qui est déterminante. Un individu peut se sentir attiré par un pays en raison des avantages économiques directs; Dans le cadre de ce 2 travail, malgré la diversité des causes de l’émigration, nous allons les catégoriser en deux. Commençons par les migrations pour cause d’études Hormis les périodes précoloniale et coloniale, les migrations proprement dites dés Congolais vers l’Europe ont commencé au début des années 1960, après que le Congo ait obtenu son Independence. A cette époque, la migration vers l’Europe était une migration d’élite. Entre 1960 et 1980, la principale raison de départ des Congolais à l’étranger, plus particulièrement en Belgique, était liée à la poursuite de leurs études. Ceci s’expliquait par la coopération bilatérale entre la République Démocratique du Congo et la Belgique qui mettait à la disposition des étudiants congolais des bourses d’études. Cependant, il s’est développé pendant la même époque une émigration congolaise vers certains pays limitrophes et d’autre pays africains mais pas pour des raisons d’études C’était plutôt des migrations de travail. Au cours des trente dernières années, c’est-à-dire à partir des années 1980, le profil et la destination des migrants congolais était constitué principalement d’élites intellectuelles avant les années 1980. Selon le rapport final sur la crise économique et migrations internationales en RDC, les Congolais pauvres et les moins instruits ont participé de manière croissante aux migrations internationales vers des pays limitrophes. La raison était l’incertitude économique ainsi que l’instabilité politique et les pillages. Entre 1994 et 2004 environ 25.000 Congolais ont demandé le statut des réfugiés en Afrique du Sud au début des années 2000 et beaucoup d’autres vivent sans statut des réfugiés. C’est donc vers 1980, et surtout 1990 que les Congolais se sont véritablement engagés sur la voie de la migration internationale. Le 3 recours à l’émigration constitue un phénomène récent dans les stratégies des ménages congolais, nous renseigne Mangalu MOBHE1. En effet, dès la fin de 1990, et surtout au début de 1990, des nombreux ménages congolais ont eu recours à la migration internationale comme stratégie de survie, à la suite de la détérioration des conditions sécuritaires, politiques, économiques, et sociales2.Et nombreux prenaient comme destination, les pays africains: la République du Congo, l’Angola, la République sud-africaine3. En ce qui concerne la migration vers d’autres continents, la Belgique reste la destination privilégiée des Congolais, cela suite aux liens historiques qui relient ces deux pays. De ce fait, Bruxelles est utilisée comme le point d’ancrage pour les migrants congolais, à l’instar de Paris pour les Congolais .de Brazzaville avant leur redéploiement dans d’autres pays de l’espace Schengen.4 En 1990 la France va devenir le premier pays d’immigration des Congolais en Europe car elle semblait offrir beaucoup plu d’opportunités en matière d’emplois et d’intégration que d’autres pays européens. En 2000, la Banque Mondiale avait déjà évalué, à environ 739 000, la population totale des migrants Congolais répartis à travers le monde (ONU, 2006). La migration des Congolais vers d’autres pays est, dans une large mesure, une migration de proximité. Elle est, en effet, rattachée plus aux considérations historiques et aux facilités d’intégration (Mangalu, 2011 ; Solo, 2012). En Afrique, le Congo Brazzaville, l'Angola 1 Mangalu Mobhe, cité par José Bazonzi, op.cit. p160 2 Lututala, Zarnwangana, « RDC terre d’asile ou pays d’exil ? » In Département de Démographie (UNIKIN), DDK- FNUAP, Kinshasa, 1998 p23. MBANGI KWAKASA mémoire en sociologie (UNIKIN) p. 21 3 Idem 4 Jasé Bazonzi, op. cit, 4 et l'Afrique du Sud furent les principales destinations. Vers les années 1970, le nombre des Congolais de la RDC résidant au Congo-Brazzaville était évalué à environ 300 000 personnes (Ndombasi, 2012). Nombre qui, de nos jours, doit être sensiblement revu à la hausse. Dans l'hémisphère Nord, la présence remarquée des Congolais est une réalité relativement récente. Elle date du début des années 1960. La Belgique a été pendant longtemps une destination privilégiée des Congolais en Europe. Et les Congolais sont la première population originaire d’Afrique subsaharienne en Belgique, du point de vue numérique (Martiniello et Perrin, 2011 : 94), concurrencée aujourd’hui par les Guinées (Schoonvaere, 2010) Une enquête démographique menée toujours par Schoonvaere, sur la population congolaise en Belgique, établit à un peu plus de 16.132 le nombre de personnes de nationalité congolaise résidant légalement en Belgique ; au 1er janvier 2008. Et à 29.500, le nombre des Belges d’origine congolaise. A ce nombre d’environ 45.632 Congolais, de nationalité et d’origine, il convient d’ajouter celui des Congolais en situation d’irrégularité qu’il est assez difficile de dénombrer et que, de façon plus ou moins consensuelle, on estime à environ 10.000. Après la Belgique, les Congolais ont migré progressivement dans d'autres pays du Nord, notamment en France, en Grande- Bretagne, en Allemagne, aux Etats-Unis, au Canada, etc. Ce total d’environ 55 632 congolais vivant en Belgique (en 2008), un pays 80 fois moins grand en superficie et six fois plus réduit en population que la RDC, traduit, de fait, la réalité de la migration congolaise. 5 II.3. CONTEXTE DE LA MIGRATION CONGOLAISE DE 1960 À NOS JOURS Comme durant la colonisation, la migration congolaise après l'indépendance n'est pas une donne gratuite, moins encore une réalité neutre. Elle est liée à deux contextes complémentaires qui l'exacerbent. Il s'agit des contextes politique et économique. II.3.1. Contexte politique La République Démocratique du Congo a connu un passé désastreux et éprouve un présent inquiétant, malgré sa dimension, son histoire complexe et son potentiel inaccompli. Enfermée non seulement à l’intérieur de ses troubles internes, mais aussi dans ceux de la région africaine des Grands Lacs, elle a fourni en quantité bien suffisante du matériel sur les migrations forcées, la violence et les marasmes politiques (Revue Migrations Forcées, 2010). Ceci revient à dire que la compréhension de la situation politique de la RDC exige une vision panoramique diachronique. Pour une bonne compréhension du contexte politique de la RDC qui, à coup sûr, a des effets d'entrainement sur la migration congolaise, six grandes périodes méritent d'être retenues. Il s'agit des périodes allant de 1960 à 1965, de 1965 à 1990, de 1990 à 1997, de 1997 à 2003, de 2003 à 2006 et de 2006 à nos jours. II.3.1.1. De 1960 à 1965 Débutent avec l'euphorie dont les Congolais indépendants ont fait montre le jeudi 30 juin 1960, personne ne pouvait s’imaginer que juste quelques jours après, le pays soit le théâtre des rébellions de toutes sortes et des crises institutionnelles. En effet, durant la première République (1960-1965), le pays se décomposa et fut confronté à des 6 guerres civiles, à des pogroms ethniques, à des tueries et assassinats. Il a connu deux coups d'Etat, trois rébellions et six chefs de gouvernement (Lumumba, Iléo, Bomboko, Adoula, Tshombe et Kimba). Bref, Van Reybrouck (2012) qualifie cette première République des "années mouvementées" ou de "l'époque apocalyptique" durant laquelle tout ce qui pouvait mal tourner tourna mal. Sur le plan politique ou militaire, le pays sombra dans un chaos total inextricable. Certaines personnes avisées attribuent cette situation à l'immaturité politique des Congolais, laquelle immaturité découle de l'impréparation des politiciens et/ou évolués à assumer des charges publiques de grande envergure. Et ce, dans tous les secteurs de la vie nationale. Par exemple à l'indépendance, le nombre de cadres universitaires formés n'était que de 16 pour une population estimée à environ 13 millions d'habitants (Stengers 1989). Aussi, l'indépendance mal préparée et précipitée5 ne resta-t-elle pas sans conséquence sur le plan migratoire durant la première République à cause des troubles multiples qui ont caractérisé cette période. L'on note même l'exil de certains politiciens dont uploads/Geographie/ chapitre-deuxieme-alfred-mputu.pdf
Documents similaires






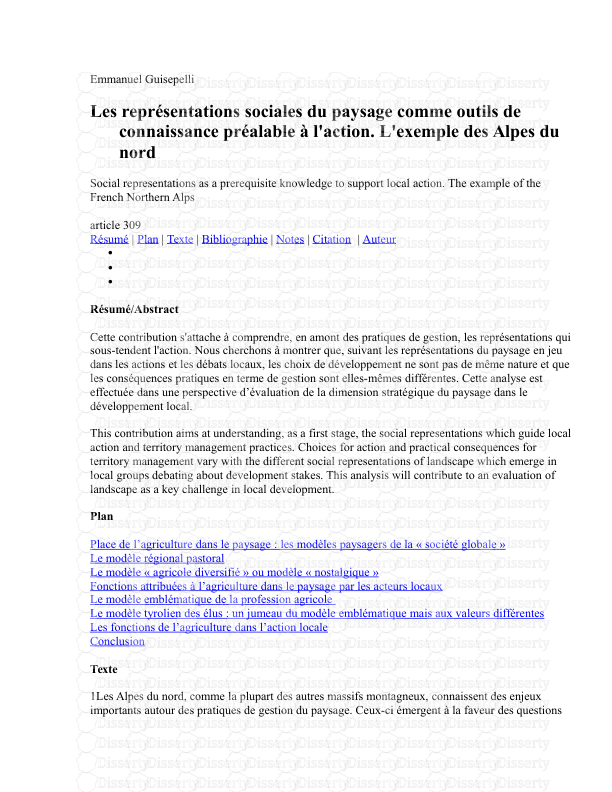



-
108
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 02, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1645MB


