Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Univ
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d'édition numérique de documents scientifiques depuis 1998. Pour communiquer avec les responsables d'Érudit : erudit@umontreal.ca Article Olivier Lazzarotti Cahiers de géographie du Québec, vol. 50, n° 139, 2006, p. 85-102. Pour citer cet article, utiliser l'information suivante : URI: http://id.erudit.org/iderudit/012936ar DOI: 10.7202/012936ar Note : les règles d'écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir. Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous pouvez consulter à l'URI http://www.erudit.org/apropos/utilisation.html Document téléchargé le 2 January 2014 10:10 « Habiter, aperçus d’une science géographique » Cahiers de géographie du Québec Volume 50, numéro 139, avril 2006 Pages 85-102 Habiter, aperçus d’une science géographique Inhabiting from a geographical science perspective Olivier LAZZAROTTI Université de Picardie-Jules-Verne Équipe MIT, Université de Paris VII olivier.lazzarotti@club-internet.fr Résumé Cet essai se propose d’envisager ce que pour- raient être, dans leur diversité mais aussi leur cohérence, les traits, les problématiques et les perspectives d’une science géographique fon- dée sur le concept d’habiter. Distinguant trois instances d’analyse, l’espace habité, l’habitant et la cohabitation, l’idée est aussi d’envisager leur articulation dans les dynamiques d’un rapport d’habitation. Ainsi s’ouvrent les di- mensions existentielles et politiques d’une telle approche. Au-delà, se pose l’éventualité d’une structuration topique fondamentale des êtres humains et des sociétés, c’est-à-dire celle d’espaces habités non géographiques, mais pourtant construits et appréhendables avec les notions communes aux espaces habités géographiques. Et cela revient encore à exa- miner les limites du concept autant que celles de cette science géographique. Abstract This essay intends to consider what could be the characteristics, problems and perspecti- ves of a geographical science based upon a well-knit yet multi-dimensional concept of inhabiting. We will single out three targets of analysis: inhabited space, the inhabitant, and cohabitation; in addition, their intercon- nectedness as regards the dynamics of their habitation relationship will be considered. The existential and political dimensions of such an approach become apparent in this manner. Above and beyond these considerations, the eventuality of a fundamental structuring of individual and social topography comes into play, one that involves inhabited non-geogra- phic spaces, which are, however, constructed and rendered understandable using ideas common to inhabited geographical spaces. And all this leads us back to examining the limits of the concept and of this geographical science itself. Mots-clés Habiter, espace habité, habitant, cohabitation, rapport d’habitation Keywords Inhabiting, inhabitant, cohabitation, habitation relationship 86 Cahiers de géographie du Québec Volume 50, numéro 139, avril 2006 Comment concevoir, avec la géographie, une théorie des hommes qui s’affi che, aussi, comme celle de leurs relations ? Comment, avec quel outil, quel moyen, quel concept, passer de la géographie comme expérience de la condition humaine, cette épreuve de soi et des autres à travers le monde, aux mots pour la dire, soit à la science géo- graphique comme sa pensée ? L’intention de ce travail est d’explorer comment, à travers la défi nition que nous en avancerons, l’habiter pourrait ouvrir une voie en ce sens. En l’impliquant comme concept, nous y mettrons l’opportunité d’une approche synthétique de la géographie, ce qui ne revient pas à en faire une science de synthèse. Car nous emploierons le mot synthèse selon la défi nition qu’en propose Norbert Élias : « pouvoir propre à l’homme de se rendre présent ce qui, en fait, n’est pas présent hic et nunc et de le relier à ce qui est effectivement présent hic et nunc » (1996 : 84). L’habiter devra être le principe de cette synthèse, à la fois comme son axe de cohérence et le mode de différenciation de ses diverses notions. En tant que tel, il est ce qui réunit pour séparer, aussi bien que ce qui sépare pour articuler. Dans la présente réfl exion, il ne s’agit pas d’analyser précisément les pans de cette science géographique, mais de les évoquer simplement, pour suggérer comment on peut les lier. Nous privilégierons donc cette dynamique d’une approche globale et cohérente qui défi nit, en partie du moins, le contenu d’une approche scientifi que. Une telle ambition n’est pas nouvelle en géographie, bien que l’histoire de cette science ne soit pas couramment traversée de grandes fresques théoriques. Après le possibi- lisme, théorie qui tut son nom, la logique de science sociale, très largement promue par Roger Brunet, lui servit de perspective fertilisante. De son côté, Jacques Lévy défend le point de vue de l’espace, en particulier à travers le prisme de la distance, comme principe de compréhension de l’analyse spatiale et de la science géographique. Notre projet s’inspire de ces démarches en tant qu’approches globales. Quant à sa propre source, il la trouve aux travaux sur le tourisme de l’équipe MIT (2002 et 2005), en particulier sur sa défi nition comme déplacement, c’est-à-dire comme changement de lieu pour, du coup, habiliter l’intime liaison entre les lieux et les territoires. Dès lors, cette lecture ouvre la porte d’une réorientation possible de la science géographique. L’émergence de l’habiter comme concept central répond ainsi à une double révolution géographique que le levier du déplacement a enclenchée. La première est celle de cette expérience renouvelée du monde par l’accès progressif à la société à habitants mobiles. Jamais, dans l’histoire du monde, les hommes n’ont autant qu’aujourd’hui, c’est-à-dire plus qu’hier et probablement moins que demain, pu accéder à de tels degrés de liberté dans le choix même des lieux qu’ils fréquentent. Au-delà des faits eux-mêmes, on peut y voir un renversement de point de vue qui implique, plei- nement aussi, les habitants qui ne bougent pas. C’est que, s’ils sont apparemment immobiles, les mobilités des autres transforment la portée géographique de leur immobilité, comme non-déplacement, en quelque sorte. Cela implique de procéder à un bouleversement de l’approche géographique (Knafou et al.1997) par l’hypothèse que chaque habitant est porteur d’une géographie qui lui est propre, celle des diffé- rents lieux qu’il a pu fréquenter et comment il l’a fait. Et cela le qualifi e. Le rapport au monde peut, ainsi, se saisir comme donnée singulière à chacun et la science géographique comme l’un des moyens d’y avoir accès. Du coup, une telle science est conduite sur les pistes de l’entreprise analytique (Ferrier, 1998) aussi bien que sur celles du déconstructivisme : Freud, Lacan ou encore Derrida seraient-ils désormais au rendez-vous de cette science-là ? 87 Habiter, aperçus d’une science géographique La seconde révolution est donc celle de la science géographique elle-même, et cela n’est rien d’autre que cohérent. Mais le renversement de point de vue n’est pas seul en cause. Il n’est que de peu d’intérêt, en effet, s’il ne conduit qu’à produire de nou- veaux fl ots de connaissances, cultivant le courant de spécialisation qui caractérise une partie des évolutions scientifi ques du moment. Quand l’inexplicable inexpliqué s’accumule (Stril-Revel, 1990), le travail scientifi que ne peut être utile autrement qu’en s’attachant à inventer les concepts synthétiques, ceux des grandes perspectives, quitte à les remettre en cause à chaque ouvrage : habiter ? Cette invite suggère aux géographes de dépasser la « dialectique des déterminants ver- ticaux et horizontaux », pour reprendre les termes de Geneviève et Philippe Pinchemel (1997 : 354) : d’un côté, l’analyse spatiale et les approches holistiques ; de l’autre, celle des représentations et autres valeurs, et les approches solipsistes. En outre, cette parti- tion réfl échit, fi nalement, celle des grands partages catégoriels des sciences humaines et sociales, entre interactionnisme d’une part, et cognitivisme de l’autre, selon ces autres termes de Denise Pumain (2003). Le rôle de la science géographique dans ce concert est donc aussi en cause. L’intérêt de la production de l’habiter comme nouveau concept n’est donc légitime qu’à la lumière de ce double défi , à la fois humain et scientifi que. Quelle différence, au demeurant, y a-t-il entre les deux, s’il y en a une ? C’est, en tout cas, en ce sens que nous voudrions en donner ne serait-ce qu’un aperçu (Lazzarotti, 2006). Une rapide archéologie de l’habiter Habiter : le mot est courant et usité dans de nombreux champs sémantiques. On le trouve dans celui de l’architecture, en particulier dans le sens de logement, certes, mais il est aussi celui des traducteurs de la Bible (Jean, I, 14, par exemple). Et ces deux registres n’en épuisent pas l’usage, loin de là. Tout au long du XXe siècle, en effet, il est intégré aux sciences sociales et humaines, bien qu’il ne fi gure au cœur du dispositif épistémologique d’aucune d’entre elles. Un bref panorama convoque la philosophie et, prioritairement, la phénoménologie ontologique de Martin Heidegger (1996), mais aussi celle de la perception de Maurice Merleau-Ponty (2003). Il lui adjoint les sciences politiques, celles de Henri Lefebvre (1972) entre autres et, de manière tangentielle, les sciences sociales, notamment par le biais de l’habitus bourdieusien (1979). En outre, en considérant uploads/Geographie/ habiter-une-science-geographique-lazarotti.pdf
Documents similaires




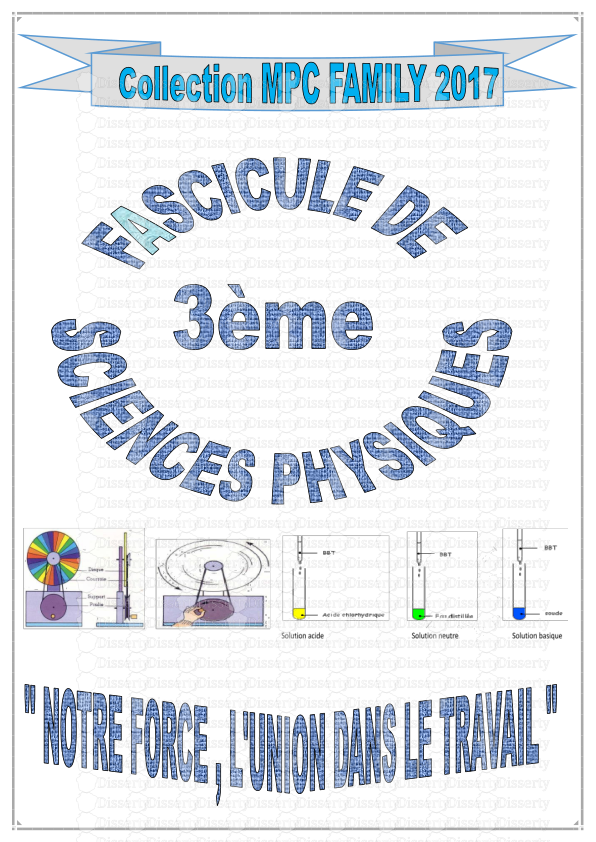





-
106
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 20, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3358MB


